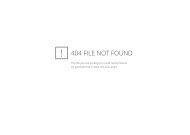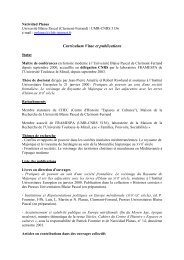Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
peuple. Les vice-légats italiens, qui ne restent en place que sur <strong>de</strong> courtes pério<strong>de</strong>s (Lorenzo<br />
Corsi <strong>de</strong> 1645 à 1653, Dominique <strong>de</strong> Marinis d’octobre 1653 à juin 1654, Agistino Franciotti<br />
<strong>de</strong> juin 1654 à décembre 1655, Giovanni-Nicola Conti <strong>de</strong> décembre 1655 à janvier 1659,<br />
Gasparo Lascaris <strong>de</strong> janvier 1659 à juillet 1663 270 ) n’ont pas les moyens ni le temps <strong>de</strong> mettre<br />
en place une politique cohérente. Durant cette pério<strong>de</strong>, leur rôle est <strong>de</strong> pacifier les esprits par<br />
<strong>de</strong>s changements <strong>de</strong> politique qui déçoivent cependant assez rapi<strong>de</strong>ment. Beaucoup plus<br />
importante semble en définitive l’influence <strong>de</strong>s prélats qui ont eu le temps <strong>de</strong> se constituer une<br />
clientèle : face à Bichi à Carpentras, l’archevêque d’Avignon Marinis, vice-légat par intérim<br />
<strong>de</strong> 1653 à 1654, joue un rôle <strong>de</strong> médiateur assez favorable aux chefs pévoulins.<br />
La « fron<strong>de</strong> avignonnaise », fondée sur <strong>de</strong>s accusations <strong>de</strong> corruption et <strong>de</strong> malversations<br />
financières, est donc un conflit interne aux élites locales qui s’appuient sur <strong>de</strong>s mouvements<br />
populaires, avec tous les débor<strong>de</strong>ments et toutes les manipulations que cela suppose.<br />
L’opposition serait donc moins entre le peuple et les nobles qu’entre les conservateurs qui<br />
détiennent le pouvoir municipal <strong>de</strong>puis <strong>de</strong> nombreuses années et <strong>de</strong>s réformateurs souhaitant<br />
modifier les équilibres politiques et mettre fin à <strong>de</strong>s abus divers qui expliqueraient<br />
l’en<strong>de</strong>ttement croissant <strong>de</strong> la ville. Les tensions couvent <strong>de</strong>puis les années 1630 puisque le<br />
baron <strong>de</strong> Crillon dénonçait déjà la mauvaise gestion <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers publics en 1634.<br />
La tentation d’ériger la psychologie <strong>de</strong>s foules en objet d’étu<strong>de</strong> est gran<strong>de</strong> dans<br />
l’historiographie même relativement récente <strong>de</strong>s mouvements <strong>de</strong> révolte. L’étu<strong>de</strong> classique <strong>de</strong><br />
René Pillorget sur les mouvements insurrectionnels provençaux utilise <strong>de</strong>s catégories<br />
empruntées à la théorie <strong>de</strong>s comportements et à la psychologie collective 271 . Ses schémas<br />
explicatifs sont opérationnels dans le cas avignonnais, témoignant <strong>de</strong> la proximité <strong>de</strong>s<br />
comportements sociaux et culturels sur les <strong>de</strong>ux rives <strong>de</strong> la Durance : insurrections<br />
essentiellement urbaines prenant racine dans <strong>de</strong>s conflits locaux entre les élites,<br />
revendications populaires <strong>de</strong> nature essentiellement économique pour un abaissement <strong>de</strong> la<br />
fiscalité sur les <strong>de</strong>nrées <strong>de</strong> première nécessité (le vice-légat Franciotti cherche par exemple à<br />
apaiser les tensions en janvier 1655 en modifiant le régime <strong>de</strong> la fiscalité dans un sens plus<br />
favorable au « peuple », entendu comme l’ensemble <strong>de</strong>s populations travaillant pour<br />
l’artisanat et le commerce), revendication politique <strong>de</strong> la création d’une quatrième main dans<br />
le consulat pour représenter les artisans, dénonciation <strong>de</strong>s abus visant notamment le monopole<br />
<strong>de</strong> certaines familles et <strong>de</strong> certains individus sur certains charges (notamment celle <strong>de</strong><br />
secrétaire <strong>de</strong> la ville occupée par Henrici). La radicalisation <strong>de</strong>s émeutiers du 5 au 8 novembre<br />
1655 reste toutefois mal élucidée : une rixe entre <strong>de</strong>ux nobles déclenche un mouvement <strong>de</strong><br />
colère dont les meneurs issus du « peuple » sont connus mais dont les motivations restent<br />
énigmatiques, en <strong>de</strong>hors du sentiment <strong>de</strong> l’affront fait à un partisan <strong>de</strong>s pévoulins.<br />
Les mouvements insurrectionnels avignonnais ne sont pas <strong>de</strong>s mouvements antifiscaux<br />
simples : s’ils se produisent dans un contexte <strong>de</strong> tensions économiques et <strong>de</strong> défense <strong>de</strong>s<br />
intérêts <strong>de</strong> certains groupes, notamment ceux <strong>de</strong>s artisans du textile dans une cité où cette<br />
activité est très importante, ils n’ont pas pour objectif principal l’abrogation d’une fiscalité<br />
nouvelle. Les Avignonnais ne paient pas <strong>de</strong> taille, contrairement aux Comtadins soumis<br />
cependant à un impôt direct très faible <strong>de</strong>puis la fin <strong>de</strong>s guerres <strong>de</strong> religion : dans les <strong>de</strong>ux cas,<br />
l’absence ou l’allègement <strong>de</strong> taille constitue un choix politique rendu possible par l’absence<br />
<strong>de</strong> vocation militaire <strong>de</strong> ces enclaves et par la protection royale qui s’exerce notamment lors<br />
<strong>de</strong> la reprise <strong>de</strong>s guerres civiles contre les huguenots dans les années 1620 272 . L’entrée <strong>de</strong><br />
270 . Une liste <strong>de</strong>s vice-légats très précise est donnée par Bernard THOMAS dans Archives <strong>de</strong> la légation d’Avignon, Avignon,<br />
Conseil Général <strong>de</strong> Vaucluse, 2004, p. 251-260.<br />
271 . R. PILLORGET, Les mouvements insurrectionnels <strong>de</strong> Provence entre 1596 et 1715, Paris, A. Pedone, 1975, « Théorie <strong>de</strong>s<br />
mouvements insurrectionnels », p. 427-449.<br />
272 . P. FOURNIER, « La fiscalité comtadine aux XVI e et XVII e siècles : histoire d’un déclin ou d’une mutation ? », dans A.<br />
FOLLAIN, G. LARGUIER (dir.), L’impôt <strong>de</strong>s campagnes, fragile fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’Etat dit mo<strong>de</strong>rne (XV e – XVIII e siècle), Paris,<br />
Comité pour l’histoire économique et financière <strong>de</strong> la France, 2005, p. 267-309<br />
150