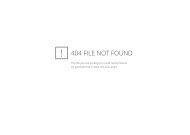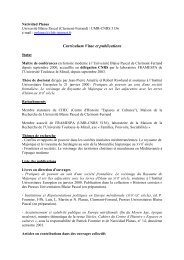Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
établissements agricoles et dans les villages il y avait <strong>de</strong>s esclaves indigènes d’origines très<br />
variées, lesquels se considèrent si différents entre eux autant que n’importe quel individu<br />
d’ethnie diverse aujourd’hui. Après la fuite et la réunion au milieu <strong>de</strong> la forêt, ils n’ont pas eu<br />
la possibilité <strong>de</strong> reconstruire une culture ancestrale unique, car ils étaient d’origines<br />
diverses ». Par conséquent, ils ont commencé la formation d’une nouvelle société, d’une<br />
nouvelle culture, comme ont fait les Africains d’origines diverses dans les quilombos.<br />
Pourtant, « Mocambos <strong>de</strong> Índios », est un terme très précis pour <strong>de</strong>signer cette situation <strong>de</strong><br />
création <strong>de</strong>s nouvelles racines, <strong>de</strong>s liens entre exploités, <strong>de</strong>s instruments <strong>de</strong> résistance<br />
culturelle et militaire 204 .<br />
Cette <strong>de</strong>rnière est la perspective que nous travaillerons, la recherche <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong><br />
résistance, les permanences et les créations <strong>de</strong> nouvelles racines, nouvelles dynamiques<br />
socioculturelles à partir du contact entre différents peuples. L’usage rituel <strong>de</strong> la Jurema<br />
semble pouvoir fournir tous ces éléments, car ce complexe usage est venu <strong>de</strong>s contextes<br />
indigènes ancestraux et a marqué son espace dans les contextes métisses avec les blancs<br />
(Catimbó) 205 et surtout mélangé avec les cultes afro-brésiliens (Umbanda et Candomblé) 206 .<br />
Les frontières coloniales et les peuples autochtones du Nor<strong>de</strong>ste aux XVIe et XVIIe siècles<br />
Déjà au XVIe siècle les colonisateurs européens ont commencé à connaître la gran<strong>de</strong><br />
sociodiversité existant au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s « muralhas do sertão » (murailles du sertão), pour utiliser<br />
une expression <strong>de</strong> l’époque citée par Pedro Puntoni 207 . La dichotomie inculquée par les<br />
missionnaires jésuites d’une division simple <strong>de</strong>s peuples autochtones du Brésil entre les<br />
groupes parlants les langues <strong>de</strong> la famille Tupi, habitant surtout sur le littoral brésilien, et d’un<br />
autre coté, les Tapuias, parlant d’autres langues et habitant principalement l’intérieur<br />
continental, sauf quelques cas où ils ont été présents sur le littoral, a influencé toute la<br />
construction <strong>de</strong> la compréhension <strong>de</strong> ces peuples le long <strong>de</strong> l’histoire brésilienne et apparaît<br />
souvent dans la documentation coloniale.<br />
La gran<strong>de</strong> critique actuelle <strong>de</strong> cette classification – déjà établie <strong>de</strong>puis la <strong>de</strong>uxième<br />
partie du XXe siècle – concerne la généralisation sous la dénomination tapuia <strong>de</strong> familles<br />
linguistiques et d’ethnies différentes. La désignation Tupi fait référence à une définition<br />
ethnique, linguistique et culturelle, par contre, la désignation tapuia ne fait pas référence à<br />
quelques catégories classificatoires mais seulement à un contraste établi par les peuples <strong>de</strong><br />
langue Tupi par rapport leurs voisins et ennemis. L’expression « tapuia » est un mot tupi qui<br />
signifie « barbare », « esclave » ou plus génériquement, « peuples <strong>de</strong> langue entravé » (povos<br />
<strong>de</strong> língua travada). Actuellement, l’idée plus acceptée sur la classification générale <strong>de</strong>s<br />
peuples autochtones brésiliens inclue la plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s peuples historiquement<br />
mentionnés comme tapuias dans le tronc linguistique Macro-Gê, avec plusieurs groupes <strong>de</strong><br />
langues isolées.<br />
Le contact entre les colonisateurs européens et les peuples indigènes localisés au<br />
littoral brésilien, ou plus spécifiquement le littoral oriental, au nord <strong>de</strong> l’embouchure du<br />
fleuve São Francisco jusqu’au Cap São Roque, qui comprenait les capitaineries <strong>de</strong><br />
Pernambuco, Itamaracá, Paraíba et Rio Gran<strong>de</strong>, a été assez irrégulier, nonobstant tous ces<br />
peuples qui ont habité ce région côtière étaient <strong>de</strong> langue Tupi, distribués en trois gran<strong>de</strong>s<br />
nations indigènes : Caeté, Tabajara et Potiguara.<br />
204 CARVALHO, Marcus, op. cit.<br />
205 BATIDE, Roger, “Catimbó” in PRANDI, Reginaldo (org.), Encantaria Brasileira: livro dos mestres, caboclos e<br />
encantados, Rio <strong>de</strong> Janeiro: Pallas, 2000.<br />
206 CAPONE, Stefania, La quête <strong>de</strong> l’Afrique dans le Candomblé: pouvoir et tradition au Brésil, Paris: Karthala, 1999.<br />
207 PUNTONI, Pedro, A Guerra dos Bárbaros: Povos indígenas e a colonização do sertão do Nor<strong>de</strong>ste do Brasil, 1650-<br />
1720, São Paulo: Hucitec; Editora da <strong>Universidad</strong>e <strong>de</strong> São Paulo, 2002 (Estudos Históricos: 44).<br />
121