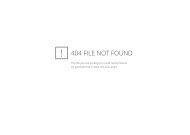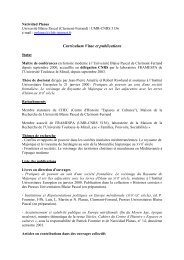Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
eaucoup d’autres cités importante <strong>de</strong> leur royaume. En 1660, Bor<strong>de</strong>aux, Toulouse, Marseille<br />
surtout apparaissaient comme <strong>de</strong>s villes à soumettre définitivement avant la célébration du<br />
mariage royal à Saint-Jean-<strong>de</strong>-Luz le 9 juin 295 . En Provence, le roi est d’abord reçu à<br />
Tarascon, Arles, Salon et Aix mais c’est Marseille qui apparaît comme la ville rebelle que le<br />
roi fait occuper militairement les 20 et 21 janvier et auquel il impose une profon<strong>de</strong> réforme<br />
institutionnelle 296 . A Avignon, l’accueil du roi est au contraire très classique, comparable dans<br />
les formes <strong>de</strong> l’hommage rendu à ce qui avait été fait pour Louis XIII en 1622 mais avec un<br />
cérémonial allégé : la ville n’a pas eu le temps (et sans doute n’a-t-elle plus les moyens<br />
financiers) d’organiser une entrée aussi fastueuse avec <strong>de</strong>s arcs <strong>de</strong> triomphe 297 . Les autorités<br />
urbaines et la vice-légation collaborent comme à l’accoutumée pour rendre un hommage<br />
appuyé au souverain français : lorsque Louis XIV venant <strong>de</strong> Languedoc se dirigeait vers la<br />
Provence, le fils du premier consul d’Avignon a été député à Nîmes pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au roi<br />
d’honorer la ville <strong>de</strong> sa présence et le vice-légat a été reçu par le roi à Arles peu <strong>de</strong> temps<br />
après.<br />
Louis XIV prend aussi la peine <strong>de</strong> répondre aux protestations <strong>de</strong> fidélité <strong>de</strong> la ville en<br />
marquant bien son respect pour la souveraineté pontificale. Au fils du premier consul, il<br />
répond : « Quoique vous ne soyez pas mes sujets, je conserverai néanmoins beaucoup<br />
d’affection pour toute votre ville et pour votre particulier ». Lorsque les clés <strong>de</strong> la ville lui<br />
sont présentés à son arrivée <strong>de</strong>vant la porte Saint-Lazare, il les rend « disant qu’elles étaient<br />
entre bonnes mains, qu’il les y fallait laisser ». Faut-il interpréter les signes <strong>de</strong> fidélité <strong>de</strong>s<br />
autorités avignonnaises comme un message nouveau qui ferait suite aux troubles <strong>de</strong>s années<br />
précé<strong>de</strong>ntes et manifesterait un rejet du pouvoir italien incarné par l’administration <strong>de</strong>s vicelégats<br />
? Rien ne permet <strong>de</strong> corroborer cette analyse <strong>de</strong>venue pourtant classique dans<br />
l’historiographie locale, sauf à adopter une démarche rétrospective et à faire <strong>de</strong> la visite <strong>de</strong><br />
Louis XIV la préparation <strong>de</strong> l’occupation française <strong>de</strong> 1663. Il aurait été surprenant au<br />
contraire que les autorités avignonnaises négligent l’opportunité d’une entrée royale dans leur<br />
ville : cela aurait pu être considéré comme un affront par la monarchie française. Il n’y a pas<br />
non plus <strong>de</strong> conclusion hâtive à tirer <strong>de</strong>s réjouissances organisées pour la paix <strong>de</strong>s Pyrénées<br />
ou pour la naissance du Dauphin : elles sont logiques dans une cité dont le <strong>de</strong>stin est aussi<br />
étroitement lié à la France et dont la noblesse se met fréquemment au service du roi <strong>de</strong><br />
France. La pression française peut même apparaître plus légère au milieu du XVII e siècle<br />
qu’au XVI e siècle, lorsque les enjeux stratégiques et les guerres civiles obligeaient la<br />
monarchie à intervenir plus directement dans les affaires avignonnaises et comtadines 298 .<br />
Pour Louis XIV, le séjour à Avignon n’a rien d’une manifestation <strong>de</strong> force. C’est l’occasion<br />
d’un séjour agréable qui permet le rassemblement d’une partie importante <strong>de</strong> la Cour. Le Roi<br />
est notamment accompagné <strong>de</strong> son frère, Monsieur, <strong>de</strong> la reine mère, <strong>de</strong> Ma<strong>de</strong>moiselle, la<br />
cousine du roi, du cardinal Mazarin, du prince et <strong>de</strong> la princesse <strong>de</strong> Conti et <strong>de</strong> plusieurs<br />
membres <strong>de</strong> la haute noblesse. Le duc <strong>de</strong> Lorraine rejoint la Cour à Avignon le 29 mars. La<br />
noblesse avignonnaise peut ainsi approcher les courtisans durant quelques jours. Louis XIV<br />
pose ostensiblement en roi Très-Chrétien : son séjour avignonnais correspond au temps pascal<br />
et il assiste à <strong>de</strong> nombreuses messes, visite les sept églises <strong>de</strong> la ville, écoute <strong>de</strong>s sermons,<br />
lave les pieds <strong>de</strong> treize pauvres, touche les écrouelles. Se rendant à Orange, il refuse en<br />
revanche <strong>de</strong> recevoir les ministres protestants. La signification religieuse <strong>de</strong> ce séjour a donc<br />
autant d’importance que sa signification politique : enclavée dans le royaume, Avignon reste<br />
une autre Rome dont le roi sait qu’elle ne présente aucun intérêt stratégique et qu’elle lui est<br />
295 . Journal contenant la relation véritable et fi<strong>de</strong>lledu voyage du Roy & <strong>de</strong> son Eminence pour le Traité du mariage <strong>de</strong> Sa<br />
Majesté, & <strong>de</strong> la Paix Générale, 1659-1660.<br />
296 . R. PILLORGET, Les mouvements insurrectionnels <strong>de</strong> Provence, op. cit., p. 819-827.<br />
297 . Un compte rendu <strong>de</strong> cette entrée a été imprimé peu après le séjour du roi. Un long extrait est publié dans P. CHARPENNE,<br />
Histoire <strong>de</strong>s réunions temporaires d’Avignon et du Comtat Venaissin à la France, op. cit., T. I, p. 513-533.<br />
298 . Histoire d’Avignon, op. cit., p. 319-364.<br />
158