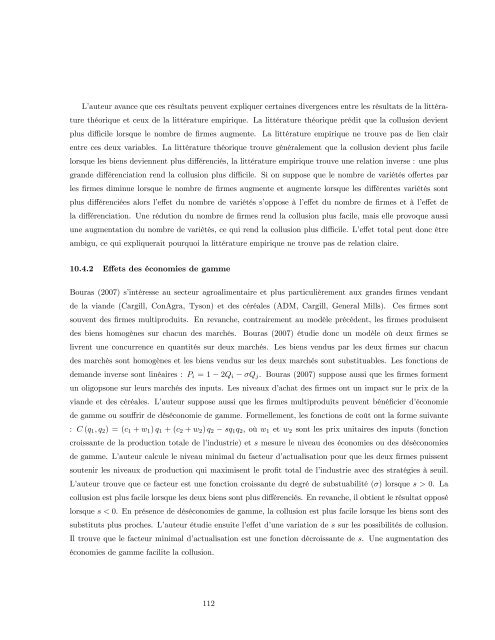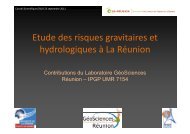Collusion - E-Cours - Université de la Réunion
Collusion - E-Cours - Université de la Réunion
Collusion - E-Cours - Université de la Réunion
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’auteur avance que ces résultats peuvent expliquer certaines divergences entre les résultats <strong>de</strong> <strong>la</strong> littératurethéorique et ceux <strong>de</strong> <strong>la</strong> littérature empirique. La littérature théorique prédit que <strong>la</strong> collusion <strong>de</strong>vientplus di¢ cile lorsque le nombre <strong>de</strong> …rmes augmente. La littérature empirique ne trouve pas <strong>de</strong> lien c<strong>la</strong>irentre ces <strong>de</strong>ux variables. La littérature théorique trouve généralement que <strong>la</strong> collusion <strong>de</strong>vient plus facilelorsque les biens <strong>de</strong>viennent plus di¤érenciés, <strong>la</strong> littérature empirique trouve une re<strong>la</strong>tion inverse : une plusgran<strong>de</strong> di¤érenciation rend <strong>la</strong> collusion plus di¢ cile. Si on suppose que le nombre <strong>de</strong> variétés o¤ertes parles …rmes diminue lorsque le nombre <strong>de</strong> …rmes augmente et augmente lorsque les di¤érentes variétés sontplus di¤érenciées alors l’e¤et du nombre <strong>de</strong> variétés s’oppose à l’e¤et du nombre <strong>de</strong> …rmes et à l’e¤et <strong>de</strong><strong>la</strong> di¤érenciation. Une rédution du nombre <strong>de</strong> …rmes rend <strong>la</strong> collusion plus facile, mais elle provoque aussiune augmentation du nombre <strong>de</strong> variétés, ce qui rend <strong>la</strong> collusion plus di¢ cile. L’e¤et total peut donc êtreambigu, ce qui expliquerait pourquoi <strong>la</strong> littérature empirique ne trouve pas <strong>de</strong> re<strong>la</strong>tion c<strong>la</strong>ire.10.4.2 E¤ets <strong>de</strong>s économies <strong>de</strong> gammeBouras (2007) s’intéresse au secteur agroalimentaire et plus particulièrement aux gran<strong>de</strong>s …rmes vendant<strong>de</strong> <strong>la</strong> vian<strong>de</strong> (Cargill, ConAgra, Tyson) et <strong>de</strong>s céréales (ADM, Cargill, General Mills). Ces …rmes sontsouvent <strong>de</strong>s …rmes multiproduits. En revanche, contrairement au modèle précé<strong>de</strong>nt, les …rmes produisent<strong>de</strong>s biens homogènes sur chacun <strong>de</strong>s marchés. Bouras (2007) étudie donc un modèle où <strong>de</strong>ux …rmes selivrent une concurrence en quantités sur <strong>de</strong>ux marchés. Les biens vendus par les <strong>de</strong>ux …rmes sur chacun<strong>de</strong>s marchés sont homogènes et les biens vendus sur les <strong>de</strong>ux marchés sont substituables. Les fonctions <strong>de</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> inverse sont linéaires : P i = 1 2Q i Q j . Bouras (2007) suppose aussi que les …rmes formentun oligopsone sur leurs marchés <strong>de</strong>s inputs. Les niveaux d’achat <strong>de</strong>s …rmes ont un impact sur le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong>vian<strong>de</strong> et <strong>de</strong>s céréales. L’auteur suppose aussi que les …rmes multiproduits peuvent béné…cier d’économie<strong>de</strong> gamme ou sou¤rir <strong>de</strong> déséconomie <strong>de</strong> gamme. Formellement, les fonctions <strong>de</strong> coût ont <strong>la</strong> forme suivante: C (q 1 ; q 2 ) = (c 1 + w 1 ) q 1 + (c 2 + w 2 ) q 2 sq 1 q 2 , où w 1 et w 2 sont les prix unitaires <strong>de</strong>s inputs (fonctioncroissante <strong>de</strong> <strong>la</strong> production totale <strong>de</strong> l’industrie) et s mesure le niveau <strong>de</strong>s économies ou <strong>de</strong>s déséconomies<strong>de</strong> gamme. L’auteur calcule le niveau minimal du facteur d’actualisation pour que les <strong>de</strong>ux …rmes puissentsoutenir les niveaux <strong>de</strong> production qui maximisent le pro…t total <strong>de</strong> l’industrie avec <strong>de</strong>s stratégies à seuil.L’auteur trouve que ce facteur est une fonction croissante du <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> substuabilité () lorsque s > 0. Lacollusion est plus facile lorsque les <strong>de</strong>ux biens sont plus di¤érenciés. En revanche, il obtient le résultat opposélorsque s < 0. En présence <strong>de</strong> déséconomies <strong>de</strong> gamme, <strong>la</strong> collusion est plus facile lorsque les biens sont <strong>de</strong>ssubstituts plus proches. L’auteur étudie ensuite l’e¤et d’une variation <strong>de</strong> s sur les possibilités <strong>de</strong> collusion.Il trouve que le facteur minimal d’actualisation est une fonction décroissante <strong>de</strong> s. Une augmentation <strong>de</strong>séconomies <strong>de</strong> gamme facilite <strong>la</strong> collusion.112