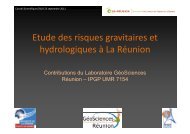Collusion - E-Cours - Université de la Réunion
Collusion - E-Cours - Université de la Réunion
Collusion - E-Cours - Université de la Réunion
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5.1 Problématiques générales5.1.1 Problème <strong>de</strong> coordinationLorsque les …rmes sont symétriques, il est assez naturel <strong>de</strong> sélectionner un équilibre qui attribue <strong>de</strong>s parts <strong>de</strong>marchés égales aux di¤érentes …rmes. Lorsque les …rmes sont asymétriques, <strong>la</strong> désignation d’un ”point focal”est nettement moins évi<strong>de</strong>nte. Les réponses à ce problème varient beaucoup dans <strong>la</strong> littérature économiqueexistante.Davidson et Deneckere (1990) considèrent que si <strong>de</strong>ux …rmes ont <strong>de</strong>s capacités di¤érentes, elles se partagentle marché proportionnellement à leurs capacités. Pénard (1997), dans un modèle simi<strong>la</strong>ire, considèreque, si les capacités sont su¢ santes pour servir le marché, le partage du marché ne dépend pas <strong>de</strong>s capacités<strong>de</strong>s …rmes. Bae (1987) étudie l’accord <strong>de</strong> collusion entre <strong>de</strong>ux …rmes ayant <strong>de</strong>s coûts di¤érents et postule queles …rmes maximisent leur pro…t joint et se partagent le marché <strong>de</strong> manière telle que leurs incitations à trichersoient égales. D’autres étu<strong>de</strong>s proposent d’appliquer une axiomatique <strong>de</strong> marchandage. Osborne et Pitchik(1983, 1987) appliquent <strong>la</strong> règle proposée par Nash (1950) pour étudier les caractéristiques <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong>collusion entre <strong>de</strong>ux …rmes ayant <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> production di¤érentes. Jehiel (1992) a recours à cette règlepour étudier les accords collusoires entre <strong>de</strong>ux …rmes produisant <strong>de</strong>s biens di¤érenciés. Schmalensee (1987)utilise <strong>la</strong> même procédure dans un modèle où les …rmes ont <strong>de</strong>s coûts di¤érents. Il étudie aussi d’autres règles<strong>de</strong> partage, notamment <strong>la</strong> règle proposée par Ka<strong>la</strong>i et Smorodinsky (1975). Cette règle alternative est plusdélicate à manier et peut nécessiter le recours au calcul numérique 14 . La faiblesse <strong>de</strong> ces premières étu<strong>de</strong>sest <strong>de</strong> ne pas tenir compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrainte d’incitation à ne pas dévier <strong>de</strong>s …rmes. Les accords collusoirescaractérisés par Osborne et Pitchik, Jehiel et Schmalensee ne sont <strong>de</strong>s équilibres <strong>de</strong> Nash parfaits que sile taux d’actualisation est su¢ sament élevé. Il revient à Harrington (1989, 1991) d’avoir réintroduit cescontraintes dans un modèle <strong>de</strong> collusion entre <strong>de</strong>s …rmes asymétriques se partageant le marché selon <strong>la</strong> règle<strong>de</strong> marchandage <strong>de</strong> Nash. Dans <strong>la</strong> première étu<strong>de</strong>, les …rmes di¤èrent par leur taux d’actualisation, tandisque dans <strong>la</strong> secon<strong>de</strong>, l’asymétrie porte sur les coûts <strong>de</strong> production. La règle <strong>de</strong> partage est, alors, in‡uencéepar les possibilités <strong>de</strong> collusion tacite. Il faut, parfois, transférer <strong>de</strong>s parts <strong>de</strong> marché d’une …rme vers uneautre pour que l’accord <strong>de</strong>meure soutenable.Les économistes ne sont, donc, pas unanimes sur <strong>la</strong> solution "naturelle" qui <strong>de</strong>vrait émerger. Il est, donc,probable que les dirigeants <strong>de</strong>s …rmes n’ont pas, non plus, tous <strong>la</strong> même vision <strong>de</strong> ce que <strong>de</strong>vrait être un"juste" partage du marché. Il semble raisonnable que les …rmes les plus "puissantes" obtiennent une part <strong>de</strong>14 Le problème peut encore se compliquer si les …rmes ne peuvent pas parfaitement observerles caractéristiques <strong>de</strong> leurs concurrentes. Une …rme peut, par exemple, savoir que le coûtd’une <strong>de</strong> ses concurrentes est di¤érent car elle utilise un autre processus <strong>de</strong> production maisne pas connaître <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> ce coût. Les …rmes doivent, alors, utiliser <strong>de</strong>s mécanismesincitatifs pour apprendre les véritables caractéristiques <strong>de</strong> leurs concurrentes (Roberts, 1985 ;Cramton et Palfrey, 1990 ; McAfee et McMil<strong>la</strong>n, 1992 ; Kihlstrom et Vives, 1992).33