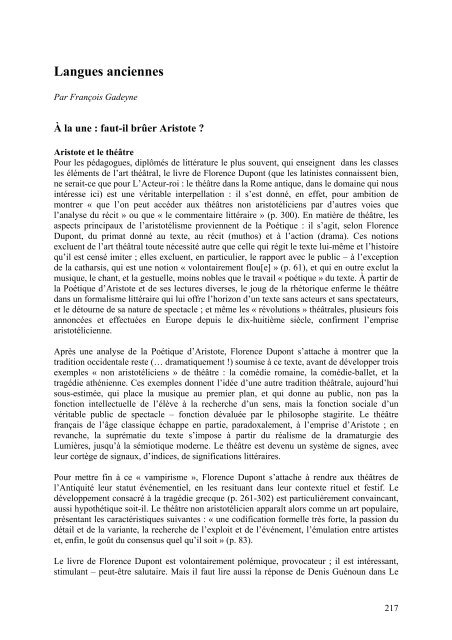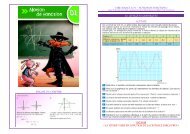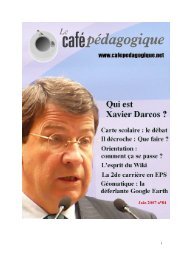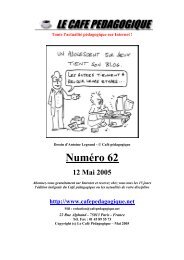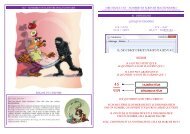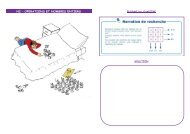Le numéro intégral au format pdf (300 pages , 6 Mo) - Café ...
Le numéro intégral au format pdf (300 pages , 6 Mo) - Café ...
Le numéro intégral au format pdf (300 pages , 6 Mo) - Café ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Langues anciennes<br />
Par François Gadeyne<br />
À la une : f<strong>au</strong>t-il brûer Aristote ?<br />
Aristote et le théâtre<br />
Pour les pédagogues, diplômés de littérature le plus souvent, qui enseignent dans les classes<br />
les éléments de l’art théâtral, le livre de Florence Dupont (que les latinistes connaissent bien,<br />
ne serait-ce que pour L’Acteur-roi : le théâtre dans la Rome antique, dans le domaine qui nous<br />
intéresse ici) est une véritable interpellation : il s’est donné, en effet, pour ambition de<br />
montrer « que l’on peut accéder <strong>au</strong>x théâtres non aristotéliciens par d’<strong>au</strong>tres voies que<br />
l’analyse du récit » ou que « le commentaire littéraire » (p. <strong>300</strong>). En matière de théâtre, les<br />
aspects princip<strong>au</strong>x de l’aristotélisme proviennent de la Poétique : il s’agit, selon Florence<br />
Dupont, du primat donné <strong>au</strong> texte, <strong>au</strong> récit (muthos) et à l’action (drama). Ces notions<br />
excluent de l’art théâtral toute nécessité <strong>au</strong>tre que celle qui régit le texte lui-même et l’histoire<br />
qu’il est censé imiter ; elles excluent, en particulier, le rapport avec le public – à l’exception<br />
de la catharsis, qui est une notion « volontairement flou[e] » (p. 61), et qui en outre exclut la<br />
musique, le chant, et la gestuelle, moins nobles que le travail « poétique » du texte. À partir de<br />
la Poétique d’Aristote et de ses lectures diverses, le joug de la rhétorique enferme le théâtre<br />
dans un formalisme littéraire qui lui offre l’horizon d’un texte sans acteurs et sans spectateurs,<br />
et le détourne de sa nature de spectacle ; et même les « révolutions » théâtrales, plusieurs fois<br />
annoncées et effectuées en Europe depuis le dix-huitième siècle, confirment l’emprise<br />
aristotélicienne.<br />
Après une analyse de la Poétique d’Aristote, Florence Dupont s’attache à montrer que la<br />
tradition occidentale reste (… dramatiquement !) soumise à ce texte, avant de développer trois<br />
exemples « non aristotéliciens » de théâtre : la comédie romaine, la comédie-ballet, et la<br />
tragédie athénienne. Ces exemples donnent l’idée d’une <strong>au</strong>tre tradition théâtrale, <strong>au</strong>jourd’hui<br />
sous-estimée, qui place la musique <strong>au</strong> premier plan, et qui donne <strong>au</strong> public, non pas la<br />
fonction intellectuelle de l’élève à la recherche d’un sens, mais la fonction sociale d’un<br />
véritable public de spectacle – fonction dévaluée par le philosophe stagirite. <strong>Le</strong> théâtre<br />
français de l’âge classique échappe en partie, paradoxalement, à l’emprise d’Aristote ; en<br />
revanche, la suprématie du texte s’impose à partir du réalisme de la dramaturgie des<br />
Lumières, jusqu’à la sémiotique moderne. <strong>Le</strong> théâtre est devenu un système de signes, avec<br />
leur cortège de sign<strong>au</strong>x, d’indices, de significations littéraires.<br />
Pour mettre fin à ce « vampirisme », Florence Dupont s’attache à rendre <strong>au</strong>x théâtres de<br />
l’Antiquité leur statut événementiel, en les resituant dans leur contexte rituel et festif. <strong>Le</strong><br />
développement consacré à la tragédie grecque (p. 261-302) est particulièrement convaincant,<br />
<strong>au</strong>ssi hypothétique soit-il. <strong>Le</strong> théâtre non aristotélicien apparaît alors comme un art populaire,<br />
présentant les caractéristiques suivantes : « une codification formelle très forte, la passion du<br />
détail et de la variante, la recherche de l’exploit et de l’événement, l’émulation entre artistes<br />
et, enfin, le goût du consensus quel qu’il soit » (p. 83).<br />
<strong>Le</strong> livre de Florence Dupont est volontairement polémique, provocateur ; il est intéressant,<br />
stimulant – peut-être salutaire. Mais il f<strong>au</strong>t lire <strong>au</strong>ssi la réponse de Denis Guénoun dans <strong>Le</strong><br />
217