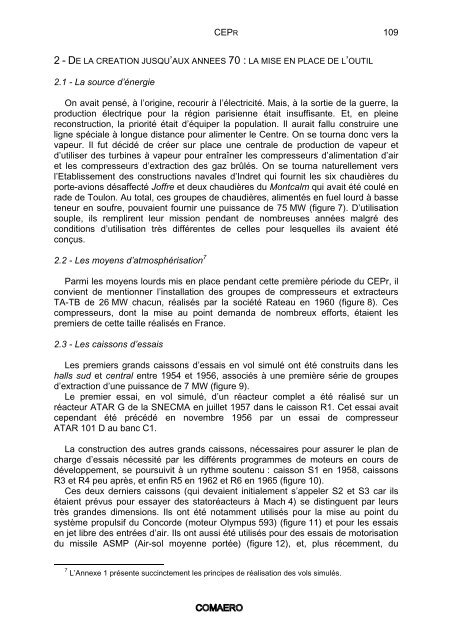Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CEPR 109<br />
2 - DE LA CREATION JUSQU’AUX ANNEES 70 : LA MISE EN PLACE DE L’OUTIL<br />
2.1 - La source d’énergie<br />
On avait pensé, à l’origine, recourir à l’électricité. Mais, à la sortie de la guerre, la<br />
production électrique pour la région parisienne était insuffisante. Et, en pleine<br />
reconstruction, la priorité était d’équiper la population. Il aurait fallu construire une<br />
ligne spéciale à longue distance pour alimenter le Centre. On se tourna donc vers la<br />
vapeur. Il fut décidé de créer sur place une centrale de production de vapeur <strong>et</strong><br />
d’utiliser des turbines à vapeur pour entraîner les compresseurs d’alimentation d’air<br />
<strong>et</strong> les compresseurs d’extraction des gaz brûlés. On se tourna naturellement vers<br />
l’Etablissement des constructions navales d’Indr<strong>et</strong> qui fournit les six chaudières du<br />
porte-avions désaffecté Joffre <strong>et</strong> deux chaudières du Montcalm qui avait été coulé en<br />
rade de Toulon. Au total, ces groupes de chaudières, alimentés en fuel lourd à basse<br />
teneur en soufre, pouvaient fournir une puissance de 75 MW (figure 7). D’utilisation<br />
souple, ils remplirent leur mission pendant de nombreuses années malgré des<br />
conditions d’utilisation très différentes de celles pour lesquelles ils avaient été<br />
conçus.<br />
2.2 - Les <strong>moyens</strong> d’atmosphérisation 7<br />
Parmi les <strong>moyens</strong> lourds mis en place pendant c<strong>et</strong>te première période du CEPr, il<br />
convient de mentionner l’installation des groupes de compresseurs <strong>et</strong> extracteurs<br />
TA-TB de 26 MW chacun, réalisés par la société Rateau en 1960 (figure 8). Ces<br />
compresseurs, dont la mise au point demanda de nombreux efforts, étaient les<br />
premiers de c<strong>et</strong>te taille réalisés en France.<br />
2.3 - Les caissons d’essais<br />
Les premiers grands caissons d’essais en vol simulé ont été construits dans les<br />
halls sud <strong>et</strong> central entre 1954 <strong>et</strong> 1956, associés à une première série de groupes<br />
d’extraction d’une puissance de 7 MW (figure 9).<br />
Le premier essai, en vol simulé, d’un réacteur compl<strong>et</strong> a été réalisé sur un<br />
réacteur ATAR G de la SNECMA en juill<strong>et</strong> 1957 dans le caisson R1. C<strong>et</strong> essai avait<br />
cependant été précédé en novembre 1956 par un essai de compresseur<br />
ATAR 101 D au banc C1.<br />
La construction des autres grands caissons, nécessaires pour assurer le plan de<br />
charge d’essais nécessité par les différents programmes de moteurs en cours de<br />
développement, se poursuivit à un rythme soutenu : caisson S1 en 1958, caissons<br />
R3 <strong>et</strong> R4 peu après, <strong>et</strong> enfin R5 en 1962 <strong>et</strong> R6 en 1965 (figure 10).<br />
Ces deux derniers caissons (qui devaient initialement s’appeler S2 <strong>et</strong> S3 car ils<br />
étaient prévus pour essayer des statoréacteurs à Mach 4) se distinguent par leurs<br />
très grandes dimensions. Ils ont été notamment utilisés pour la mise au point du<br />
système propulsif du Concorde (moteur Olympus 593) (figure 11) <strong>et</strong> pour les essais<br />
en j<strong>et</strong> libre des entrées d’air. Ils ont aussi été utilisés pour des essais de motorisation<br />
du missile ASMP (Air-sol moyenne portée) (figure 12), <strong>et</strong>, plus récemment, du<br />
7 L’Annexe 1 présente succinctement les principes de réalisation des vols simulés.