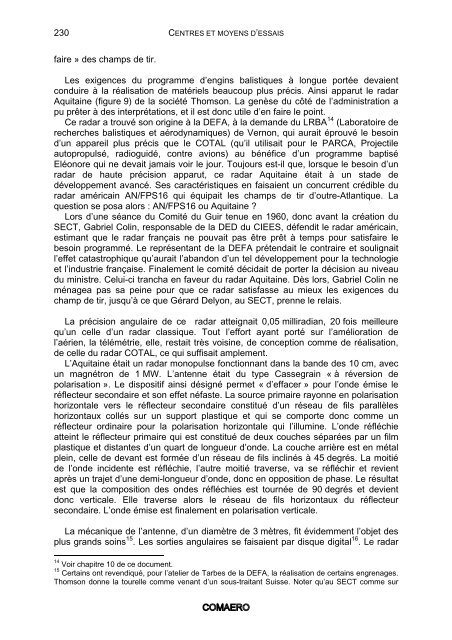Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
230<br />
faire » des champs de tir.<br />
CENTRES ET MOYENS D’ESSAIS<br />
Les exigences du programme d’engins balistiques à longue portée devaient<br />
conduire à la réalisation de matériels beaucoup plus précis. Ainsi apparut le radar<br />
Aquitaine (figure 9) de la société Thomson. La genèse du côté de l’administration a<br />
pu prêter à des interprétations, <strong>et</strong> il est donc utile d’en faire le point.<br />
Ce radar a trouvé son origine à la DEFA, à la demande du LRBA 14 (Laboratoire de<br />
recherches balistiques <strong>et</strong> aérodynamiques) de Vernon, qui aurait éprouvé le besoin<br />
d’un appareil plus précis que le COTAL (qu’il utilisait pour le PARCA, Projectile<br />
autopropulsé, radioguidé, contre avions) au bénéfice d’un programme baptisé<br />
Eléonore qui ne devait jamais voir le jour. Toujours est-il que, lorsque le besoin d’un<br />
radar de haute précision apparut, ce radar Aquitaine était à un stade de<br />
développement avancé. Ses caractéristiques en faisaient un concurrent crédible du<br />
radar américain AN/FPS16 qui équipait les champs de tir d’outre-Atlantique. La<br />
question se posa alors : AN/FPS16 ou Aquitaine ?<br />
Lors d’une séance du Comité du Guir tenue en 1960, donc avant la création du<br />
SECT, Gabriel Colin, responsable de la DED du CIEES, défendit le radar américain,<br />
estimant que le radar français ne pouvait pas être prêt à temps pour satisfaire le<br />
besoin programmé. Le représentant de la DEFA prétendait le contraire <strong>et</strong> soulignait<br />
l’eff<strong>et</strong> catastrophique qu’aurait l’abandon d’un tel développement pour la technologie<br />
<strong>et</strong> l’industrie française. Finalement le comité décidait de porter la décision au niveau<br />
du ministre. Celui-ci trancha en faveur du radar Aquitaine. Dès lors, Gabriel Colin ne<br />
ménagea pas sa peine pour que ce radar satisfasse au mieux les exigences du<br />
champ de tir, jusqu’à ce que Gérard Delyon, au SECT, prenne le relais.<br />
La précision angulaire de ce radar atteignait 0,05 milliradian, 20 fois meilleure<br />
qu’un celle d’un radar classique. Tout l’effort ayant porté sur l’amélioration de<br />
l’aérien, la télémétrie, elle, restait très voisine, de conception comme de réalisation,<br />
de celle du radar COTAL, ce qui suffisait amplement.<br />
L’Aquitaine était un radar monopulse fonctionnant dans la bande des 10 cm, avec<br />
un magnétron de 1 MW. L’antenne était du type Cassegrain « à réversion de<br />
polarisation ». Le dispositif ainsi désigné perm<strong>et</strong> « d’effacer » pour l’onde émise le<br />
réflecteur secondaire <strong>et</strong> son eff<strong>et</strong> néfaste. La source primaire rayonne en polarisation<br />
horizontale vers le réflecteur secondaire constitué d’un réseau de fils parallèles<br />
horizontaux collés sur un support plastique <strong>et</strong> qui se comporte donc comme un<br />
réflecteur ordinaire pour la polarisation horizontale qui l’illumine. L’onde réfléchie<br />
atteint le réflecteur primaire qui est constitué de deux couches séparées par un film<br />
plastique <strong>et</strong> distantes d’un quart de longueur d’onde. La couche arrière est en métal<br />
plein, celle de devant est formée d’un réseau de fils inclinés à 45 degrés. La moitié<br />
de l’onde incidente est réfléchie, l’autre moitié traverse, va se réfléchir <strong>et</strong> revient<br />
après un traj<strong>et</strong> d’une demi-longueur d’onde, donc en opposition de phase. Le résultat<br />
est que la composition des ondes réfléchies est tournée de 90 degrés <strong>et</strong> devient<br />
donc verticale. Elle traverse alors le réseau de fils horizontaux du réflecteur<br />
secondaire. L’onde émise est finalement en polarisation verticale.<br />
La mécanique de l’antenne, d’un diamètre de 3 mètres, fit évidemment l’obj<strong>et</strong> des<br />
plus grands soins 15 . Les sorties angulaires se faisaient par disque digital 16 . Le radar<br />
14 Voir chapitre 10 de ce document.<br />
15 Certains ont revendiqué, pour l’atelier de Tarbes de la DEFA, la réalisation de certains engrenages.<br />
Thomson donne la tourelle comme venant d’un sous-traitant Suisse. Noter qu’au SECT comme sur