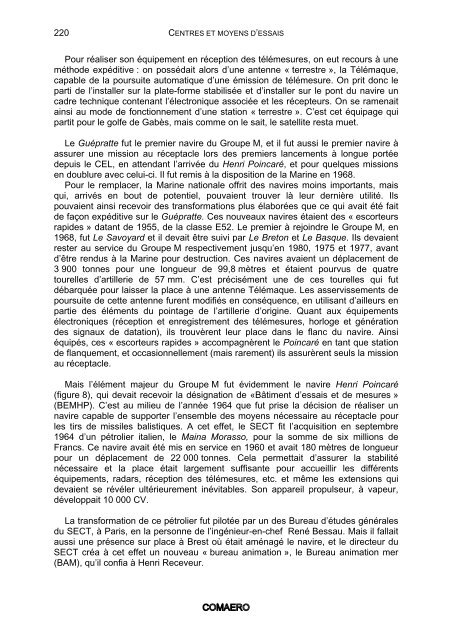Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
220<br />
CENTRES ET MOYENS D’ESSAIS<br />
Pour réaliser son équipement en réception des télémesures, on eut recours à une<br />
méthode expéditive : on possédait alors d’une antenne « terrestre », la Télémaque,<br />
capable de la poursuite automatique d’une émission de télémesure. On prit donc le<br />
parti de l’installer sur la plate-forme stabilisée <strong>et</strong> d’installer sur le pont du navire un<br />
cadre technique contenant l’électronique associée <strong>et</strong> les récepteurs. On se ramenait<br />
ainsi au mode de fonctionnement d’une station « terrestre ». C’est c<strong>et</strong> équipage qui<br />
partit pour le golfe de Gabès, mais comme on le sait, le satellite resta mu<strong>et</strong>.<br />
Le Guépratte fut le premier navire du Groupe M, <strong>et</strong> il fut aussi le premier navire à<br />
assurer une mission au réceptacle lors des premiers lancements à longue portée<br />
depuis le CEL, en attendant l’arrivée du Henri Poincaré, <strong>et</strong> pour quelques missions<br />
en doublure avec celui-ci. Il fut remis à la disposition de la Marine en 1968.<br />
Pour le remplacer, la Marine nationale offrit des navires moins importants, mais<br />
qui, arrivés en bout de potentiel, pouvaient trouver là leur dernière utilité. Ils<br />
pouvaient ainsi recevoir des transformations plus élaborées que ce qui avait été fait<br />
de façon expéditive sur le Guépratte. Ces nouveaux navires étaient des « escorteurs<br />
rapides » datant de 1955, de la classe E52. Le premier à rejoindre le Groupe M, en<br />
1968, fut Le Savoyard <strong>et</strong> il devait être suivi par Le Br<strong>et</strong>on <strong>et</strong> Le Basque. Ils devaient<br />
rester au service du Groupe M respectivement jusqu’en 1980, 1975 <strong>et</strong> 1977, avant<br />
d’être rendus à la Marine pour destruction. Ces navires avaient un déplacement de<br />
3 900 tonnes pour une longueur de 99,8 mètres <strong>et</strong> étaient pourvus de quatre<br />
tourelles d’artillerie de 57 mm. C’est précisément une de ces tourelles qui fut<br />
débarquée pour laisser la place à une antenne Télémaque. Les asservissements de<br />
poursuite de c<strong>et</strong>te antenne furent modifiés en conséquence, en utilisant d’ailleurs en<br />
partie des éléments du pointage de l’artillerie d’origine. Quant aux équipements<br />
électroniques (réception <strong>et</strong> enregistrement des télémesures, horloge <strong>et</strong> génération<br />
des signaux de datation), ils trouvèrent leur place dans le flanc du navire. Ainsi<br />
équipés, ces « escorteurs rapides » accompagnèrent le Poincaré en tant que station<br />
de flanquement, <strong>et</strong> occasionnellement (mais rarement) ils assurèrent seuls la mission<br />
au réceptacle.<br />
Mais l’élément majeur du Groupe M fut évidemment le navire Henri Poincaré<br />
(figure 8), qui devait recevoir la désignation de «Bâtiment d’essais <strong>et</strong> de mesures »<br />
(BEMHP). C’est au milieu de l’année 1964 que fut prise la décision de réaliser un<br />
navire capable de supporter l’ensemble des <strong>moyens</strong> nécessaire au réceptacle pour<br />
les tirs de missiles balistiques. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, le SECT fit l’acquisition en septembre<br />
1964 d’un pétrolier italien, le Maina Morasso, pour la somme de six millions de<br />
Francs. Ce navire avait été mis en service en 1960 <strong>et</strong> avait 180 mètres de longueur<br />
pour un déplacement de 22 000 tonnes. Cela perm<strong>et</strong>tait d’assurer la stabilité<br />
nécessaire <strong>et</strong> la place était largement suffisante pour accueillir les différents<br />
équipements, radars, réception des télémesures, <strong>et</strong>c. <strong>et</strong> même les extensions qui<br />
devaient se révéler ultérieurement inévitables. Son appareil propulseur, à vapeur,<br />
développait 10 000 CV.<br />
La transformation de ce pétrolier fut pilotée par un des Bureau d’études générales<br />
du SECT, à Paris, en la personne de l’ingénieur-en-chef René Bessau. Mais il fallait<br />
aussi une présence sur place à Brest où était aménagé le navire, <strong>et</strong> le directeur du<br />
SECT créa à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> un nouveau « bureau animation », le Bureau animation mer<br />
(BAM), qu’il confia à Henri Receveur.