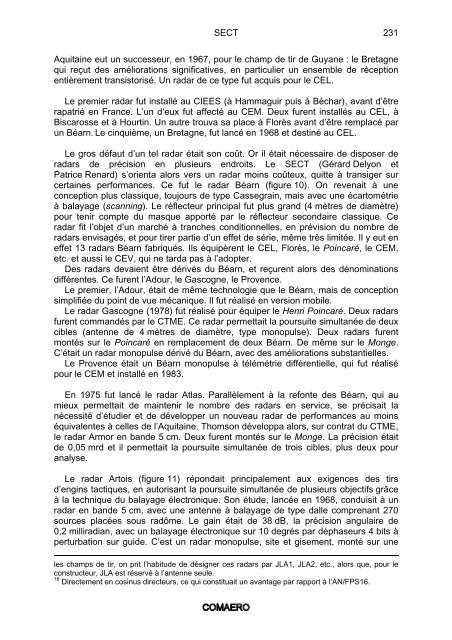Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SECT 231<br />
Aquitaine eut un successeur, en 1967, pour le champ de tir de Guyane : le Br<strong>et</strong>agne<br />
qui reçut des améliorations significatives, en particulier un ensemble de réception<br />
entièrement transistorisé. Un radar de ce type fut acquis pour le CEL.<br />
Le premier radar fut installé au CIEES (à Hammaguir puis à Béchar), avant d’être<br />
rapatrié en France. L’un d‘eux fut affecté au CEM. Deux furent installés au CEL, à<br />
Biscarosse <strong>et</strong> à Hourtin. Un autre trouva sa place à Florès avant d’être remplacé par<br />
un Béarn. . Le cinquième, un Br<strong>et</strong>agne, fut lancé en 1968 <strong>et</strong> destiné au CEL.<br />
Le gros défaut d’un tel radar était son coût. Or il était nécessaire de disposer de<br />
radars de précision en plusieurs endroits. Le SECT (Gérard Delyon <strong>et</strong><br />
Patrice Renard) s’orienta alors vers un radar moins coûteux, quitte à transiger sur<br />
certaines performances. Ce fut le radar Béarn (figure 10). On revenait à une<br />
conception plus classique, toujours de type Cassegrain, mais avec une écartométrie<br />
à balayage (scanning). Le réflecteur principal fut plus grand (4 mètres de diamètre)<br />
pour tenir compte du masque apporté par le réflecteur secondaire classique. Ce<br />
radar fit l’obj<strong>et</strong> d’un marché à tranches conditionnelles, en prévision du nombre de<br />
radars envisagés, <strong>et</strong> pour tirer partie d’un eff<strong>et</strong> de série, même très limitée. Il y eut en<br />
eff<strong>et</strong> 13 radars Béarn fabriqués. Ils équipèrent le CEL, Florès, le Poincaré, le CEM,<br />
<strong>et</strong>c. <strong>et</strong> aussi le CEV, qui ne tarda pas à l’adopter.<br />
Des radars devaient être dérivés du Béarn, <strong>et</strong> reçurent alors des dénominations<br />
différentes. Ce furent l’Adour, le Gascogne, le Provence.<br />
Le premier, l’Adour, était de même technologie que le Béarn, mais de conception<br />
simplifiée du point de vue mécanique. Il fut réalisé en version mobile.<br />
Le radar Gascogne (1978) fut réalisé pour équiper le Henri Poincaré. Deux radars<br />
furent commandés par le CTME. Ce radar perm<strong>et</strong>tait la poursuite simultanée de deux<br />
cibles (antenne de 4 mètres de diamètre, type monopulse). Deux radars furent<br />
montés sur le Poincaré en remplacement de deux Béarn. De même sur le Monge.<br />
C’était un radar monopulse dérivé du Béarn, avec des améliorations substantielles.<br />
Le Provence était un Béarn monopulse à télémétrie différentielle, qui fut réalisé<br />
pour le CEM <strong>et</strong> installé en 1983.<br />
En 1975 fut lancé le radar Atlas. Parallèlement à la refonte des Béarn, qui au<br />
mieux perm<strong>et</strong>tait de maintenir le nombre des radars en service, se précisait la<br />
nécessité d’étudier <strong>et</strong> de développer un nouveau radar de performances au moins<br />
équivalentes à celles de l’Aquitaine. Thomson développa alors, sur contrat du CTME,<br />
le radar Armor en bande 5 cm. Deux furent montés sur le Monge. La précision était<br />
de 0,05 mrd <strong>et</strong> il perm<strong>et</strong>tait la poursuite simultanée de trois cibles, plus deux pour<br />
analyse.<br />
Le radar Artois (figure 11) répondait principalement aux exigences des tirs<br />
d’engins tactiques, en autorisant la poursuite simultanée de plusieurs objectifs grâce<br />
à la technique du balayage électronique. Son étude, lancée en 1968, conduisit à un<br />
radar en bande 5 cm, avec une antenne à balayage de type dalle comprenant 270<br />
sources placées sous radôme. Le gain était de 38 dB, la précision angulaire de<br />
0,2 milliradian, avec un balayage électronique sur 10 degrés par déphaseurs 4 bits à<br />
perturbation sur guide. C’est un radar monopulse, site <strong>et</strong> gisement, monté sur une<br />
les champs de tir, on prit l’habitude de désigner ces radars par JLA1, JLA2, <strong>et</strong>c., alors que, pour le<br />
constructeur, JLA est réservé à l’antenne seule.<br />
16 Directement en cosinus directeurs, ce qui constituait un avantage par rapport à l’AN/FPS16.