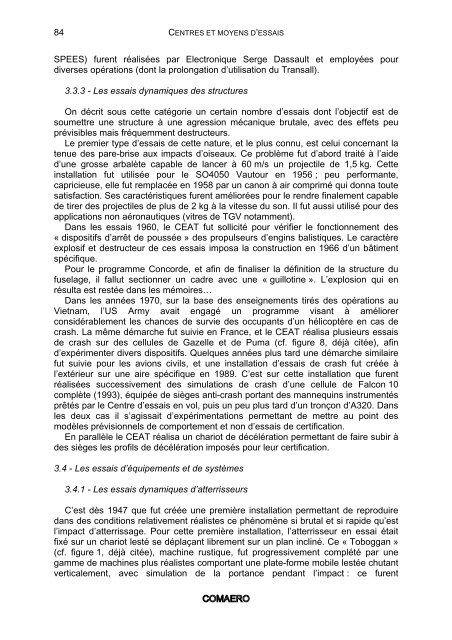Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
84<br />
CENTRES ET MOYENS D’ESSAIS<br />
SPEES) furent réalisées par Electronique Serge Dassault <strong>et</strong> employées pour<br />
diverses opérations (dont la prolongation d’utilisation du Transall).<br />
3.3.3 - Les essais dynamiques des structures<br />
On décrit sous c<strong>et</strong>te catégorie un certain nombre d’essais dont l’objectif est de<br />
soum<strong>et</strong>tre une structure à une agression mécanique brutale, avec des eff<strong>et</strong>s peu<br />
prévisibles mais fréquemment destructeurs.<br />
Le premier type d’essais de c<strong>et</strong>te nature, <strong>et</strong> le plus connu, est celui concernant la<br />
tenue des pare-brise aux impacts d’oiseaux. Ce problème fut d’abord traité à l’aide<br />
d’une grosse arbalète capable de lancer à 60 m/s un projectile de 1,5 kg. C<strong>et</strong>te<br />
installation fut utilisée pour le SO4050 Vautour en 1956 ; peu performante,<br />
capricieuse, elle fut remplacée en 1958 par un canon à air comprimé qui donna toute<br />
satisfaction. Ses caractéristiques furent améliorées pour le rendre finalement capable<br />
de tirer des projectiles de plus de 2 kg à la vitesse du son. Il fut aussi utilisé pour des<br />
applications non aéronautiques (vitres de TGV notamment).<br />
Dans les essais 1960, le CEAT fut sollicité pour vérifier le fonctionnement des<br />
« dispositifs d’arrêt de poussée » des propulseurs d’engins balistiques. Le caractère<br />
explosif <strong>et</strong> destructeur de ces essais imposa la construction en 1966 d’un bâtiment<br />
spécifique.<br />
Pour le programme Concorde, <strong>et</strong> afin de finaliser la définition de la structure du<br />
fuselage, il fallut sectionner un cadre avec une « guillotine ». L’explosion qui en<br />
résulta est restée dans les mémoires…<br />
Dans les années 1970, sur la base des enseignements tirés des opérations au<br />
Vi<strong>et</strong>nam, l’US Army avait engagé un programme visant à améliorer<br />
considérablement les chances de survie des occupants d’un hélicoptère en cas de<br />
crash. La même démarche fut suivie en France, <strong>et</strong> le CEAT réalisa plusieurs essais<br />
de crash sur des cellules de Gazelle <strong>et</strong> de Puma (cf. figure 8, déjà citée), afin<br />
d’expérimenter divers dispositifs. Quelques années plus tard une démarche similaire<br />
fut suivie pour les avions civils, <strong>et</strong> une installation d’essais de crash fut créée à<br />
l’extérieur sur une aire spécifique en 1989. C’est sur c<strong>et</strong>te installation que furent<br />
réalisées successivement des simulations de crash d’une cellule de Falcon 10<br />
complète (1993), équipée de sièges anti-crash portant des mannequins instrumentés<br />
prêtés par le Centre d’essais en vol, puis un peu plus tard d’un tronçon d’A320. Dans<br />
les deux cas il s’agissait d’expérimentations perm<strong>et</strong>tant de m<strong>et</strong>tre au point des<br />
modèles prévisionnels de comportement <strong>et</strong> non d’essais de certification.<br />
En parallèle le CEAT réalisa un chariot de décélération perm<strong>et</strong>tant de faire subir à<br />
des sièges les profils de décélération imposés pour leur certification.<br />
3.4 - Les essais d’équipements <strong>et</strong> de systèmes<br />
3.4.1 - Les essais dynamiques d’atterrisseurs<br />
C’est dès 1947 que fut créée une première installation perm<strong>et</strong>tant de reproduire<br />
dans des conditions relativement réalistes ce phénomène si brutal <strong>et</strong> si rapide qu’est<br />
l’impact d’atterrissage. Pour c<strong>et</strong>te première installation, l’atterrisseur en essai était<br />
fixé sur un chariot lesté se déplaçant librement sur un plan incliné. Ce « Toboggan »<br />
(cf. figure 1, déjà citée), machine rustique, fut progressivement complété par une<br />
gamme de machines plus réalistes comportant une plate-forme mobile lestée chutant<br />
verticalement, avec simulation de la portance pendant l’impact : ce furent