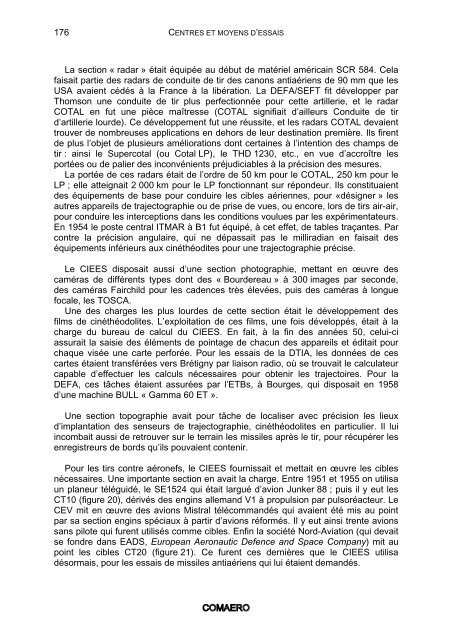Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
176<br />
CENTRES ET MOYENS D’ESSAIS<br />
La section « radar » était équipée au début de matériel américain SCR 584. Cela<br />
faisait partie des radars de conduite de tir des canons antiaériens de 90 mm que les<br />
USA avaient cédés à la France à la libération. La DEFA/SEFT fit développer par<br />
Thomson une conduite de tir plus perfectionnée pour c<strong>et</strong>te artillerie, <strong>et</strong> le radar<br />
COTAL en fut une pièce maîtresse (COTAL signifiait d’ailleurs Conduite de tir<br />
d’artillerie lourde). Ce développement fut une réussite, <strong>et</strong> les radars COTAL devaient<br />
trouver de nombreuses applications en dehors de leur destination première. Ils firent<br />
de plus l’obj<strong>et</strong> de plusieurs améliorations dont certaines à l’intention des champs de<br />
tir : ainsi le Supercotal (ou Cotal LP), le THD 1230, <strong>et</strong>c., en vue d’accroître les<br />
portées ou de palier des inconvénients préjudiciables à la précision des mesures.<br />
La portée de ces radars était de l’ordre de 50 km pour le COTAL, 250 km pour le<br />
LP ; elle atteignait 2 000 km pour le LP fonctionnant sur répondeur. Ils constituaient<br />
des équipements de base pour conduire les cibles aériennes, pour «désigner » les<br />
autres appareils de trajectographie ou de prise de vues, ou encore, lors de tirs air-air,<br />
pour conduire les interceptions dans les conditions voulues par les expérimentateurs.<br />
En 1954 le poste central ITMAR à B1 fut équipé, à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, de tables traçantes. Par<br />
contre la précision angulaire, qui ne dépassait pas le milliradian en faisait des<br />
équipements inférieurs aux cinéthéodites pour une trajectographie précise.<br />
Le CIEES disposait aussi d’une section photographie, m<strong>et</strong>tant en œuvre des<br />
caméras de différents types dont des « Bourdereau » à 300 images par seconde,<br />
des caméras Fairchild pour les cadences très élevées, puis des caméras à longue<br />
focale, les TOSCA.<br />
Une des charges les plus lourdes de c<strong>et</strong>te section était le développement des<br />
films de cinéthéodolites. L’exploitation de ces films, une fois développés, était à la<br />
charge du bureau de calcul du CIEES. En fait, à la fin des années 50, celui-ci<br />
assurait la saisie des éléments de pointage de chacun des appareils <strong>et</strong> éditait pour<br />
chaque visée une carte perforée. Pour les essais de la DTIA, les données de ces<br />
cartes étaient transférées vers Brétigny par liaison radio, où se trouvait le calculateur<br />
capable d’effectuer les calculs nécessaires pour obtenir les trajectoires. Pour la<br />
DEFA, ces tâches étaient assurées par l’ETBs, à Bourges, qui disposait en 1958<br />
d’une machine BULL « Gamma 60 ET ».<br />
Une section topographie avait pour tâche de localiser avec précision les lieux<br />
d’implantation des senseurs de trajectographie, cinéthéodolites en particulier. Il lui<br />
incombait aussi de r<strong>et</strong>rouver sur le terrain les missiles après le tir, pour récupérer les<br />
enregistreurs de bords qu’ils pouvaient contenir.<br />
Pour les tirs contre aéronefs, le CIEES fournissait <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tait en œuvre les cibles<br />
nécessaires. Une importante section en avait la charge. Entre 1951 <strong>et</strong> 1955 on utilisa<br />
un planeur téléguidé, le SE1524 qui était largué d’avion Junker 88 ; puis il y eut les<br />
CT10 (figure 20), dérivés des engins allemand V1 à propulsion par pulsoréacteur. Le<br />
CEV mit en œuvre des avions Mistral télécommandés qui avaient été mis au point<br />
par sa section engins spéciaux à partir d’avions réformés. Il y eut ainsi trente avions<br />
sans pilote qui furent utilisés comme cibles. Enfin la société Nord-Aviation (qui devait<br />
se fondre dans EADS, European Aeronautic Defence and Space Company) mit au<br />
point les cibles CT20 (figure 21). Ce furent ces dernières que le CIEES utilisa<br />
désormais, pour les essais de missiles antiaériens qui lui étaient demandés.