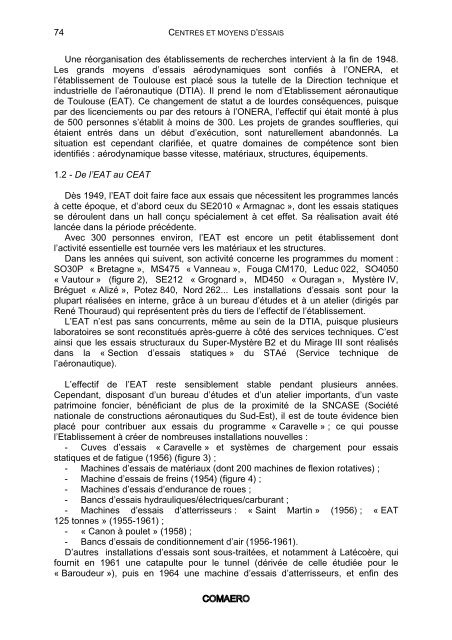Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
74<br />
CENTRES ET MOYENS D’ESSAIS<br />
Une réorganisation des établissements de recherches intervient à la fin de 1948.<br />
Les grands <strong>moyens</strong> d’essais aérodynamiques sont confiés à l’ONERA, <strong>et</strong><br />
l’établissement de Toulouse est placé sous la tutelle de la Direction technique <strong>et</strong><br />
industrielle de l’aéronautique (DTIA). Il prend le nom d’Etablissement aéronautique<br />
de Toulouse (EAT). Ce changement de statut a de lourdes conséquences, puisque<br />
par des licenciements ou par des r<strong>et</strong>ours à l’ONERA, l’effectif qui était monté à plus<br />
de 500 personnes s’établit à moins de 300. Les proj<strong>et</strong>s de grandes souffleries, qui<br />
étaient entrés dans un début d’exécution, sont naturellement abandonnés. La<br />
situation est cependant clarifiée, <strong>et</strong> quatre domaines de compétence sont bien<br />
identifiés : aérodynamique basse vitesse, matériaux, structures, équipements.<br />
1.2 - De l’EAT au CEAT<br />
Dès 1949, l’EAT doit faire face aux essais que nécessitent les programmes lancés<br />
à c<strong>et</strong>te époque, <strong>et</strong> d’abord ceux du SE2010 « Armagnac », dont les essais statiques<br />
se déroulent dans un hall conçu spécialement à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>. Sa réalisation avait été<br />
lancée dans la période précédente.<br />
Avec 300 personnes environ, l’EAT est encore un p<strong>et</strong>it établissement dont<br />
l’activité essentielle est tournée vers les matériaux <strong>et</strong> les structures.<br />
Dans les années qui suivent, son activité concerne les programmes du moment :<br />
SO30P « Br<strong>et</strong>agne », MS475 « Vanneau », Fouga CM170, Leduc 022, SO4050<br />
« Vautour » (figure 2), SE212 « Grognard », MD450 « Ouragan », Mystère IV,<br />
Brégu<strong>et</strong> « Alizé », Potez 840, Nord 262... Les installations d’essais sont pour la<br />
plupart réalisées en interne, grâce à un bureau d’études <strong>et</strong> à un atelier (dirigés par<br />
René Thouraud) qui représentent près du tiers de l’effectif de l’établissement.<br />
L’EAT n’est pas sans concurrents, même au sein de la DTIA, puisque plusieurs<br />
laboratoires se sont reconstitués après-guerre à côté des services techniques. C’est<br />
ainsi que les essais structuraux du Super-Mystère B2 <strong>et</strong> du Mirage III sont réalisés<br />
dans la « Section d’essais statiques » du STAé (Service technique de<br />
l’aéronautique).<br />
L’effectif de l’EAT reste sensiblement stable pendant plusieurs années.<br />
Cependant, disposant d’un bureau d’études <strong>et</strong> d’un atelier importants, d’un vaste<br />
patrimoine foncier, bénéficiant de plus de la proximité de la SNCASE (Société<br />
nationale de constructions aéronautiques du Sud-Est), il est de toute évidence bien<br />
placé pour contribuer aux essais du programme « Caravelle » ; ce qui pousse<br />
l’Etablissement à créer de nombreuses installations nouvelles :<br />
- Cuves d’essais « Caravelle » <strong>et</strong> systèmes de chargement pour essais<br />
statiques <strong>et</strong> de fatigue (1956) (figure 3) ;<br />
- Machines d’essais de matériaux (dont 200 machines de flexion rotatives) ;<br />
- Machine d’essais de freins (1954) (figure 4) ;<br />
- Machines d’essais d’endurance de roues ;<br />
- Bancs d’essais hydrauliques/électriques/carburant ;<br />
- Machines d’essais d’atterrisseurs : « Saint Martin » (1956) ; « EAT<br />
125 tonnes » (1955-1961) ;<br />
- « Canon à poul<strong>et</strong> » (1958) ;<br />
- Bancs d’essais de conditionnement d’air (1956-1961).<br />
D’autres installations d’essais sont sous-traitées, <strong>et</strong> notamment à Latécoère, qui<br />
fournit en 1961 une catapulte pour le tunnel (dérivée de celle étudiée pour le<br />
« Baroudeur »), puis en 1964 une machine d’essais d’atterrisseurs, <strong>et</strong> enfin des