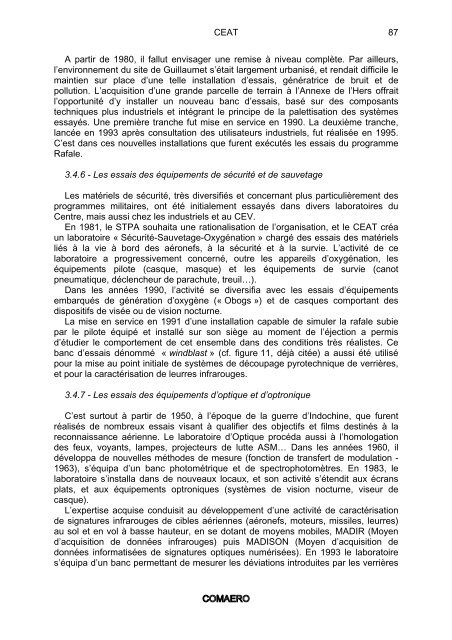Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CEAT<br />
A partir de 1980, il fallut envisager une remise à niveau complète. Par ailleurs,<br />
l’environnement du site de Guillaum<strong>et</strong> s’était largement urbanisé, <strong>et</strong> rendait difficile le<br />
maintien sur place d’une telle installation d’essais, génératrice de bruit <strong>et</strong> de<br />
pollution. L’acquisition d’une grande parcelle de terrain à l’Annexe de l’Hers offrait<br />
l’opportunité d’y installer un nouveau banc d’essais, basé sur des composants<br />
techniques plus industriels <strong>et</strong> intégrant le principe de la pal<strong>et</strong>tisation des systèmes<br />
essayés. Une première tranche fut mise en service en 1990. La deuxième tranche,<br />
lancée en 1993 après consultation des utilisateurs industriels, fut réalisée en 1995.<br />
C’est dans ces nouvelles installations que furent exécutés les essais du programme<br />
Rafale.<br />
3.4.6 - Les essais des équipements de sécurité <strong>et</strong> de sauv<strong>et</strong>age<br />
Les matériels de sécurité, très diversifiés <strong>et</strong> concernant plus particulièrement des<br />
programmes militaires, ont été initialement essayés dans divers laboratoires du<br />
Centre, mais aussi chez les industriels <strong>et</strong> au CEV.<br />
En 1981, le STPA souhaita une rationalisation de l’organisation, <strong>et</strong> le CEAT créa<br />
un laboratoire « Sécurité-Sauv<strong>et</strong>age-Oxygénation » chargé des essais des matériels<br />
liés à la vie à bord des aéronefs, à la sécurité <strong>et</strong> à la survie. L’activité de ce<br />
laboratoire a progressivement concerné, outre les appareils d’oxygénation, les<br />
équipements pilote (casque, masque) <strong>et</strong> les équipements de survie (canot<br />
pneumatique, déclencheur de parachute, treuil…).<br />
Dans les années 1990, l’activité se diversifia avec les essais d’équipements<br />
embarqués de génération d’oxygène (« Obogs ») <strong>et</strong> de casques comportant des<br />
dispositifs de visée ou de vision nocturne.<br />
La mise en service en 1991 d’une installation capable de simuler la rafale subie<br />
par le pilote équipé <strong>et</strong> installé sur son siège au moment de l’éjection a permis<br />
d’étudier le comportement de c<strong>et</strong> ensemble dans des conditions très réalistes. Ce<br />
banc d’essais dénommé « windblast » (cf. figure 11, déjà citée) a aussi été utilisé<br />
pour la mise au point initiale de systèmes de découpage pyrotechnique de verrières,<br />
<strong>et</strong> pour la caractérisation de leurres infrarouges.<br />
3.4.7 - Les essais des équipements d’optique <strong>et</strong> d’optronique<br />
C’est surtout à partir de 1950, à l’époque de la guerre d’Indochine, que furent<br />
réalisés de nombreux essais visant à qualifier des objectifs <strong>et</strong> films destinés à la<br />
reconnaissance aérienne. Le laboratoire d’Optique procéda aussi à l’homologation<br />
des feux, voyants, lampes, projecteurs de lutte ASM… Dans les années 1960, il<br />
développa de nouvelles méthodes de mesure (fonction de transfert de modulation -<br />
1963), s’équipa d’un banc photométrique <strong>et</strong> de spectrophotomètres. En 1983, le<br />
laboratoire s’installa dans de nouveaux locaux, <strong>et</strong> son activité s’étendit aux écrans<br />
plats, <strong>et</strong> aux équipements optroniques (systèmes de vision nocturne, viseur de<br />
casque).<br />
L’expertise acquise conduisit au développement d’une activité de caractérisation<br />
de signatures infrarouges de cibles aériennes (aéronefs, moteurs, missiles, leurres)<br />
au sol <strong>et</strong> en vol à basse hauteur, en se dotant de <strong>moyens</strong> mobiles, MADIR (Moyen<br />
d’acquisition de données infrarouges) puis MADISON (Moyen d’acquisition de<br />
données informatisées de signatures optiques numérisées). En 1993 le laboratoire<br />
s’équipa d’un banc perm<strong>et</strong>tant de mesurer les déviations introduites par les verrières<br />
87