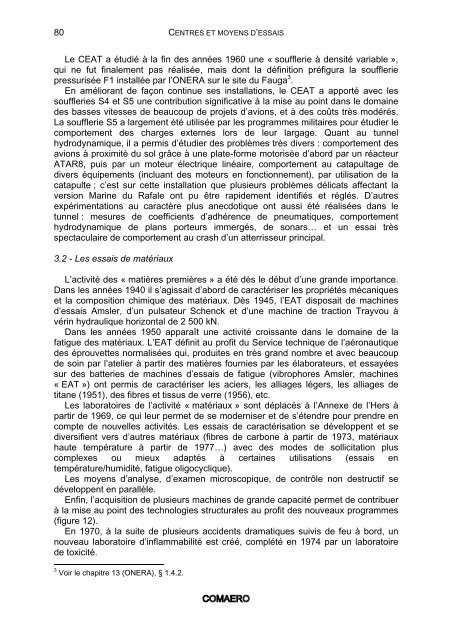Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
80<br />
CENTRES ET MOYENS D’ESSAIS<br />
Le CEAT a étudié à la fin des années 1960 une « soufflerie à densité variable »,<br />
qui ne fut finalement pas réalisée, mais dont la définition préfigura la soufflerie<br />
pressurisée F1 installée par l’ONERA sur le site du Fauga 3 .<br />
En améliorant de façon continue ses installations, le CEAT a apporté avec les<br />
souffleries S4 <strong>et</strong> S5 une contribution significative à la mise au point dans le domaine<br />
des basses vitesses de beaucoup de proj<strong>et</strong>s d’avions, <strong>et</strong> à des coûts très modérés.<br />
La soufflerie S5 a largement été utilisée par les programmes militaires pour étudier le<br />
comportement des charges externes lors de leur largage. Quant au tunnel<br />
hydrodynamique, il a permis d’étudier des problèmes très divers : comportement des<br />
avions à proximité du sol grâce à une plate-forme motorisée d’abord par un réacteur<br />
ATAR8, puis par un moteur électrique linéaire, comportement au catapultage de<br />
divers équipements (incluant des moteurs en fonctionnement), par utilisation de la<br />
catapulte ; c’est sur c<strong>et</strong>te installation que plusieurs problèmes délicats affectant la<br />
version Marine du Rafale ont pu être rapidement identifiés <strong>et</strong> réglés. D’autres<br />
expérimentations au caractère plus anecdotique ont aussi été réalisées dans le<br />
tunnel : mesures de coefficients d’adhérence de pneumatiques, comportement<br />
hydrodynamique de plans porteurs immergés, de sonars… <strong>et</strong> un essai très<br />
spectaculaire de comportement au crash d’un atterrisseur principal.<br />
3.2 - Les essais de matériaux<br />
L’activité des « matières premières » a été dès le début d’une grande importance.<br />
Dans les années 1940 il s’agissait d’abord de caractériser les propriétés mécaniques<br />
<strong>et</strong> la composition chimique des matériaux. Dès 1945, l’EAT disposait de machines<br />
d’essais Amsler, d’un pulsateur Schenck <strong>et</strong> d’une machine de traction Trayvou à<br />
vérin hydraulique horizontal de 2 500 kN.<br />
Dans les années 1950 apparaît une activité croissante dans le domaine de la<br />
fatigue des matériaux. L’EAT définit au profit du Service technique de l’aéronautique<br />
des éprouv<strong>et</strong>tes normalisées qui, produites en très grand nombre <strong>et</strong> avec beaucoup<br />
de soin par l’atelier à partir des matières fournies par les élaborateurs, <strong>et</strong> essayées<br />
sur des batteries de machines d’essais de fatigue (vibrophores Amsler, machines<br />
« EAT ») ont permis de caractériser les aciers, les alliages légers, les alliages de<br />
titane (1951), des fibres <strong>et</strong> tissus de verre (1956), <strong>et</strong>c.<br />
Les laboratoires de l’activité « matériaux » sont déplacés à l’Annexe de l’Hers à<br />
partir de 1969, ce qui leur perm<strong>et</strong> de se moderniser <strong>et</strong> de s’étendre pour prendre en<br />
compte de nouvelles activités. Les essais de caractérisation se développent <strong>et</strong> se<br />
diversifient vers d’autres matériaux (fibres de carbone à partir de 1973, matériaux<br />
haute température à partir de 1977…) avec des modes de sollicitation plus<br />
complexes ou mieux adaptés à certaines utilisations (essais en<br />
température/humidité, fatigue oligocyclique).<br />
Les <strong>moyens</strong> d’analyse, d’examen microscopique, de contrôle non destructif se<br />
développent en parallèle.<br />
Enfin, l’acquisition de plusieurs machines de grande capacité perm<strong>et</strong> de contribuer<br />
à la mise au point des technologies structurales au profit des nouveaux programmes<br />
(figure 12).<br />
En 1970, à la suite de plusieurs accidents dramatiques suivis de feu à bord, un<br />
nouveau laboratoire d’inflammabilité est créé, complété en 1974 par un laboratoire<br />
de toxicité.<br />
3 Voir le chapitre 13 (ONERA), § 1.4.2.