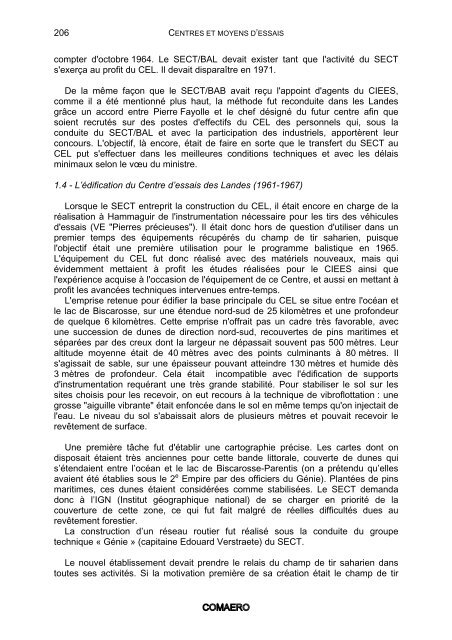Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
206<br />
CENTRES ET MOYENS D’ESSAIS<br />
compter d'octobre 1964. Le SECT/BAL devait exister tant que l'activité du SECT<br />
s'exerça au profit du CEL. Il devait disparaître en 1971.<br />
De la même façon que le SECT/BAB avait reçu l'appoint d'agents du CIEES,<br />
comme il a été mentionné plus haut, la méthode fut reconduite dans les Landes<br />
grâce un accord entre Pierre Fayolle <strong>et</strong> le chef désigné du futur centre afin que<br />
soient recrutés sur des postes d'effectifs du CEL des personnels qui, sous la<br />
conduite du SECT/BAL <strong>et</strong> avec la participation des industriels, apportèrent leur<br />
concours. L'objectif, là encore, était de faire en sorte que le transfert du SECT au<br />
CEL put s'effectuer dans les meilleures conditions techniques <strong>et</strong> avec les délais<br />
minimaux selon le vœu du ministre.<br />
1.4 - L’édification du Centre d’essais des Landes (1961-1967)<br />
Lorsque le SECT entreprit la construction du CEL, il était encore en charge de la<br />
réalisation à Hammaguir de l'instrumentation nécessaire pour les tirs des véhicules<br />
<strong>d'essais</strong> (VE "Pierres précieuses"). Il était donc hors de question d'utiliser dans un<br />
premier temps des équipements récupérés du champ de tir saharien, puisque<br />
l'objectif était une première utilisation pour le programme balistique en 1965.<br />
L'équipement du CEL fut donc réalisé avec des matériels nouveaux, mais qui<br />
évidemment m<strong>et</strong>taient à profit les études réalisées pour le CIEES ainsi que<br />
l'expérience acquise à l'occasion de l'équipement de ce Centre, <strong>et</strong> aussi en m<strong>et</strong>tant à<br />
profit les avancées techniques intervenues entre-temps.<br />
L'emprise r<strong>et</strong>enue pour édifier la base principale du CEL se situe entre l'océan <strong>et</strong><br />
le lac de Biscarosse, sur une étendue nord-sud de 25 kilomètres <strong>et</strong> une profondeur<br />
de quelque 6 kilomètres. C<strong>et</strong>te emprise n'offrait pas un cadre très favorable, avec<br />
une succession de dunes de direction nord-sud, recouvertes de pins maritimes <strong>et</strong><br />
séparées par des creux dont la largeur ne dépassait souvent pas 500 mètres. Leur<br />
altitude moyenne était de 40 mètres avec des points culminants à 80 mètres. Il<br />
s'agissait de sable, sur une épaisseur pouvant atteindre 130 mètres <strong>et</strong> humide dès<br />
3 mètres de profondeur. Cela était incompatible avec l'édification de supports<br />
d'instrumentation requérant une très grande stabilité. Pour stabiliser le sol sur les<br />
sites choisis pour les recevoir, on eut recours à la technique de vibroflottation : une<br />
grosse "aiguille vibrante" était enfoncée dans le sol en même temps qu'on injectait de<br />
l'eau. Le niveau du sol s'abaissait alors de plusieurs mètres <strong>et</strong> pouvait recevoir le<br />
revêtement de surface.<br />
Une première tâche fut d'établir une cartographie précise. Les cartes dont on<br />
disposait étaient très anciennes pour c<strong>et</strong>te bande littorale, couverte de dunes qui<br />
s’étendaient entre l’océan <strong>et</strong> le lac de Biscarosse-Parentis (on a prétendu qu’elles<br />
avaient été établies sous le 2 e Empire par des officiers du Génie). Plantées de pins<br />
maritimes, ces dunes étaient considérées comme stabilisées. Le SECT demanda<br />
donc à l’IGN (Institut géographique national) de se charger en priorité de la<br />
couverture de c<strong>et</strong>te zone, ce qui fut fait malgré de réelles difficultés dues au<br />
revêtement forestier.<br />
La construction d’un réseau routier fut réalisé sous la conduite du groupe<br />
technique « Génie » (capitaine Edouard Verstra<strong>et</strong>e) du SECT.<br />
Le nouvel établissement devait prendre le relais du champ de tir saharien dans<br />
toutes ses activités. Si la motivation première de sa création était le champ de tir