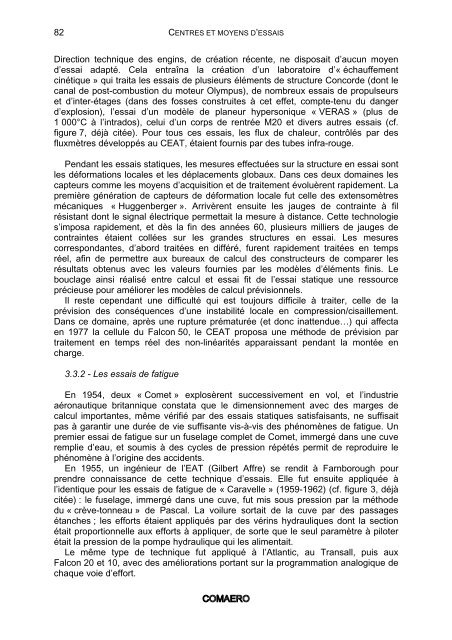Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
82<br />
CENTRES ET MOYENS D’ESSAIS<br />
Direction technique des engins, de création récente, ne disposait d’aucun moyen<br />
d’essai adapté. Cela entraîna la création d’un laboratoire d’« échauffement<br />
cinétique » qui traita les essais de plusieurs éléments de structure Concorde (dont le<br />
canal de post-combustion du moteur Olympus), de nombreux essais de propulseurs<br />
<strong>et</strong> d’inter-étages (dans des fosses construites à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, compte-tenu du danger<br />
d’explosion), l’essai d’un modèle de planeur hypersonique « VERAS » (plus de<br />
1 000°C à l’intrados), celui d’un corps de rentrée M20 <strong>et</strong> divers autres essais (cf.<br />
figure 7, déjà citée). Pour tous ces essais, les flux de chaleur, contrôlés par des<br />
fluxmètres développés au CEAT, étaient fournis par des tubes infra-rouge.<br />
Pendant les essais statiques, les mesures effectuées sur la structure en essai sont<br />
les déformations locales <strong>et</strong> les déplacements globaux. Dans ces deux domaines les<br />
capteurs comme les <strong>moyens</strong> d’acquisition <strong>et</strong> de traitement évoluèrent rapidement. La<br />
première génération de capteurs de déformation locale fut celle des extensomètres<br />
mécaniques « Huggenberger ». Arrivèrent ensuite les jauges de contrainte à fil<br />
résistant dont le signal électrique perm<strong>et</strong>tait la mesure à distance. C<strong>et</strong>te technologie<br />
s’imposa rapidement, <strong>et</strong> dès la fin des années 60, plusieurs milliers de jauges de<br />
contraintes étaient collées sur les grandes structures en essai. Les mesures<br />
correspondantes, d’abord traitées en différé, furent rapidement traitées en temps<br />
réel, afin de perm<strong>et</strong>tre aux bureaux de calcul des constructeurs de comparer les<br />
résultats obtenus avec les valeurs fournies par les modèles d’éléments finis. Le<br />
bouclage ainsi réalisé entre calcul <strong>et</strong> essai fit de l’essai statique une ressource<br />
précieuse pour améliorer les modèles de calcul prévisionnels.<br />
Il reste cependant une difficulté qui est toujours difficile à traiter, celle de la<br />
prévision des conséquences d’une instabilité locale en compression/cisaillement.<br />
Dans ce domaine, après une rupture prématurée (<strong>et</strong> donc inattendue…) qui affecta<br />
en 1977 la cellule du Falcon 50, le CEAT proposa une méthode de prévision par<br />
traitement en temps réel des non-linéarités apparaissant pendant la montée en<br />
charge.<br />
3.3.2 - Les essais de fatigue<br />
En 1954, deux « Com<strong>et</strong> » explosèrent successivement en vol, <strong>et</strong> l’industrie<br />
aéronautique britannique constata que le dimensionnement avec des marges de<br />
calcul importantes, même vérifié par des essais statiques satisfaisants, ne suffisait<br />
pas à garantir une durée de vie suffisante vis-à-vis des phénomènes de fatigue. Un<br />
premier essai de fatigue sur un fuselage compl<strong>et</strong> de Com<strong>et</strong>, immergé dans une cuve<br />
remplie d’eau, <strong>et</strong> soumis à des cycles de pression répétés permit de reproduire le<br />
phénomène à l’origine des accidents.<br />
En 1955, un ingénieur de l’EAT (Gilbert Affre) se rendit à Farnborough pour<br />
prendre connaissance de c<strong>et</strong>te technique d’essais. Elle fut ensuite appliquée à<br />
l’identique pour les essais de fatigue de « Caravelle » (1959-1962) (cf. figure 3, déjà<br />
citée) : le fuselage, immergé dans une cuve, fut mis sous pression par la méthode<br />
du « crève-tonneau » de Pascal. La voilure sortait de la cuve par des passages<br />
étanches ; les efforts étaient appliqués par des vérins hydrauliques dont la section<br />
était proportionnelle aux efforts à appliquer, de sorte que le seul paramètre à piloter<br />
était la pression de la pompe hydraulique qui les alimentait.<br />
Le même type de technique fut appliqué à l’Atlantic, au Transall, puis aux<br />
Falcon 20 <strong>et</strong> 10, avec des améliorations portant sur la programmation analogique de<br />
chaque voie d’effort.