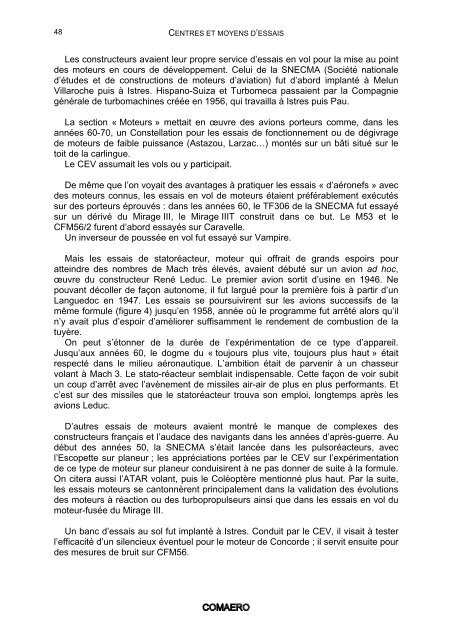Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
48<br />
CENTRES ET MOYENS D’ESSAIS<br />
Les constructeurs avaient leur propre service d’essais en vol pour la mise au point<br />
des moteurs en cours de développement. Celui de la SNECMA (Société nationale<br />
d’études <strong>et</strong> de constructions de moteurs d’aviation) fut d’abord implanté à Melun<br />
Villaroche puis à Istres. Hispano-Suiza <strong>et</strong> Turbomeca passaient par la Compagnie<br />
générale de turbomachines créée en 1956, qui travailla à Istres puis Pau.<br />
La section « Moteurs » m<strong>et</strong>tait en œuvre des avions porteurs comme, dans les<br />
années 60-70, un Constellation pour les essais de fonctionnement ou de dégivrage<br />
de moteurs de faible puissance (Astazou, Larzac…) montés sur un bâti situé sur le<br />
toit de la carlingue.<br />
Le CEV assumait les vols ou y participait.<br />
De même que l’on voyait des avantages à pratiquer les essais « d’aéronefs » avec<br />
des moteurs connus, les essais en vol de moteurs étaient préférablement exécutés<br />
sur des porteurs éprouvés : dans les années 60, le TF306 de la SNECMA fut essayé<br />
sur un dérivé du Mirage III, le Mirage IIIT construit dans ce but. Le M53 <strong>et</strong> le<br />
CFM56/2 furent d’abord essayés sur Caravelle.<br />
Un inverseur de poussée en vol fut essayé sur Vampire.<br />
Mais les essais de statoréacteur, moteur qui offrait de grands espoirs pour<br />
atteindre des nombres de Mach très élevés, avaient débuté sur un avion ad hoc,<br />
œuvre du constructeur René Leduc. Le premier avion sortit d’usine en 1946. Ne<br />
pouvant décoller de façon autonome, il fut largué pour la première fois à partir d’un<br />
Languedoc en 1947. Les essais se poursuivirent sur les avions successifs de la<br />
même formule (figure 4) jusqu’en 1958, année où le programme fut arrêté alors qu’il<br />
n’y avait plus d’espoir d’améliorer suffisamment le rendement de combustion de la<br />
tuyère.<br />
On peut s’étonner de la durée de l’expérimentation de ce type d’appareil.<br />
Jusqu’aux années 60, le dogme du « toujours plus vite, toujours plus haut » était<br />
respecté dans le milieu aéronautique. L’ambition était de parvenir à un chasseur<br />
volant à Mach 3. Le stato-réacteur semblait indispensable. C<strong>et</strong>te façon de voir subit<br />
un coup d’arrêt avec l’avènement de missiles air-air de plus en plus performants. Et<br />
c’est sur des missiles que le statoréacteur trouva son emploi, longtemps après les<br />
avions Leduc.<br />
D’autres essais de moteurs avaient montré le manque de complexes des<br />
constructeurs français <strong>et</strong> l’audace des navigants dans les années d’après-guerre. Au<br />
début des années 50, la SNECMA s’était lancée dans les pulsoréacteurs, avec<br />
l’Escop<strong>et</strong>te sur planeur ; les appréciations portées par le CEV sur l’expérimentation<br />
de ce type de moteur sur planeur conduisirent à ne pas donner de suite à la formule.<br />
On citera aussi l’ATAR volant, puis le Coléoptère mentionné plus haut. Par la suite,<br />
les essais moteurs se cantonnèrent principalement dans la validation des évolutions<br />
des moteurs à réaction ou des turbopropulseurs ainsi que dans les essais en vol du<br />
moteur-fusée du Mirage III.<br />
Un banc d’essais au sol fut implanté à Istres. Conduit par le CEV, il visait à tester<br />
l’efficacité d’un silencieux éventuel pour le moteur de Concorde ; il servit ensuite pour<br />
des mesures de bruit sur CFM56.