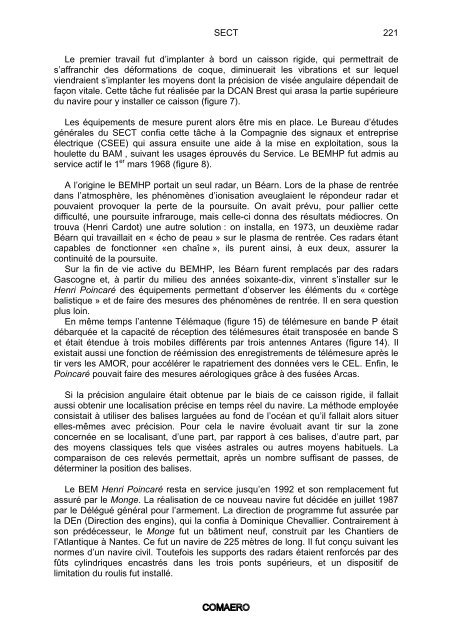Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SECT 221<br />
Le premier travail fut d’implanter à bord un caisson rigide, qui perm<strong>et</strong>trait de<br />
s’affranchir des déformations de coque, diminuerait les vibrations <strong>et</strong> sur lequel<br />
viendraient s’implanter les <strong>moyens</strong> dont la précision de visée angulaire dépendait de<br />
façon vitale. C<strong>et</strong>te tâche fut réalisée par la DCAN Brest qui arasa la partie supérieure<br />
du navire pour y installer ce caisson (figure 7).<br />
Les équipements de mesure purent alors être mis en place. Le Bureau d’études<br />
générales du SECT confia c<strong>et</strong>te tâche à la Compagnie des signaux <strong>et</strong> entreprise<br />
électrique (CSEE) qui assura ensuite une aide à la mise en exploitation, sous la<br />
houl<strong>et</strong>te du BAM , suivant les usages éprouvés du Service. Le BEMHP fut admis au<br />
service actif le 1 er mars 1968 (figure 8).<br />
A l’origine le BEMHP portait un seul radar, un Béarn. Lors de la phase de rentrée<br />
dans l’atmosphère, les phénomènes d’ionisation aveuglaient le répondeur radar <strong>et</strong><br />
pouvaient provoquer la perte de la poursuite. On avait prévu, pour pallier c<strong>et</strong>te<br />
difficulté, une poursuite infrarouge, mais celle-ci donna des résultats médiocres. On<br />
trouva (Henri Cardot) une autre solution : on installa, en 1973, un deuxième radar<br />
Béarn qui travaillait en « écho de peau » sur le plasma de rentrée. Ces radars étant<br />
capables de fonctionner «en chaîne », ils purent ainsi, à eux deux, assurer la<br />
continuité de la poursuite.<br />
Sur la fin de vie active du BEMHP, les Béarn furent remplacés par des radars<br />
Gascogne <strong>et</strong>, à partir du milieu des années soixante-dix, vinrent s’installer sur le<br />
Henri Poincaré des équipements perm<strong>et</strong>tant d’observer les éléments du « cortège<br />
balistique » <strong>et</strong> de faire des mesures des phénomènes de rentrée. Il en sera question<br />
plus loin.<br />
En même temps l’antenne Télémaque (figure 15) de télémesure en bande P était<br />
débarquée <strong>et</strong> la capacité de réception des télémesures était transposée en bande S<br />
<strong>et</strong> était étendue à trois mobiles différents par trois antennes Antares (figure 14). Il<br />
existait aussi une fonction de réémission des enregistrements de télémesure après le<br />
tir vers les AMOR, pour accélérer le rapatriement des données vers le CEL. Enfin, le<br />
Poincaré pouvait faire des mesures aérologiques grâce à des fusées Arcas.<br />
Si la précision angulaire était obtenue par le biais de ce caisson rigide, il fallait<br />
aussi obtenir une localisation précise en temps réel du navire. La méthode employée<br />
consistait à utiliser des balises larguées au fond de l’océan <strong>et</strong> qu’il fallait alors situer<br />
elles-mêmes avec précision. Pour cela le navire évoluait avant tir sur la zone<br />
concernée en se localisant, d’une part, par rapport à ces balises, d’autre part, par<br />
des <strong>moyens</strong> classiques tels que visées astrales ou autres <strong>moyens</strong> habituels. La<br />
comparaison de ces relevés perm<strong>et</strong>tait, après un nombre suffisant de passes, de<br />
déterminer la position des balises.<br />
Le BEM Henri Poincaré resta en service jusqu’en 1992 <strong>et</strong> son remplacement fut<br />
assuré par le Monge. La réalisation de ce nouveau navire fut décidée en juill<strong>et</strong> 1987<br />
par le Délégué général pour l’armement. La direction de programme fut assurée par<br />
la DEn (Direction des engins), qui la confia à Dominique Chevallier. Contrairement à<br />
son prédécesseur, le Monge fut un bâtiment neuf, construit par les Chantiers de<br />
l’Atlantique à Nantes. Ce fut un navire de 225 mètres de long. Il fut conçu suivant les<br />
normes d’un navire civil. Toutefois les supports des radars étaient renforcés par des<br />
fûts cylindriques encastrés dans les trois ponts supérieurs, <strong>et</strong> un dispositif de<br />
limitation du roulis fut installé.