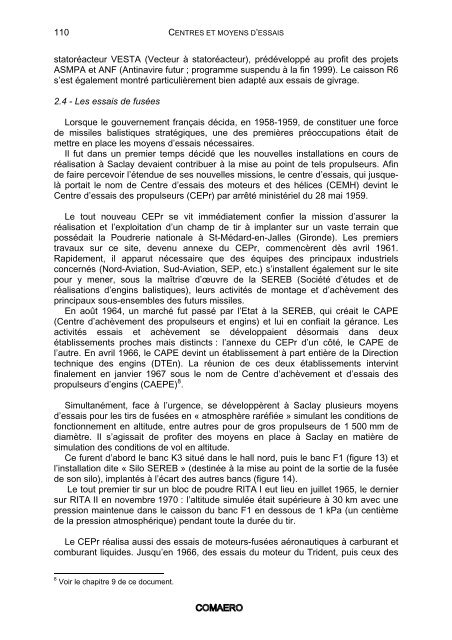Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
110<br />
CENTRES ET MOYENS D’ESSAIS<br />
statoréacteur VESTA (Vecteur à statoréacteur), prédéveloppé au profit des proj<strong>et</strong>s<br />
ASMPA <strong>et</strong> ANF (Antinavire futur ; programme suspendu à la fin 1999). Le caisson R6<br />
s’est également montré particulièrement bien adapté aux essais de givrage.<br />
2.4 - Les essais de fusées<br />
Lorsque le gouvernement français décida, en 1958-1959, de constituer une force<br />
de missiles balistiques stratégiques, une des premières préoccupations était de<br />
m<strong>et</strong>tre en place les <strong>moyens</strong> d’essais nécessaires.<br />
Il fut dans un premier temps décidé que les nouvelles installations en cours de<br />
réalisation à Saclay devaient contribuer à la mise au point de tels propulseurs. Afin<br />
de faire percevoir l’étendue de ses nouvelles missions, le centre d’essais, qui jusquelà<br />
portait le nom de Centre d’essais des moteurs <strong>et</strong> des hélices (CEMH) devint le<br />
Centre d’essais des propulseurs (CEPr) par arrêté ministériel du 28 mai 1959.<br />
Le tout nouveau CEPr se vit immédiatement confier la mission d’assurer la<br />
réalisation <strong>et</strong> l’exploitation d’un champ de tir à implanter sur un vaste terrain que<br />
possédait la Poudrerie nationale à St-Médard-en-Jalles (Gironde). Les premiers<br />
travaux sur ce site, devenu annexe du CEPr, commencèrent dès avril 1961.<br />
Rapidement, il apparut nécessaire que des équipes des principaux industriels<br />
concernés (Nord-Aviation, Sud-Aviation, SEP, <strong>et</strong>c.) s’installent également sur le site<br />
pour y mener, sous la maîtrise d’œuvre de la SEREB (Société d’études <strong>et</strong> de<br />
réalisations d’engins balistiques), leurs activités de montage <strong>et</strong> d’achèvement des<br />
principaux sous-ensembles des futurs missiles.<br />
En août 1964, un marché fut passé par l’Etat à la SEREB, qui créait le CAPE<br />
(Centre d’achèvement des propulseurs <strong>et</strong> engins) <strong>et</strong> lui en confiait la gérance. Les<br />
activités essais <strong>et</strong> achèvement se développaient désormais dans deux<br />
établissements proches mais distincts : l’annexe du CEPr d’un côté, le CAPE de<br />
l’autre. En avril 1966, le CAPE devint un établissement à part entière de la Direction<br />
technique des engins (DTEn). La réunion de ces deux établissements intervint<br />
finalement en janvier 1967 sous le nom de Centre d’achèvement <strong>et</strong> d’essais des<br />
propulseurs d’engins (CAEPE) 8 .<br />
Simultanément, face à l’urgence, se développèrent à Saclay plusieurs <strong>moyens</strong><br />
d’essais pour les tirs de fusées en « atmosphère raréfiée » simulant les conditions de<br />
fonctionnement en altitude, entre autres pour de gros propulseurs de 1 500 mm de<br />
diamètre. Il s’agissait de profiter des <strong>moyens</strong> en place à Saclay en matière de<br />
simulation des conditions de vol en altitude.<br />
Ce furent d’abord le banc K3 situé dans le hall nord, puis le banc F1 (figure 13) <strong>et</strong><br />
l’installation dite « Silo SEREB » (destinée à la mise au point de la sortie de la fusée<br />
de son silo), implantés à l’écart des autres bancs (figure 14).<br />
Le tout premier tir sur un bloc de poudre RITA I eut lieu en juill<strong>et</strong> 1965, le dernier<br />
sur RITA II en novembre 1970 : l’altitude simulée était supérieure à 30 km avec une<br />
pression maintenue dans le caisson du banc F1 en dessous de 1 kPa (un centième<br />
de la pression atmosphérique) pendant toute la durée du tir.<br />
Le CEPr réalisa aussi des essais de moteurs-fusées aéronautiques à carburant <strong>et</strong><br />
comburant liquides. Jusqu’en 1966, des essais du moteur du Trident, puis ceux des<br />
8 Voir le chapitre 9 de ce document.