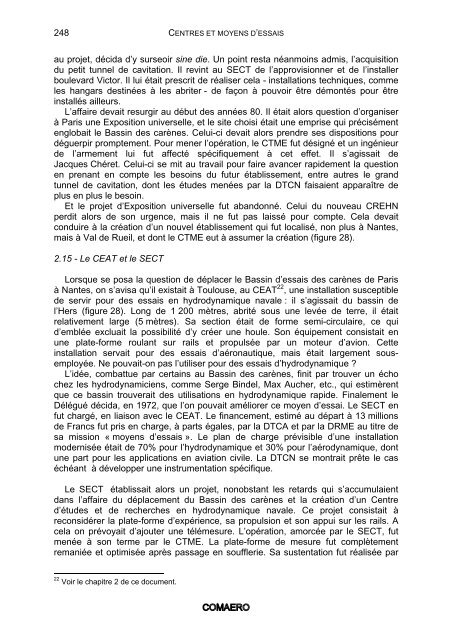Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
248<br />
CENTRES ET MOYENS D’ESSAIS<br />
au proj<strong>et</strong>, décida d’y surseoir sine die. Un point resta néanmoins admis, l’acquisition<br />
du p<strong>et</strong>it tunnel de cavitation. Il revint au SECT de l’approvisionner <strong>et</strong> de l’installer<br />
boulevard Victor. Il lui était prescrit de réaliser cela - installations techniques, comme<br />
les hangars destinées à les abriter - de façon à pouvoir être démontés pour être<br />
installés ailleurs.<br />
L’affaire devait resurgir au début des années 80. Il était alors question d’organiser<br />
à Paris une Exposition universelle, <strong>et</strong> le site choisi était une emprise qui précisément<br />
englobait le Bassin des carènes. Celui-ci devait alors prendre ses dispositions pour<br />
déguerpir promptement. Pour mener l’opération, le CTME fut désigné <strong>et</strong> un ingénieur<br />
de l’armement lui fut affecté spécifiquement à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>. Il s’agissait de<br />
Jacques Chér<strong>et</strong>. Celui-ci se mit au travail pour faire avancer rapidement la question<br />
en prenant en compte les besoins du futur établissement, entre autres le grand<br />
tunnel de cavitation, dont les études menées par la DTCN faisaient apparaître de<br />
plus en plus le besoin.<br />
Et le proj<strong>et</strong> d’Exposition universelle fut abandonné. Celui du nouveau CREHN<br />
perdit alors de son urgence, mais il ne fut pas laissé pour compte. Cela devait<br />
conduire à la création d’un nouvel établissement qui fut localisé, non plus à Nantes,<br />
mais à Val de Rueil, <strong>et</strong> dont le CTME eut à assumer la création (figure 28).<br />
2.15 - Le CEAT <strong>et</strong> le SECT<br />
Lorsque se posa la question de déplacer le Bassin d’essais des carènes de Paris<br />
à Nantes, on s’avisa qu’il existait à Toulouse, au CEAT 22 , une installation susceptible<br />
de servir pour des essais en hydrodynamique navale : il s’agissait du bassin de<br />
l’Hers (figure 28). Long de 1 200 mètres, abrité sous une levée de terre, il était<br />
relativement large (5 mètres). Sa section était de forme semi-circulaire, ce qui<br />
d’emblée excluait la possibilité d’y créer une houle. Son équipement consistait en<br />
une plate-forme roulant sur rails <strong>et</strong> propulsée par un moteur d’avion. C<strong>et</strong>te<br />
installation servait pour des essais d’aéronautique, mais était largement sousemployée.<br />
Ne pouvait-on pas l’utiliser pour des essais d’hydrodynamique ?<br />
L’idée, combattue par certains au Bassin des carènes, finit par trouver un écho<br />
chez les hydrodynamiciens, comme Serge Bindel, Max Aucher, <strong>et</strong>c., qui estimèrent<br />
que ce bassin trouverait des utilisations en hydrodynamique rapide. Finalement le<br />
Délégué décida, en 1972, que l’on pouvait améliorer ce moyen d’essai. Le SECT en<br />
fut chargé, en liaison avec le CEAT. Le financement, estimé au départ à 13 millions<br />
de Francs fut pris en charge, à parts égales, par la DTCA <strong>et</strong> par la DRME au titre de<br />
sa mission « <strong>moyens</strong> d’essais ». Le plan de charge prévisible d’une installation<br />
modernisée était de 70% pour l’hydrodynamique <strong>et</strong> 30% pour l’aérodynamique, dont<br />
une part pour les applications en aviation civile. La DTCN se montrait prête le cas<br />
échéant à développer une instrumentation spécifique.<br />
Le SECT établissait alors un proj<strong>et</strong>, nonobstant les r<strong>et</strong>ards qui s’accumulaient<br />
dans l’affaire du déplacement du Bassin des carènes <strong>et</strong> la création d’un Centre<br />
d’études <strong>et</strong> de recherches en hydrodynamique navale. Ce proj<strong>et</strong> consistait à<br />
reconsidérer la plate-forme d’expérience, sa propulsion <strong>et</strong> son appui sur les rails. A<br />
cela on prévoyait d’ajouter une télémesure. L’opération, amorcée par le SECT, fut<br />
menée à son terme par le CTME. La plate-forme de mesure fut complètement<br />
remaniée <strong>et</strong> optimisée après passage en soufflerie. Sa sustentation fut réalisée par<br />
22 Voir le chapitre 2 de ce document.