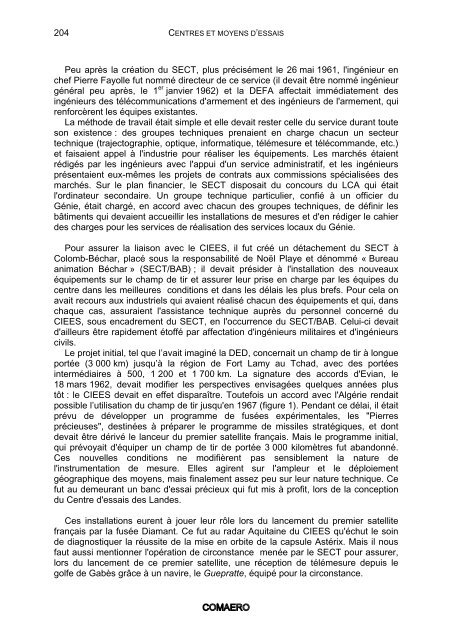Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
204<br />
CENTRES ET MOYENS D’ESSAIS<br />
Peu après la création du SECT, plus précisément le 26 mai 1961, l'ingénieur en<br />
chef Pierre Fayolle fut nommé directeur de ce service (il devait être nommé ingénieur<br />
général peu après, le 1 er janvier 1962) <strong>et</strong> la DEFA affectait immédiatement des<br />
ingénieurs des télécommunications d'armement <strong>et</strong> des ingénieurs de l'armement, qui<br />
renforcèrent les équipes existantes.<br />
La méthode de travail était simple <strong>et</strong> elle devait rester celle du service durant toute<br />
son existence : des groupes techniques prenaient en charge chacun un secteur<br />
technique (trajectographie, optique, informatique, télémesure <strong>et</strong> télécommande, <strong>et</strong>c.)<br />
<strong>et</strong> faisaient appel à l'industrie pour réaliser les équipements. Les marchés étaient<br />
rédigés par les ingénieurs avec l'appui d'un service administratif, <strong>et</strong> les ingénieurs<br />
présentaient eux-mêmes les proj<strong>et</strong>s de contrats aux commissions spécialisées des<br />
marchés. Sur le plan financier, le SECT disposait du concours du LCA qui était<br />
l'ordinateur secondaire. Un groupe technique particulier, confié à un officier du<br />
Génie, était chargé, en accord avec chacun des groupes techniques, de définir les<br />
bâtiments qui devaient accueillir les installations de mesures <strong>et</strong> d'en rédiger le cahier<br />
des charges pour les services de réalisation des services locaux du Génie.<br />
Pour assurer la liaison avec le CIEES, il fut créé un détachement du SECT à<br />
Colomb-Béchar, placé sous la responsabilité de Noël Playe <strong>et</strong> dénommé « Bureau<br />
animation Béchar » (SECT/BAB) ; il devait présider à l'installation des nouveaux<br />
équipements sur le champ de tir <strong>et</strong> assurer leur prise en charge par les équipes du<br />
centre dans les meilleures conditions <strong>et</strong> dans les délais les plus brefs. Pour cela on<br />
avait recours aux industriels qui avaient réalisé chacun des équipements <strong>et</strong> qui, dans<br />
chaque cas, assuraient l'assistance technique auprès du personnel concerné du<br />
CIEES, sous encadrement du SECT, en l'occurrence du SECT/BAB. Celui-ci devait<br />
d'ailleurs être rapidement étoffé par affectation d'ingénieurs militaires <strong>et</strong> d'ingénieurs<br />
civils.<br />
Le proj<strong>et</strong> initial, tel que l’avait imaginé la DED, concernait un champ de tir à longue<br />
portée (3 000 km) jusqu’à la région de Fort Lamy au Tchad, avec des portées<br />
intermédiaires à 500, 1 200 <strong>et</strong> 1 700 km. La signature des accords d'Evian, le<br />
18 mars 1962, devait modifier les perspectives envisagées quelques années plus<br />
tôt : le CIEES devait en eff<strong>et</strong> disparaître. Toutefois un accord avec l'Algérie rendait<br />
possible l’utilisation du champ de tir jusqu'en 1967 (figure 1). Pendant ce délai, il était<br />
prévu de développer un programme de fusées expérimentales, les "Pierres<br />
précieuses", destinées à préparer le programme de missiles stratégiques, <strong>et</strong> dont<br />
devait être dérivé le lanceur du premier satellite français. Mais le programme initial,<br />
qui prévoyait d'équiper un champ de tir de portée 3 000 kilomètres fut abandonné.<br />
Ces nouvelles conditions ne modifièrent pas sensiblement la nature de<br />
l'instrumentation de mesure. Elles agirent sur l'ampleur <strong>et</strong> le déploiement<br />
géographique des <strong>moyens</strong>, mais finalement assez peu sur leur nature technique. Ce<br />
fut au demeurant un banc d'essai précieux qui fut mis à profit, lors de la conception<br />
du Centre <strong>d'essais</strong> des Landes.<br />
Ces installations eurent à jouer leur rôle lors du lancement du premier satellite<br />
français par la fusée Diamant. Ce fut au radar Aquitaine du CIEES qu'échut le soin<br />
de diagnostiquer la réussite de la mise en orbite de la capsule Astérix. Mais il nous<br />
faut aussi mentionner l'opération de circonstance menée par le SECT pour assurer,<br />
lors du lancement de ce premier satellite, une réception de télémesure depuis le<br />
golfe de Gabès grâce à un navire, le Guepratte, équipé pour la circonstance.