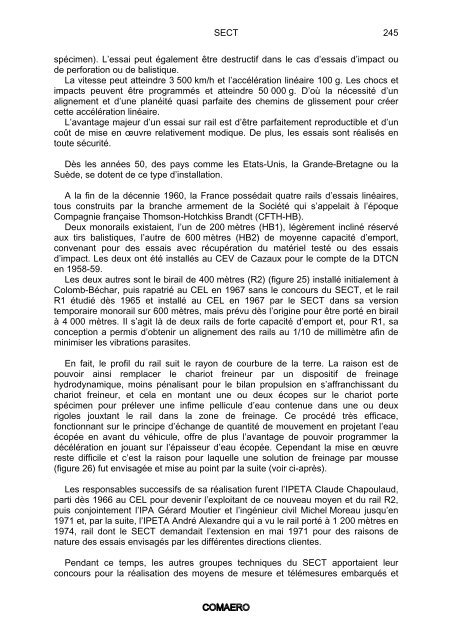Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
Centres et moyens d'essais ( I ) - EuroSAE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SECT 245<br />
spécimen). L’essai peut également être destructif dans le cas d’essais d’impact ou<br />
de perforation ou de balistique.<br />
La vitesse peut atteindre 3 500 km/h <strong>et</strong> l’accélération linéaire 100 g. Les chocs <strong>et</strong><br />
impacts peuvent être programmés <strong>et</strong> atteindre 50 000 g. D’où la nécessité d’un<br />
alignement <strong>et</strong> d’une planéité quasi parfaite des chemins de glissement pour créer<br />
c<strong>et</strong>te accélération linéaire.<br />
L’avantage majeur d’un essai sur rail est d’être parfaitement reproductible <strong>et</strong> d’un<br />
coût de mise en œuvre relativement modique. De plus, les essais sont réalisés en<br />
toute sécurité.<br />
Dès les années 50, des pays comme les Etats-Unis, la Grande-Br<strong>et</strong>agne ou la<br />
Suède, se dotent de ce type d’installation.<br />
A la fin de la décennie 1960, la France possédait quatre rails d’essais linéaires,<br />
tous construits par la branche armement de la Société qui s’appelait à l’époque<br />
Compagnie française Thomson-Hotchkiss Brandt (CFTH-HB).<br />
Deux monorails existaient, l’un de 200 mètres (HB1), légèrement incliné réservé<br />
aux tirs balistiques, l’autre de 600 mètres (HB2) de moyenne capacité d’emport,<br />
convenant pour des essais avec récupération du matériel testé ou des essais<br />
d’impact. Les deux ont été installés au CEV de Cazaux pour le compte de la DTCN<br />
en 1958-59.<br />
Les deux autres sont le birail de 400 mètres (R2) (figure 25) installé initialement à<br />
Colomb-Béchar, puis rapatrié au CEL en 1967 sans le concours du SECT, <strong>et</strong> le rail<br />
R1 étudié dès 1965 <strong>et</strong> installé au CEL en 1967 par le SECT dans sa version<br />
temporaire monorail sur 600 mètres, mais prévu dès l’origine pour être porté en birail<br />
à 4 000 mètres. Il s’agit là de deux rails de forte capacité d’emport <strong>et</strong>, pour R1, sa<br />
conception a permis d’obtenir un alignement des rails au 1/10 de millimètre afin de<br />
minimiser les vibrations parasites.<br />
En fait, le profil du rail suit le rayon de courbure de la terre. La raison est de<br />
pouvoir ainsi remplacer le chariot freineur par un dispositif de freinage<br />
hydrodynamique, moins pénalisant pour le bilan propulsion en s’affranchissant du<br />
chariot freineur, <strong>et</strong> cela en montant une ou deux écopes sur le chariot porte<br />
spécimen pour prélever une infime pellicule d’eau contenue dans une ou deux<br />
rigoles jouxtant le rail dans la zone de freinage. Ce procédé très efficace,<br />
fonctionnant sur le principe d’échange de quantité de mouvement en proj<strong>et</strong>ant l’eau<br />
écopée en avant du véhicule, offre de plus l’avantage de pouvoir programmer la<br />
décélération en jouant sur l’épaisseur d’eau écopée. Cependant la mise en œuvre<br />
reste difficile <strong>et</strong> c’est la raison pour laquelle une solution de freinage par mousse<br />
(figure 26) fut envisagée <strong>et</strong> mise au point par la suite (voir ci-après).<br />
Les responsables successifs de sa réalisation furent l’IPETA Claude Chapoulaud,<br />
parti dès 1966 au CEL pour devenir l’exploitant de ce nouveau moyen <strong>et</strong> du rail R2,<br />
puis conjointement l’IPA Gérard Moutier <strong>et</strong> l’ingénieur civil Michel Moreau jusqu’en<br />
1971 <strong>et</strong>, par la suite, l’IPETA André Alexandre qui a vu le rail porté à 1 200 mètres en<br />
1974, rail dont le SECT demandait l’extension en mai 1971 pour des raisons de<br />
nature des essais envisagés par les différentes directions clientes.<br />
Pendant ce temps, les autres groupes techniques du SECT apportaient leur<br />
concours pour la réalisation des <strong>moyens</strong> de mesure <strong>et</strong> télémesures embarqués <strong>et</strong>