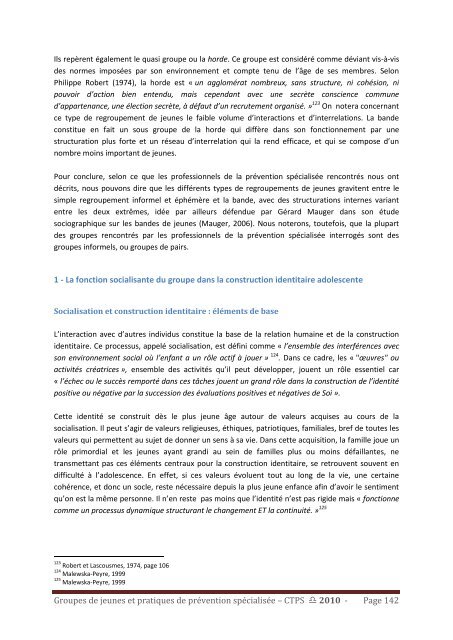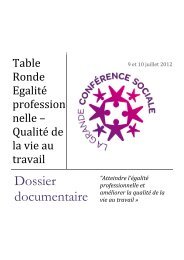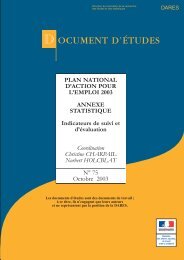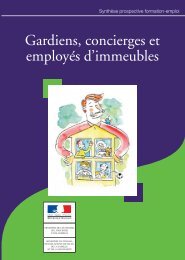Enfin, un autre critère central dans l’appréciation du groupe <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> est celui <strong>de</strong> l’inscription ducollectif dans un espace <strong>et</strong> dans une temporalité. En eff<strong>et</strong>, le groupe est une réalité qui évolueconstamment. Les groupes se font <strong>et</strong> se défont, y compris sur un temps aussi court que celui <strong>de</strong> lajournée. D’ailleurs, la majorité <strong>de</strong>s groupes est plutôt éphémère <strong>et</strong> les <strong>jeunes</strong> peuvent passer d’ungroupe à l’autre au gré <strong>de</strong>s occasions <strong>et</strong> <strong>de</strong>s recompositions - « les gravitants » selon un terme utilisépar les éducateurs <strong>de</strong> l’équipe <strong>de</strong> Mozaic à Paris. Les <strong>jeunes</strong> peuvent d’ailleurs appartenir à différentsgroupes selon le moment <strong>de</strong> la journée (journée ou soirée), <strong>de</strong> l’année (temps scolaire ou vacances),<strong>de</strong> la vie du jeune <strong>et</strong>, également, selon le lieu (proximité du lieu d’habitation, <strong>de</strong> l’établissementscolaire, du centre ville, d’une structure d’animation…).En termes <strong>de</strong> référence théorique, nous nous sommes tournées vers Laurent Mucchielli <strong>et</strong> MarwanMohammed (2007). Pour eux, la ban<strong>de</strong> est un groupe <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> que l’on rencontre dans les quartierspopulaires <strong>et</strong> dont les liens entre les membres sont basés sur <strong>de</strong> l’affectif <strong>et</strong> sur le partage d’unemême expérience <strong>de</strong> vie. Elle est constituée <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> adultes ou adolescents d’une même classed’âge. Elle se caractérise par trois critères centraux : son homogénéité <strong>de</strong> genre - en général,masculin bien que les constatations actuelles m<strong>et</strong>tent en avant une augmentation du phénomène <strong>de</strong>ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong> filles- <strong>et</strong> <strong>de</strong> lieu d’habitation <strong>de</strong> ses membres ; ensuite son informalité, c’est-à-dire qu’ellen’est pas constituée par un tiers extérieur ; enfin, sa finalité, « être ensemble pour expérimenter saforce, l’activité sexuelle <strong>et</strong> l’accès à la consommation <strong>de</strong> masse » 121 ce qui peut amener, danscertaines conditions, <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> déviance. Ces critères déterminent ainsi tout groupe naturel <strong>de</strong><strong>jeunes</strong> que la prévention spécialisée peut être amenée à rencontrer sur l’espace public.La différence entre le groupe <strong>et</strong> la ban<strong>de</strong> dans son sens savant ne repose pas sur le fonctionnementinterne du collectif mais plutôt, selon Laurent Muchielli (2007), sur son <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> marginalisation visà-vis<strong>de</strong> la société. C<strong>et</strong>te définition se base sur le concept <strong>de</strong> ségrégation réciproque développéeentre le groupe <strong>et</strong> son environnement. « P<strong>et</strong>it groupe fermé sur lui-même, la ban<strong>de</strong> apparaît alorscomme un bloc où les différences <strong>de</strong> caractère entre les individus n‘apparaissent pas à qui n’en faitpas partie. (…) En r<strong>et</strong>our, les membres <strong>de</strong> la ban<strong>de</strong> n’ont aucune empathie par rapport à ceux qui nefont pas partie <strong>de</strong> leur groupe, ce qui facilite d’ailleurs le passage à l’acte délinquant. » Ce concept,développé par Philippe Robert (Robert <strong>et</strong> Lascousmes, 1974) s’illustre par une stigmatisation socialeforte <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>s groupes, souvent les moins bien dotés pour être en capacité d’y résister. Laconstitution en ban<strong>de</strong> <strong>de</strong>vient alors « l’expression guerrière <strong>de</strong> la revendication diffuse d’une placedans la société, dans un quartier où rien n’avait été prévu qui puisse convenir à leur adolescence. » 122Cela s’explique en général par une forte incompréhension réciproque, entre les <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> les adultesamenés à les côtoyer (habitants surtout).D’autres types <strong>de</strong> groupes <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> sont repérés, à partir <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong> Robert <strong>et</strong> Lascoumes(1974). D’abord, le regroupement informel <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> habitant à proximité ou fréquentant la mêmeécole qui ont <strong>de</strong>s caractéristiques d’âge, <strong>de</strong> sexe <strong>et</strong> d’origine sociale –les classes populaireshomogènes.Ensuite, le groupe à support institutionnel, qui est un groupe constitué par une institution pour uneactivité déterminée, comme par exemple les groupes <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> constitués pour une activité sportivepar les éducateurs <strong>de</strong> prévention spécialisée.121 Mucchielli <strong>et</strong> Mohammed, 2007, page 5122 Esterle-Heidibel, 1997, page 73<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 141
Ils repèrent également le quasi groupe ou la hor<strong>de</strong>. Ce groupe est considéré comme déviant vis-à-vis<strong>de</strong>s normes imposées par son environnement <strong>et</strong> compte tenu <strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong> ses membres. SelonPhilippe Robert (1974), la hor<strong>de</strong> est « un agglomérat nombreux, sans structure, ni cohésion, nipouvoir d’action bien entendu, mais cependant avec une secrète conscience communed’appartenance, une élection secrète, à défaut d’un recrutement organisé. » 123 On notera concernantce type <strong>de</strong> regroupement <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> le faible volume d’interactions <strong>et</strong> d’interrelations. La ban<strong>de</strong>constitue en fait un sous groupe <strong>de</strong> la hor<strong>de</strong> qui diffère dans son fonctionnement par unestructuration plus forte <strong>et</strong> un réseau d’interrelation qui la rend efficace, <strong>et</strong> qui se compose d’unnombre moins important <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong>.Pour conclure, selon ce que les professionnels <strong>de</strong> la prévention spécialisée rencontrés nous ontdécrits, nous pouvons dire que les différents types <strong>de</strong> regroupements <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> gravitent entre lesimple regroupement informel <strong>et</strong> éphémère <strong>et</strong> la ban<strong>de</strong>, avec <strong>de</strong>s structurations internes variantentre les <strong>de</strong>ux extrêmes, idée par ailleurs défendue par Gérard Mauger dans son étu<strong>de</strong>sociographique sur les ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> (Mauger, 2006). Nous noterons, toutefois, que la plupart<strong>de</strong>s groupes rencontrés par les professionnels <strong>de</strong> la prévention spécialisée interrogés sont <strong>de</strong>sgroupes informels, ou groupes <strong>de</strong> pairs.1 - La fonction socialisante du groupe dans la construction i<strong>de</strong>ntitaire adolescenteSocialisation <strong>et</strong> construction i<strong>de</strong>ntitaire : éléments <strong>de</strong> baseL’interaction avec d’autres individus constitue la base <strong>de</strong> la relation humaine <strong>et</strong> <strong>de</strong> la constructioni<strong>de</strong>ntitaire. Ce processus, appelé socialisation, est défini comme « l’ensemble <strong>de</strong>s interférences avecson environnement social où l’enfant a un rôle actif à jouer » 124 . Dans ce cadre, les « "œuvres" ouactivités créatrices », ensemble <strong>de</strong>s activités qu’il peut développer, jouent un rôle essentiel car« l’échec ou le succès remporté dans ces tâches jouent un grand rôle dans la construction <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntitépositive ou négative par la succession <strong>de</strong>s évaluations positives <strong>et</strong> négatives <strong>de</strong> Soi ».C<strong>et</strong>te i<strong>de</strong>ntité se construit dès le plus jeune âge autour <strong>de</strong> valeurs acquises au cours <strong>de</strong> lasocialisation. Il peut s’agir <strong>de</strong> valeurs religieuses, éthiques, patriotiques, familiales, bref <strong>de</strong> toutes lesvaleurs qui perm<strong>et</strong>tent au suj<strong>et</strong> <strong>de</strong> donner un sens à sa vie. Dans c<strong>et</strong>te acquisition, la famille joue unrôle primordial <strong>et</strong> les <strong>jeunes</strong> ayant grandi au sein <strong>de</strong> familles plus ou moins défaillantes, n<strong>et</strong>ransm<strong>et</strong>tant pas ces éléments centraux pour la construction i<strong>de</strong>ntitaire, se r<strong>et</strong>rouvent souvent endifficulté à l’adolescence. En eff<strong>et</strong>, si ces valeurs évoluent tout au long <strong>de</strong> la vie, une certainecohérence, <strong>et</strong> donc un socle, reste nécessaire <strong>de</strong>puis la plus jeune enfance afin d’avoir le sentimentqu’on est la même personne. Il n’en reste pas moins que l’i<strong>de</strong>ntité n’est pas rigi<strong>de</strong> mais « fonctionnecomme un processus dynamique structurant le changement ET la continuité. » 125123 Robert <strong>et</strong> Lascousmes, 1974, page 106124 Malewska-Peyre, 1999125 Malewska-Peyre, 1999<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 142
- Page 5 and 6:
2 - Le sens d’une action communau
- Page 7 and 8:
AVANT PROPOSLe phénomène des band
- Page 10 and 11:
L’une et l’autre contribuent à
- Page 12 and 13:
Cette seconde étape a été engag
- Page 14 and 15:
CONSTATS ET PRECONISATIONS5 CONSTAT
- Page 16 and 17:
partenariales se développent parfo
- Page 18 and 19:
Les comportements violents et déli
- Page 20 and 21:
jeunes à la relation proposée. El
- Page 22 and 23:
7.2 - L’évaluation en préventio
- Page 24 and 25:
P 10. Prendre en compte les tension
- Page 26 and 27:
I - GROUPES DE JEUNES ET PRATIQUES
- Page 28 and 29:
sans emploi ou exclus de l’école
- Page 30 and 31:
devient « un régulateur social »
- Page 32 and 33:
libération, après la seconde guer
- Page 34 and 35:
l’animation sportive ou culturell
- Page 36 and 37:
L’approche de la personnalité gl
- Page 40 and 41:
ite permet de construire. De façon
- Page 42 and 43:
2 - Formes actuelles de regroupemen
- Page 44 and 45:
Les groupes virtuelsLes jeunes sont
- Page 46 and 47:
4 - Structuration et fonctionnement
- Page 48 and 49:
en tant que travailleur social. ..
- Page 50 and 51:
fonctionnement marginal et délictu
- Page 54 and 55:
liée à l’absence d’intériori
- Page 56 and 57:
Une pratique sociale collective a p
- Page 58 and 59:
CHAPITRE 5 : LES ATTENTES ET COMMAN
- Page 60 and 61:
« Le champ d’intervention de la
- Page 62 and 63:
Dans le projet de Contrat local de
- Page 64 and 65:
CHAPITRE 6 : AGIR AVEC LE GROUPELes
- Page 66 and 67:
Le comportement de jeunes en situat
- Page 68 and 69:
L’évaluation des actions entrepr
- Page 70 and 71:
5. Ces éducateurs vont essayer d
- Page 72 and 73:
La complexité des interactions dan
- Page 74 and 75:
La réflexion concernant cette rech
- Page 76 and 77:
P O S T F A C EL’incompréhension
- Page 78 and 79:
Les travaux du CTPS ne nient pas la
- Page 80 and 81:
ANNEXE : Questionnaire flashAnalyse
- Page 82 and 83:
MasculinFémininmixte18ansMono ethn
- Page 84 and 85:
CONSEIL TECHNIQUEDES CLUBS ET EQUIP
- Page 86 and 87:
II- PRATIQUES EDUCATIVES ET GROUPES
- Page 88 and 89:
son action sur les jeunes et sur le
- Page 90 and 91:
précarisées. Ce site nous a permi
- Page 92 and 93: PARTIE 1 : Monographies des sitesCe
- Page 94 and 95: les familles se connaissent entre e
- Page 96 and 97: de 6 à 18 ans pendant leur temps l
- Page 98 and 99: public. Pour l’association et ses
- Page 100 and 101: dans l’espace public) et l’acco
- Page 102 and 103: moyens : les éducateurs ne peuvent
- Page 104 and 105: démarches liées au projet mais é
- Page 106 and 107: Le projet Futsal : une salle en ges
- Page 108 and 109: CHAPITRE 2 : Le Neuhof - JEEP1 - Le
- Page 110 and 111: pourcentage, le plus haut comparati
- Page 112 and 113: esponsables du collège qui, lors d
- Page 114 and 115: La Jeep se compose d’une directio
- Page 116 and 117: développent d’autres actions sur
- Page 118 and 119: traduit le choix de l’équipe de
- Page 120 and 121: Par différence, le registre d’in
- Page 122 and 123: La présence dans les établissemen
- Page 124 and 125: organisé par les éducateurs de la
- Page 126 and 127: CHAPITRE 3 : Paris 18è - ARC 75/Mo
- Page 128 and 129: commune à tous les jeunes du quart
- Page 130 and 131: En 2007, l'association ARC 75 a men
- Page 132 and 133: d'intervention pour ARC 75 a été
- Page 134 and 135: L'équipe organise son travail de m
- Page 136 and 137: Outre l’absence de qualification
- Page 138 and 139: Les projets Scopados s’inscrivent
- Page 140 and 141: PARTIE 2 : éléments d’analyseL
- Page 144 and 145: La construction de cette identité
- Page 146 and 147: epérer si le groupe permet au jeun
- Page 148 and 149: On voit donc que le groupe protège
- Page 150 and 151: Souvent, les éducateurs remarquent
- Page 152 and 153: La stabilité des groupesDe manièr
- Page 156 and 157: jeunes, comme nous l’explique Dav
- Page 158 and 159: Pour conclure, les jeunes membres d
- Page 160 and 161: pairs. » 151 Ainsi, les jeunes rè
- Page 162 and 163: Le squat qui peut, par exemple, êt
- Page 164 and 165: s’instaure le contact entre les
- Page 166 and 167: associatives. Ils sont liés aux ca
- Page 168 and 169: signifie qu’il constitue pour eux
- Page 170 and 171: interlocuteurs, de « patiente et r
- Page 172 and 173: plusieurs membres du groupe. Vraise
- Page 174 and 175: l’activité de boxe thaïlandaise
- Page 176 and 177: La composition du groupe témoigne
- Page 178 and 179: « Il faut un support concret » af
- Page 180 and 181: modifier les comportements individu
- Page 182 and 183: l’ensemble des raisons. Celles-ci
- Page 184 and 185: champ professionnel 176 .A certaine
- Page 186 and 187: individuels sur le plan de la sant
- Page 188 and 189: a traversé les mouvements éducati
- Page 190 and 191: econstruire ensuite différemment,
- Page 192 and 193:
empirique de l’action auprès des
- Page 194 and 195:
manifesté à ces occasions à cett
- Page 196 and 197:
d’entraînement au petit matin da
- Page 198 and 199:
compétences tiennent autant à une
- Page 200 and 201:
correspondants de nuit, animateurs,
- Page 202 and 203:
ANNEXESGroupes de jeunes et pratiqu
- Page 204 and 205:
Le Conseil Technique remercie égal
- Page 206 and 207:
DESCOURTIS Jean-Luc, directeur, ARC
- Page 208 and 209:
CHOBEAUX François, Les nomades du
- Page 210 and 211:
Rapports et étudesAPASE, Les jeune
- Page 212:
Communauté d’agglomération du P