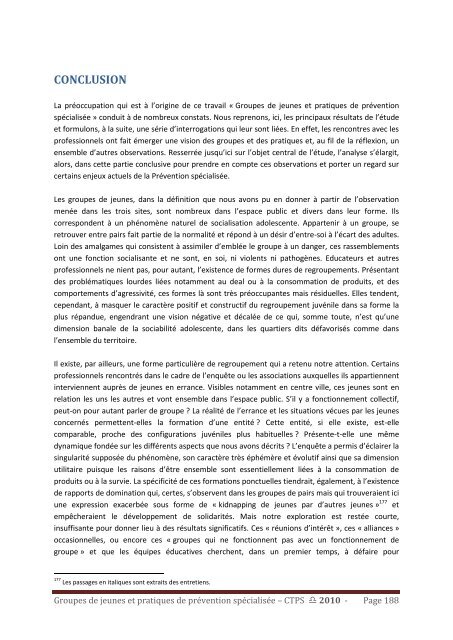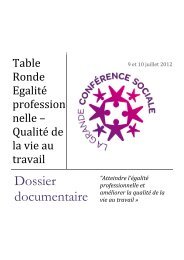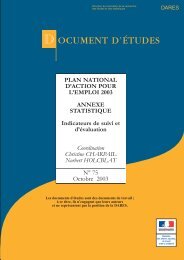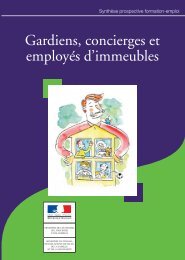Groupes de jeunes et pratiques de prévention spécialisée
Groupes de jeunes et pratiques de prévention spécialisée
Groupes de jeunes et pratiques de prévention spécialisée
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CONCLUSIONLa préoccupation qui est à l’origine <strong>de</strong> ce travail « <strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> préventionspécialisée » conduit à <strong>de</strong> nombreux constats. Nous reprenons, ici, les principaux résultats <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><strong>et</strong> formulons, à la suite, une série d’interrogations qui leur sont liées. En eff<strong>et</strong>, les rencontres avec lesprofessionnels ont fait émerger une vision <strong>de</strong>s groupes <strong>et</strong> <strong>de</strong>s <strong>pratiques</strong> <strong>et</strong>, au fil <strong>de</strong> la réflexion, unensemble d’autres observations. Resserrée jusqu’ici sur l’obj<strong>et</strong> central <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>, l’analyse s’élargit,alors, dans c<strong>et</strong>te partie conclusive pour prendre en compte ces observations <strong>et</strong> porter un regard surcertains enjeux actuels <strong>de</strong> la Prévention spécialisée.Les groupes <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong>, dans la définition que nous avons pu en donner à partir <strong>de</strong> l’observationmenée dans les trois sites, sont nombreux dans l’espace public <strong>et</strong> divers dans leur forme. Ilscorrespon<strong>de</strong>nt à un phénomène naturel <strong>de</strong> socialisation adolescente. Appartenir à un groupe, ser<strong>et</strong>rouver entre pairs fait partie <strong>de</strong> la normalité <strong>et</strong> répond à un désir d’entre-soi à l’écart <strong>de</strong>s adultes.Loin <strong>de</strong>s amalgames qui consistent à assimiler d’emblée le groupe à un danger, ces rassemblementsont une fonction socialisante <strong>et</strong> ne sont, en soi, ni violents ni pathogènes. Educateurs <strong>et</strong> autresprofessionnels ne nient pas, pour autant, l’existence <strong>de</strong> formes dures <strong>de</strong> regroupements. Présentant<strong>de</strong>s problématiques lour<strong>de</strong>s liées notamment au <strong>de</strong>al ou à la consommation <strong>de</strong> produits, <strong>et</strong> <strong>de</strong>scomportements d’agressivité, ces formes là sont très préoccupantes mais résiduelles. Elles ten<strong>de</strong>nt,cependant, à masquer le caractère positif <strong>et</strong> constructif du regroupement juvénile dans sa forme laplus répandue, engendrant une vision négative <strong>et</strong> décalée <strong>de</strong> ce qui, somme toute, n’est qu’unedimension banale <strong>de</strong> la sociabilité adolescente, dans les quartiers dits défavorisés comme dansl’ensemble du territoire.Il existe, par ailleurs, une forme particulière <strong>de</strong> regroupement qui a r<strong>et</strong>enu notre attention. Certainsprofessionnels rencontrés dans le cadre <strong>de</strong> l’enquête ou les associations auxquelles ils appartiennentinterviennent auprès <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> en errance. Visibles notamment en centre ville, ces <strong>jeunes</strong> sont enrelation les uns les autres <strong>et</strong> vont ensemble dans l’espace public. S’il y a fonctionnement collectif,peut-on pour autant parler <strong>de</strong> groupe ? La réalité <strong>de</strong> l’errance <strong>et</strong> les situations vécues par les <strong>jeunes</strong>concernés perm<strong>et</strong>tent-elles la formation d’une entité ? C<strong>et</strong>te entité, si elle existe, est-ellecomparable, proche <strong>de</strong>s configurations juvéniles plus habituelles ? Présente-t-elle une mêmedynamique fondée sur les différents aspects que nous avons décrits ? L’enquête a permis d’éclairer lasingularité supposée du phénomène, son caractère très éphémère <strong>et</strong> évolutif ainsi que sa dimensionutilitaire puisque les raisons d’être ensemble sont essentiellement liées à la consommation <strong>de</strong>produits ou à la survie. La spécificité <strong>de</strong> ces formations ponctuelles tiendrait, également, à l’existence<strong>de</strong> rapports <strong>de</strong> domination qui, certes, s’observent dans les groupes <strong>de</strong> pairs mais qui trouveraient iciune expression exacerbée sous forme <strong>de</strong> « kidnapping <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> par d’autres <strong>jeunes</strong> » 177 <strong>et</strong>empêcheraient le développement <strong>de</strong> solidarités. Mais notre exploration est restée courte,insuffisante pour donner lieu à <strong>de</strong>s résultats significatifs. Ces « réunions d’intérêt », ces « alliances »occasionnelles, ou encore ces « groupes qui ne fonctionnent pas avec un fonctionnement <strong>de</strong>groupe » <strong>et</strong> que les équipes éducatives cherchent, dans un premier temps, à défaire pour177 Les passages en italiques sont extraits <strong>de</strong>s entr<strong>et</strong>iens.<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 188