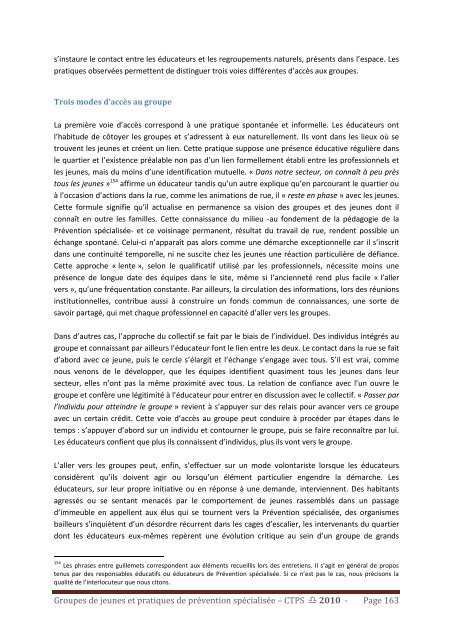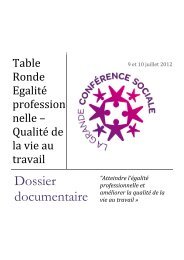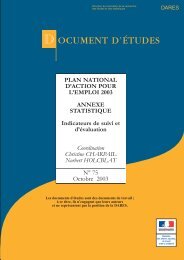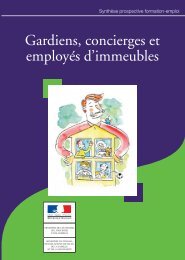s’instaure le contact entre les éducateurs <strong>et</strong> les regroupements naturels, présents dans l’espace. Les<strong>pratiques</strong> observées perm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong> distinguer trois voies différentes d’accès aux groupes.Trois mo<strong>de</strong>s d’accès au groupeLa première voie d’accès correspond à une pratique spontanée <strong>et</strong> informelle. Les éducateurs ontl’habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> côtoyer les groupes <strong>et</strong> s’adressent à eux naturellement. Ils vont dans les lieux où s<strong>et</strong>rouvent les <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> créent un lien. C<strong>et</strong>te pratique suppose une présence éducative régulière dansle quartier <strong>et</strong> l’existence préalable non pas d’un lien formellement établi entre les professionnels <strong>et</strong>les <strong>jeunes</strong>, mais du moins d’une i<strong>de</strong>ntification mutuelle. « Dans notre secteur, on connaît à peu prèstous les <strong>jeunes</strong> » 154 affirme un éducateur tandis qu’un autre explique qu’en parcourant le quartier ouà l’occasion d’actions dans la rue, comme les animations <strong>de</strong> rue, il « reste en phase » avec les <strong>jeunes</strong>.C<strong>et</strong>te formule signifie qu’il actualise en permanence sa vision <strong>de</strong>s groupes <strong>et</strong> <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> dont ilconnaît en outre les familles. C<strong>et</strong>te connaissance du milieu -au fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la pédagogie <strong>de</strong> laPrévention spécialisée- <strong>et</strong> ce voisinage permanent, résultat du travail <strong>de</strong> rue, ren<strong>de</strong>nt possible unéchange spontané. Celui-ci n’apparaît pas alors comme une démarche exceptionnelle car il s’inscritdans une continuité temporelle, ni ne suscite chez les <strong>jeunes</strong> une réaction particulière <strong>de</strong> défiance.C<strong>et</strong>te approche « lente », selon le qualificatif utilisé par les professionnels, nécessite moins uneprésence <strong>de</strong> longue date <strong>de</strong>s équipes dans le site, même si l’ancienn<strong>et</strong>é rend plus facile « l’allervers », qu’une fréquentation constante. Par ailleurs, la circulation <strong>de</strong>s informations, lors <strong>de</strong>s réunionsinstitutionnelles, contribue aussi à construire un fonds commun <strong>de</strong> connaissances, une sorte <strong>de</strong>savoir partagé, qui m<strong>et</strong> chaque professionnel en capacité d’aller vers les groupes.Dans d’autres cas, l’approche du collectif se fait par le biais <strong>de</strong> l’individuel. Des individus intégrés augroupe <strong>et</strong> connaissant par ailleurs l’éducateur font le lien entre les <strong>de</strong>ux. Le contact dans la rue se faitd’abord avec ce jeune, puis le cercle s’élargit <strong>et</strong> l’échange s’engage avec tous. S’il est vrai, commenous venons <strong>de</strong> le développer, que les équipes i<strong>de</strong>ntifient quasiment tous les <strong>jeunes</strong> dans leursecteur, elles n’ont pas la même proximité avec tous. La relation <strong>de</strong> confiance avec l’un ouvre legroupe <strong>et</strong> confère une légitimité à l’éducateur pour entrer en discussion avec le collectif. « Passer parl’individu pour atteindre le groupe » revient à s’appuyer sur <strong>de</strong>s relais pour avancer vers ce groupeavec un certain crédit. C<strong>et</strong>te voie d’accès au groupe peut conduire à procé<strong>de</strong>r par étapes dans l<strong>et</strong>emps : s’appuyer d’abord sur un individu <strong>et</strong> contourner le groupe, puis se faire reconnaître par lui.Les éducateurs confient que plus ils connaissent d’individus, plus ils vont vers le groupe.L’aller vers les groupes peut, enfin, s’effectuer sur un mo<strong>de</strong> volontariste lorsque les éducateursconsidèrent qu’ils doivent agir ou lorsqu’un élément particulier engendre la démarche. Leséducateurs, sur leur propre initiative ou en réponse à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, interviennent. Des habitantsagressés ou se sentant menacés par le comportement <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> rassemblés dans un passaged’immeuble en appellent aux élus qui se tournent vers la Prévention spécialisée, <strong>de</strong>s organismesbailleurs s’inquiètent d’un désordre récurrent dans les cages d’escalier, les intervenants du quartierdont les éducateurs eux-mêmes repèrent une évolution critique au sein d’un groupe <strong>de</strong> grands154 Les phrases entre guillem<strong>et</strong>s correspon<strong>de</strong>nt aux éléments recueillis lors <strong>de</strong>s entr<strong>et</strong>iens. Il s’agit en général <strong>de</strong> propostenus par <strong>de</strong>s responsables éducatifs ou éducateurs <strong>de</strong> Prévention spécialisée. Si ce n’est pas le cas, nous précisons laqualité <strong>de</strong> l’interlocuteur que nous citons.<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 163
adolescents en rupture scolaire qui gravitent autour du « <strong>de</strong>al »… Faits objectifs ou éléments <strong>de</strong>ressenti créent une forme d’urgence <strong>et</strong> une obligation d’intervention pour la Prévention spécialisée.Quels que soient l’élément déclencheur <strong>et</strong> la gravité, réelle ou perçue, <strong>de</strong> la situation, le schémad’intervention est le même. Les professionnels s’adressent aux groupes. S’ils ne sont pas connus, ilsse présentent, veillent à être i<strong>de</strong>ntifiés par leur fonction éducative <strong>et</strong> expliquent la raison <strong>de</strong> ladémarche n’hésitant pas à faire état d’éléments précis concernant ce qui fait problème. Unéducateur décrit son mo<strong>de</strong> d’action dans <strong>de</strong> tels contextes : « je vais voir le groupe directement, jeme présente <strong>et</strong> j’annonce, je dis : on a entendu… ». L’approche du groupe est donc sans détours <strong>et</strong>directe.Ce schéma d’intervention correspond communément à <strong>de</strong>s situations où la Prévention estinterpellée. Les <strong>de</strong>ux, abord direct du groupe <strong>et</strong> interpellation, vont assez bien <strong>de</strong> pair dans la mesureoù l’interpellation traduit une urgence qui conduit ou oblige la Prévention à se mobiliser. Mais ils nesont pas forcément associés. Si elle procè<strong>de</strong> d’une réalité ressentie comme inquiétante <strong>et</strong> critique,l’interpellation ne s’accompagne pas forcément d’une action immédiate. Expliquer <strong>et</strong> fournir unemeilleure connaissance <strong>de</strong> la situation préoccupante constitue une autre forme <strong>de</strong> réponse adosséeau maintien d’une veille éducative.C’est l’équipe qui apprécie le mo<strong>de</strong> d’action vis-à-vis <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> le type <strong>de</strong> réponse aux différentessollicitations dont elle fait l’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s élus, <strong>de</strong>s associations, <strong>de</strong>s habitants, <strong>de</strong>s autoritéslocales. Par exemple, interpellée par la mairie <strong>de</strong> secteur, l’équipe Mozaïc répond <strong>et</strong> se rend auprès<strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> qui « squattent » une impasse près d’une artère centrale du quartier. L’abord <strong>de</strong>sgroupes se fait, a fortiori, <strong>de</strong> façon ostensible si l’obligation d’intervention est inscrite dans lesmissions constitutives <strong>de</strong> l’équipe <strong>et</strong> dans ses orientations d’action comme c’est le cas dans le Paysvoironnais. Les éducateurs se déplacent vers les communes non prioritaires <strong>de</strong>s espaces ruraux ousemi-ruraux, lorsqu’ils sont saisis d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> par les élus à l’issue d’une procédure codifiée. Ils sem<strong>et</strong>tent en contact avec les groupes <strong>et</strong> annoncent les raisons <strong>de</strong> leur venue. Leur attitu<strong>de</strong> directemais contenue <strong>et</strong> sobre, qui se gar<strong>de</strong> <strong>de</strong> tout « entrisme » s’accompagne ensuite d’un diagnosticrapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> la situation. L’idée <strong>de</strong> ce diagnostic est d’ajuster le niveau <strong>de</strong> la réponse sur le plan éducatifmais également sur le plan social <strong>et</strong> politique, c’est-à-dire clarifier les attentes, transformer ouapaiser les représentations négatives du phénomène.Ces trois schémas se dégagent <strong>de</strong>s <strong>pratiques</strong> observées dans les sites, où ils coexistent <strong>de</strong> façon nonexclusive. Ils se combinent partout à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés divers <strong>et</strong>, selon le site, l’un ou l’autre tend àdominer. Mozaïc offre plutôt l’exemple d’une équipe qui a l’habitu<strong>de</strong> d’aller <strong>de</strong> façon naturelle <strong>et</strong>quotidienne vers les groupes implantés dans son secteur. De même la JEEP privilégie volontiers lesschémas <strong>de</strong> l’approche informelle <strong>et</strong> du lien préalable avec <strong>de</strong>s individus comme relais pour accé<strong>de</strong>raux groupes. Il est vrai que ces <strong>de</strong>ux équipes bénéficient d’une bonne antériorité, elles sontimplantées <strong>de</strong>puis longtemps dans leur quartier où elles exercent une veille permanente. Ellesadoptent peu l’approche directe, à la différence <strong>de</strong> l’équipe du voironnais pour laquelle, ainsi quenous venons <strong>de</strong> l’indiquer, c’est le principal mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> rencontre avec les groupes sur les sites nonprioritaires.La façon d’abor<strong>de</strong>r les groupes dépend donc d’un ensemble <strong>de</strong> facteurs. Ces facteurs sontinstitutionnels, liés à la définition <strong>de</strong> la mission <strong>de</strong> Prévention spécialisée ou aux orientations<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 164
- Page 5 and 6:
2 - Le sens d’une action communau
- Page 7 and 8:
AVANT PROPOSLe phénomène des band
- Page 10 and 11:
L’une et l’autre contribuent à
- Page 12 and 13:
Cette seconde étape a été engag
- Page 14 and 15:
CONSTATS ET PRECONISATIONS5 CONSTAT
- Page 16 and 17:
partenariales se développent parfo
- Page 18 and 19:
Les comportements violents et déli
- Page 20 and 21:
jeunes à la relation proposée. El
- Page 22 and 23:
7.2 - L’évaluation en préventio
- Page 24 and 25:
P 10. Prendre en compte les tension
- Page 26 and 27:
I - GROUPES DE JEUNES ET PRATIQUES
- Page 28 and 29:
sans emploi ou exclus de l’école
- Page 30 and 31:
devient « un régulateur social »
- Page 32 and 33:
libération, après la seconde guer
- Page 34 and 35:
l’animation sportive ou culturell
- Page 36 and 37:
L’approche de la personnalité gl
- Page 40 and 41:
ite permet de construire. De façon
- Page 42 and 43:
2 - Formes actuelles de regroupemen
- Page 44 and 45:
Les groupes virtuelsLes jeunes sont
- Page 46 and 47:
4 - Structuration et fonctionnement
- Page 48 and 49:
en tant que travailleur social. ..
- Page 50 and 51:
fonctionnement marginal et délictu
- Page 54 and 55:
liée à l’absence d’intériori
- Page 56 and 57:
Une pratique sociale collective a p
- Page 58 and 59:
CHAPITRE 5 : LES ATTENTES ET COMMAN
- Page 60 and 61:
« Le champ d’intervention de la
- Page 62 and 63:
Dans le projet de Contrat local de
- Page 64 and 65:
CHAPITRE 6 : AGIR AVEC LE GROUPELes
- Page 66 and 67:
Le comportement de jeunes en situat
- Page 68 and 69:
L’évaluation des actions entrepr
- Page 70 and 71:
5. Ces éducateurs vont essayer d
- Page 72 and 73:
La complexité des interactions dan
- Page 74 and 75:
La réflexion concernant cette rech
- Page 76 and 77:
P O S T F A C EL’incompréhension
- Page 78 and 79:
Les travaux du CTPS ne nient pas la
- Page 80 and 81:
ANNEXE : Questionnaire flashAnalyse
- Page 82 and 83:
MasculinFémininmixte18ansMono ethn
- Page 84 and 85:
CONSEIL TECHNIQUEDES CLUBS ET EQUIP
- Page 86 and 87:
II- PRATIQUES EDUCATIVES ET GROUPES
- Page 88 and 89:
son action sur les jeunes et sur le
- Page 90 and 91:
précarisées. Ce site nous a permi
- Page 92 and 93:
PARTIE 1 : Monographies des sitesCe
- Page 94 and 95:
les familles se connaissent entre e
- Page 96 and 97:
de 6 à 18 ans pendant leur temps l
- Page 98 and 99:
public. Pour l’association et ses
- Page 100 and 101:
dans l’espace public) et l’acco
- Page 102 and 103:
moyens : les éducateurs ne peuvent
- Page 104 and 105:
démarches liées au projet mais é
- Page 106 and 107:
Le projet Futsal : une salle en ges
- Page 108 and 109:
CHAPITRE 2 : Le Neuhof - JEEP1 - Le
- Page 110 and 111:
pourcentage, le plus haut comparati
- Page 112 and 113:
esponsables du collège qui, lors d
- Page 114 and 115: La Jeep se compose d’une directio
- Page 116 and 117: développent d’autres actions sur
- Page 118 and 119: traduit le choix de l’équipe de
- Page 120 and 121: Par différence, le registre d’in
- Page 122 and 123: La présence dans les établissemen
- Page 124 and 125: organisé par les éducateurs de la
- Page 126 and 127: CHAPITRE 3 : Paris 18è - ARC 75/Mo
- Page 128 and 129: commune à tous les jeunes du quart
- Page 130 and 131: En 2007, l'association ARC 75 a men
- Page 132 and 133: d'intervention pour ARC 75 a été
- Page 134 and 135: L'équipe organise son travail de m
- Page 136 and 137: Outre l’absence de qualification
- Page 138 and 139: Les projets Scopados s’inscrivent
- Page 140 and 141: PARTIE 2 : éléments d’analyseL
- Page 142 and 143: Enfin, un autre critère central da
- Page 144 and 145: La construction de cette identité
- Page 146 and 147: epérer si le groupe permet au jeun
- Page 148 and 149: On voit donc que le groupe protège
- Page 150 and 151: Souvent, les éducateurs remarquent
- Page 152 and 153: La stabilité des groupesDe manièr
- Page 156 and 157: jeunes, comme nous l’explique Dav
- Page 158 and 159: Pour conclure, les jeunes membres d
- Page 160 and 161: pairs. » 151 Ainsi, les jeunes rè
- Page 162 and 163: Le squat qui peut, par exemple, êt
- Page 166 and 167: associatives. Ils sont liés aux ca
- Page 168 and 169: signifie qu’il constitue pour eux
- Page 170 and 171: interlocuteurs, de « patiente et r
- Page 172 and 173: plusieurs membres du groupe. Vraise
- Page 174 and 175: l’activité de boxe thaïlandaise
- Page 176 and 177: La composition du groupe témoigne
- Page 178 and 179: « Il faut un support concret » af
- Page 180 and 181: modifier les comportements individu
- Page 182 and 183: l’ensemble des raisons. Celles-ci
- Page 184 and 185: champ professionnel 176 .A certaine
- Page 186 and 187: individuels sur le plan de la sant
- Page 188 and 189: a traversé les mouvements éducati
- Page 190 and 191: econstruire ensuite différemment,
- Page 192 and 193: empirique de l’action auprès des
- Page 194 and 195: manifesté à ces occasions à cett
- Page 196 and 197: d’entraînement au petit matin da
- Page 198 and 199: compétences tiennent autant à une
- Page 200 and 201: correspondants de nuit, animateurs,
- Page 202 and 203: ANNEXESGroupes de jeunes et pratiqu
- Page 204 and 205: Le Conseil Technique remercie égal
- Page 206 and 207: DESCOURTIS Jean-Luc, directeur, ARC
- Page 208 and 209: CHOBEAUX François, Les nomades du
- Page 210 and 211: Rapports et étudesAPASE, Les jeune
- Page 212: Communauté d’agglomération du P