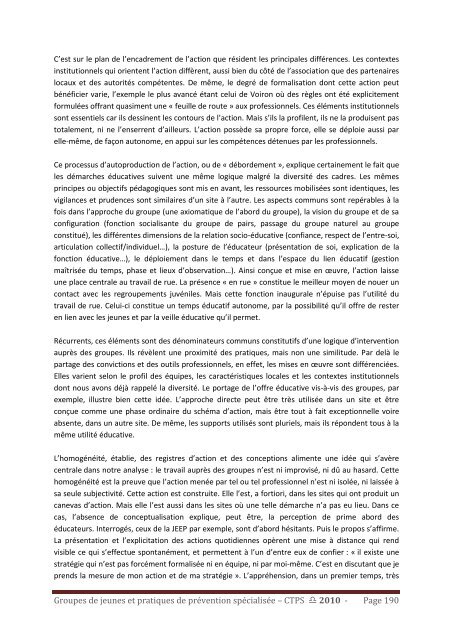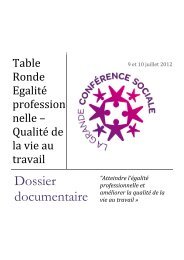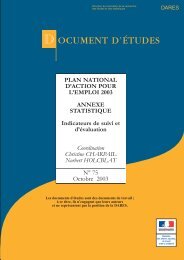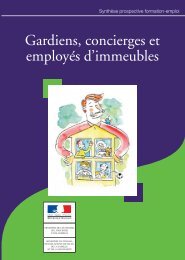econstruire ensuite différemment, méritent, sans doute, une investigation plus fine que l’approcherapi<strong>de</strong> que nous avons pu leur consacrer.Sur un plan plus général, si l’existence <strong>de</strong> groupes ne suscite pas d’inquiétu<strong>de</strong> particulière chez lesprofessionnels, elle engendre, par contre, une préoccupation éducative présente dans les trois sites.L’action envers les groupes fait donc partie <strong>de</strong>s <strong>pratiques</strong> communes. Les équipes la décrivent, lacommentent, l’illustrent sans om<strong>et</strong>tre <strong>de</strong> rappeler que l’attention portée au groupe est uneorientation constitutive, historiquement, <strong>de</strong> leur mission spécifique. Par leur propos, elles valorisentles <strong>de</strong>ux aspects <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te action. Le premier consiste à être en interaction avec l’entité présente dansl’espace public ou « groupe naturel » <strong>et</strong> sans que cela conduise forcément à une activité structuréeou à un suivi. Le second, plus visible, consiste à mener un proj<strong>et</strong> éducatif précis avec un ensemblei<strong>de</strong>ntifié d’individus formant alors le « groupe constitué ». Entre ces <strong>de</strong>ux formes groupales, il n’y apas rupture ou opposition, mais continuité. La simple présence éducative, en eff<strong>et</strong>, reconfigure legroupe naturel qui se constitue dans une forme nouvelle. Et, inversement, c<strong>et</strong>te reconfiguration rendpossible <strong>de</strong>s appariements nouveaux <strong>et</strong> spontanés entre pairs. Les représentations communes,cependant, s’attachent essentiellement aux <strong>pratiques</strong> avec les collectifs constitués. Celles-citendraient à résumer le travail avec les groupes, alors qu’elles ne sont que l’aboutissement durapprochement effectué en amont par l’éducateur, lors du temps passé « en rue », avec lesregroupements naturels.C<strong>et</strong>te prégnance <strong>de</strong> l’action envers les groupes, résultat essentiel compte tenu <strong>de</strong> nos axesd’investigation, peut sembler comporter une part d’évi<strong>de</strong>nce. En eff<strong>et</strong>, <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>s trois sites r<strong>et</strong>enussont connus pour accor<strong>de</strong>r une importance <strong>de</strong> premier plan à l’action <strong>de</strong> type collectif par rapport àl’individuel. Mais nous n’avons pas seulement recueilli, dans le Pays voironnais ou dans le 18èarrondissement à Paris, ce qui était donné d’avance. Nous l’avons mis à l’épreuve du concr<strong>et</strong> enexaminant méthodiquement les mises en œuvre. Pour la JEEP à Strasbourg, par différence, c<strong>et</strong>temodalité <strong>de</strong> travail ne fait pas l’obj<strong>et</strong> d’un affichage, mais les récits <strong>de</strong>s éducateurs font apparaîtrel’intérêt qui lui est porté. On peut penser que l’étu<strong>de</strong> a un eff<strong>et</strong> immédiat <strong>de</strong> dévoilement : elledonnerait à la réalité le sens attendu <strong>et</strong> révèlerait l’obj<strong>et</strong> même. Cependant, <strong>et</strong> c’est ce qui estintéressant, quels que soient les contextes <strong>de</strong> départ –affichage ou non d’une priorité <strong>de</strong> travail, miseen avant du groupe comme support éducatif, tentative ou non <strong>de</strong> codification <strong>de</strong> l’action…- lesdiscours <strong>et</strong> les <strong>pratiques</strong> éducatifs se rejoignent d’un site à l’autre. On peut donc formuler unedouble conclusion. D’une part, l’action auprès <strong>de</strong>s groupes correspond à une pratique effective.D’autre part, elle n’est pas un impensé dans le sens où les professionnels sont en capacité <strong>de</strong> faireétat <strong>de</strong> <strong>pratiques</strong> spécifiques, qu’elles soient i<strong>de</strong>ntifiées comme telles a priori ou a posteriori, <strong>et</strong> <strong>de</strong>produire une analyse sur les raisons <strong>et</strong> les enjeux <strong>de</strong> celles-ci.L’action auprès <strong>de</strong>s groupes n’est pas un impenséLe décryptage <strong>de</strong>s <strong>pratiques</strong> a permis <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre en évi<strong>de</strong>nce les éléments <strong>de</strong> l’action. Ceux-ci sontprésentés <strong>de</strong> façon détaillée dans le texte. Ils sont en partie distincts <strong>et</strong> en partie communs auxdifférents sites.<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 189
C’est sur le plan <strong>de</strong> l’encadrement <strong>de</strong> l’action que rési<strong>de</strong>nt les principales différences. Les contextesinstitutionnels qui orientent l’action diffèrent, aussi bien du côté <strong>de</strong> l’association que <strong>de</strong>s partenaireslocaux <strong>et</strong> <strong>de</strong>s autorités compétentes. De même, le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> formalisation dont c<strong>et</strong>te action peutbénéficier varie, l’exemple le plus avancé étant celui <strong>de</strong> Voiron où <strong>de</strong>s règles ont été explicitementformulées offrant quasiment une « feuille <strong>de</strong> route » aux professionnels. Ces éléments institutionnelssont essentiels car ils <strong>de</strong>ssinent les contours <strong>de</strong> l’action. Mais s’ils la profilent, ils ne la produisent pastotalement, ni ne l’enserrent d’ailleurs. L’action possè<strong>de</strong> sa propre force, elle se déploie aussi parelle-même, <strong>de</strong> façon autonome, en appui sur les compétences détenues par les professionnels.Ce processus d’autoproduction <strong>de</strong> l’action, ou <strong>de</strong> « débor<strong>de</strong>ment », explique certainement le fait queles démarches éducatives suivent une même logique malgré la diversité <strong>de</strong>s cadres. Les mêmesprincipes ou objectifs pédagogiques sont mis en avant, les ressources mobilisées sont i<strong>de</strong>ntiques, lesvigilances <strong>et</strong> pru<strong>de</strong>nces sont similaires d’un site à l’autre. Les aspects communs sont repérables à lafois dans l’approche du groupe (une axiomatique <strong>de</strong> l’abord du groupe), la vision du groupe <strong>et</strong> <strong>de</strong> saconfiguration (fonction socialisante du groupe <strong>de</strong> pairs, passage du groupe naturel au groupeconstitué), les différentes dimensions <strong>de</strong> la relation socio-éducative (confiance, respect <strong>de</strong> l’entre-soi,articulation collectif/individuel…), la posture <strong>de</strong> l’éducateur (présentation <strong>de</strong> soi, explication <strong>de</strong> lafonction éducative…), le déploiement dans le temps <strong>et</strong> dans l’espace du lien éducatif (gestionmaîtrisée du temps, phase <strong>et</strong> lieux d’observation…). Ainsi conçue <strong>et</strong> mise en œuvre, l’action laisseune place centrale au travail <strong>de</strong> rue. La présence « en rue » constitue le meilleur moyen <strong>de</strong> nouer uncontact avec les regroupements juvéniles. Mais c<strong>et</strong>te fonction inaugurale n’épuise pas l’utilité dutravail <strong>de</strong> rue. Celui-ci constitue un temps éducatif autonome, par la possibilité qu’il offre <strong>de</strong> resteren lien avec les <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> par la veille éducative qu’il perm<strong>et</strong>.Récurrents, ces éléments sont <strong>de</strong>s dénominateurs communs constitutifs d’une logique d’interventionauprès <strong>de</strong>s groupes. Ils révèlent une proximité <strong>de</strong>s <strong>pratiques</strong>, mais non une similitu<strong>de</strong>. Par <strong>de</strong>là lepartage <strong>de</strong>s convictions <strong>et</strong> <strong>de</strong>s outils professionnels, en eff<strong>et</strong>, les mises en œuvre sont différenciées.Elles varient selon le profil <strong>de</strong>s équipes, les caractéristiques locales <strong>et</strong> les contextes institutionnelsdont nous avons déjà rappelé la diversité. Le portage <strong>de</strong> l’offre éducative vis-à-vis <strong>de</strong>s groupes, parexemple, illustre bien c<strong>et</strong>te idée. L’approche directe peut être très utilisée dans un site <strong>et</strong> êtreconçue comme une phase ordinaire du schéma d’action, mais être tout à fait exceptionnelle voireabsente, dans un autre site. De même, les supports utilisés sont pluriels, mais ils répon<strong>de</strong>nt tous à lamême utilité éducative.L’homogénéité, établie, <strong>de</strong>s registres d’action <strong>et</strong> <strong>de</strong>s conceptions alimente une idée qui s’avèrecentrale dans notre analyse : le travail auprès <strong>de</strong>s groupes n’est ni improvisé, ni dû au hasard. C<strong>et</strong>tehomogénéité est la preuve que l’action menée par tel ou tel professionnel n’est ni isolée, ni laissée àsa seule subjectivité. C<strong>et</strong>te action est construite. Elle l’est, a fortiori, dans les sites qui ont produit uncanevas d’action. Mais elle l’est aussi dans les sites où une telle démarche n’a pas eu lieu. Dans cecas, l’absence <strong>de</strong> conceptualisation explique, peut être, la perception <strong>de</strong> prime abord <strong>de</strong>séducateurs. Interrogés, ceux <strong>de</strong> la JEEP par exemple, sont d’abord hésitants. Puis le propos s’affirme.La présentation <strong>et</strong> l’explicitation <strong>de</strong>s actions quotidiennes opèrent une mise à distance qui rendvisible ce qui s’effectue spontanément, <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tent à l’un d’entre eux <strong>de</strong> confier : « il existe unestratégie qui n’est pas forcément formalisée ni en équipe, ni par moi-même. C’est en discutant que jeprends la mesure <strong>de</strong> mon action <strong>et</strong> <strong>de</strong> ma stratégie ». L’appréhension, dans un premier temps, très<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 190
- Page 5 and 6:
2 - Le sens d’une action communau
- Page 7 and 8:
AVANT PROPOSLe phénomène des band
- Page 10 and 11:
L’une et l’autre contribuent à
- Page 12 and 13:
Cette seconde étape a été engag
- Page 14 and 15:
CONSTATS ET PRECONISATIONS5 CONSTAT
- Page 16 and 17:
partenariales se développent parfo
- Page 18 and 19:
Les comportements violents et déli
- Page 20 and 21:
jeunes à la relation proposée. El
- Page 22 and 23:
7.2 - L’évaluation en préventio
- Page 24 and 25:
P 10. Prendre en compte les tension
- Page 26 and 27:
I - GROUPES DE JEUNES ET PRATIQUES
- Page 28 and 29:
sans emploi ou exclus de l’école
- Page 30 and 31:
devient « un régulateur social »
- Page 32 and 33:
libération, après la seconde guer
- Page 34 and 35:
l’animation sportive ou culturell
- Page 36 and 37:
L’approche de la personnalité gl
- Page 40 and 41:
ite permet de construire. De façon
- Page 42 and 43:
2 - Formes actuelles de regroupemen
- Page 44 and 45:
Les groupes virtuelsLes jeunes sont
- Page 46 and 47:
4 - Structuration et fonctionnement
- Page 48 and 49:
en tant que travailleur social. ..
- Page 50 and 51:
fonctionnement marginal et délictu
- Page 54 and 55:
liée à l’absence d’intériori
- Page 56 and 57:
Une pratique sociale collective a p
- Page 58 and 59:
CHAPITRE 5 : LES ATTENTES ET COMMAN
- Page 60 and 61:
« Le champ d’intervention de la
- Page 62 and 63:
Dans le projet de Contrat local de
- Page 64 and 65:
CHAPITRE 6 : AGIR AVEC LE GROUPELes
- Page 66 and 67:
Le comportement de jeunes en situat
- Page 68 and 69:
L’évaluation des actions entrepr
- Page 70 and 71:
5. Ces éducateurs vont essayer d
- Page 72 and 73:
La complexité des interactions dan
- Page 74 and 75:
La réflexion concernant cette rech
- Page 76 and 77:
P O S T F A C EL’incompréhension
- Page 78 and 79:
Les travaux du CTPS ne nient pas la
- Page 80 and 81:
ANNEXE : Questionnaire flashAnalyse
- Page 82 and 83:
MasculinFémininmixte18ansMono ethn
- Page 84 and 85:
CONSEIL TECHNIQUEDES CLUBS ET EQUIP
- Page 86 and 87:
II- PRATIQUES EDUCATIVES ET GROUPES
- Page 88 and 89:
son action sur les jeunes et sur le
- Page 90 and 91:
précarisées. Ce site nous a permi
- Page 92 and 93:
PARTIE 1 : Monographies des sitesCe
- Page 94 and 95:
les familles se connaissent entre e
- Page 96 and 97:
de 6 à 18 ans pendant leur temps l
- Page 98 and 99:
public. Pour l’association et ses
- Page 100 and 101:
dans l’espace public) et l’acco
- Page 102 and 103:
moyens : les éducateurs ne peuvent
- Page 104 and 105:
démarches liées au projet mais é
- Page 106 and 107:
Le projet Futsal : une salle en ges
- Page 108 and 109:
CHAPITRE 2 : Le Neuhof - JEEP1 - Le
- Page 110 and 111:
pourcentage, le plus haut comparati
- Page 112 and 113:
esponsables du collège qui, lors d
- Page 114 and 115:
La Jeep se compose d’une directio
- Page 116 and 117:
développent d’autres actions sur
- Page 118 and 119:
traduit le choix de l’équipe de
- Page 120 and 121:
Par différence, le registre d’in
- Page 122 and 123:
La présence dans les établissemen
- Page 124 and 125:
organisé par les éducateurs de la
- Page 126 and 127:
CHAPITRE 3 : Paris 18è - ARC 75/Mo
- Page 128 and 129:
commune à tous les jeunes du quart
- Page 130 and 131:
En 2007, l'association ARC 75 a men
- Page 132 and 133:
d'intervention pour ARC 75 a été
- Page 134 and 135:
L'équipe organise son travail de m
- Page 136 and 137:
Outre l’absence de qualification
- Page 138 and 139:
Les projets Scopados s’inscrivent
- Page 140 and 141: PARTIE 2 : éléments d’analyseL
- Page 142 and 143: Enfin, un autre critère central da
- Page 144 and 145: La construction de cette identité
- Page 146 and 147: epérer si le groupe permet au jeun
- Page 148 and 149: On voit donc que le groupe protège
- Page 150 and 151: Souvent, les éducateurs remarquent
- Page 152 and 153: La stabilité des groupesDe manièr
- Page 156 and 157: jeunes, comme nous l’explique Dav
- Page 158 and 159: Pour conclure, les jeunes membres d
- Page 160 and 161: pairs. » 151 Ainsi, les jeunes rè
- Page 162 and 163: Le squat qui peut, par exemple, êt
- Page 164 and 165: s’instaure le contact entre les
- Page 166 and 167: associatives. Ils sont liés aux ca
- Page 168 and 169: signifie qu’il constitue pour eux
- Page 170 and 171: interlocuteurs, de « patiente et r
- Page 172 and 173: plusieurs membres du groupe. Vraise
- Page 174 and 175: l’activité de boxe thaïlandaise
- Page 176 and 177: La composition du groupe témoigne
- Page 178 and 179: « Il faut un support concret » af
- Page 180 and 181: modifier les comportements individu
- Page 182 and 183: l’ensemble des raisons. Celles-ci
- Page 184 and 185: champ professionnel 176 .A certaine
- Page 186 and 187: individuels sur le plan de la sant
- Page 188 and 189: a traversé les mouvements éducati
- Page 192 and 193: empirique de l’action auprès des
- Page 194 and 195: manifesté à ces occasions à cett
- Page 196 and 197: d’entraînement au petit matin da
- Page 198 and 199: compétences tiennent autant à une
- Page 200 and 201: correspondants de nuit, animateurs,
- Page 202 and 203: ANNEXESGroupes de jeunes et pratiqu
- Page 204 and 205: Le Conseil Technique remercie égal
- Page 206 and 207: DESCOURTIS Jean-Luc, directeur, ARC
- Page 208 and 209: CHOBEAUX François, Les nomades du
- Page 210 and 211: Rapports et étudesAPASE, Les jeune
- Page 212: Communauté d’agglomération du P