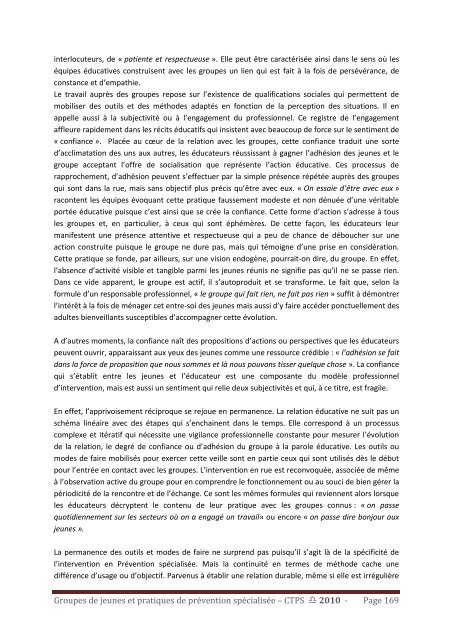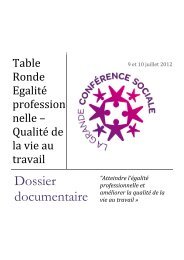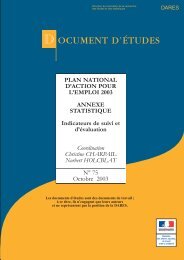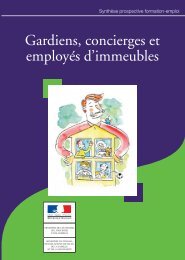interlocuteurs, <strong>de</strong> « patiente <strong>et</strong> respectueuse ». Elle peut être caractérisée ainsi dans le sens où leséquipes éducatives construisent avec les groupes un lien qui est fait à la fois <strong>de</strong> persévérance, <strong>de</strong>constance <strong>et</strong> d’empathie.Le travail auprès <strong>de</strong>s groupes repose sur l’existence <strong>de</strong> qualifications sociales qui perm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong>mobiliser <strong>de</strong>s outils <strong>et</strong> <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s adaptés en fonction <strong>de</strong> la perception <strong>de</strong>s situations. Il enappelle aussi à la subjectivité ou à l’engagement du professionnel. Ce registre <strong>de</strong> l’engagementaffleure rapi<strong>de</strong>ment dans les récits éducatifs qui insistent avec beaucoup <strong>de</strong> force sur le sentiment <strong>de</strong>« confiance ». Placée au cœur <strong>de</strong> la relation avec les groupes, c<strong>et</strong>te confiance traduit une sorted’acclimatation <strong>de</strong>s uns aux autres, les éducateurs réussissant à gagner l’adhésion <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> legroupe acceptant l’offre <strong>de</strong> socialisation que représente l’action éducative. Ces processus <strong>de</strong>rapprochement, d’adhésion peuvent s’effectuer par la simple présence répétée auprès <strong>de</strong>s groupesqui sont dans la rue, mais sans objectif plus précis qu’être avec eux. « On essaie d’être avec eux »racontent les équipes évoquant c<strong>et</strong>te pratique faussement mo<strong>de</strong>ste <strong>et</strong> non dénuée d’une véritableportée éducative puisque c’est ainsi que se crée la confiance. C<strong>et</strong>te forme d’action s’adresse à tousles groupes <strong>et</strong>, en particulier, à ceux qui sont éphémères. De c<strong>et</strong>te façon, les éducateurs leurmanifestent une présence attentive <strong>et</strong> respectueuse qui a peu <strong>de</strong> chance <strong>de</strong> déboucher sur uneaction construite puisque le groupe ne dure pas, mais qui témoigne d’une prise en considération.C<strong>et</strong>te pratique se fon<strong>de</strong>, par ailleurs, sur une vision endogène, pourrait-on dire, du groupe. En eff<strong>et</strong>,l’absence d’activité visible <strong>et</strong> tangible parmi les <strong>jeunes</strong> réunis ne signifie pas qu’il ne se passe rien.Dans ce vi<strong>de</strong> apparent, le groupe est actif, il s’autoproduit <strong>et</strong> se transforme. Le fait que, selon laformule d’un responsable professionnel, « le groupe qui fait rien, ne fait pas rien » suffit à démontrerl’intérêt à la fois <strong>de</strong> ménager c<strong>et</strong> entre-soi <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> mais aussi d’y faire accé<strong>de</strong>r ponctuellement <strong>de</strong>sadultes bienveillants susceptibles d’accompagner c<strong>et</strong>te évolution.A d’autres moments, la confiance naît <strong>de</strong>s propositions d’actions ou perspectives que les éducateurspeuvent ouvrir, apparaissant aux yeux <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> comme une ressource crédible : « l’adhésion se faitdans la force <strong>de</strong> proposition que nous sommes <strong>et</strong> là nous pouvons tisser quelque chose ». La confiancequi s’établit entre les <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> l’éducateur est une composante du modèle professionneld’intervention, mais est aussi un sentiment qui relie <strong>de</strong>ux subjectivités <strong>et</strong> qui, à ce titre, est fragile.En eff<strong>et</strong>, l’apprivoisement réciproque se rejoue en permanence. La relation éducative ne suit pas unschéma linéaire avec <strong>de</strong>s étapes qui s’enchainent dans le temps. Elle correspond à un processuscomplexe <strong>et</strong> itératif qui nécessite une vigilance professionnelle constante pour mesurer l’évolution<strong>de</strong> la relation, le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> confiance ou d’adhésion du groupe à la parole éducative. Les outils oumo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> faire mobilisés pour exercer c<strong>et</strong>te veille sont en partie ceux qui sont utilisés dès le débutpour l’entrée en contact avec les groupes. L’intervention en rue est reconvoquée, associée <strong>de</strong> mêmeà l’observation active du groupe pour en comprendre le fonctionnement ou au souci <strong>de</strong> bien gérer lapériodicité <strong>de</strong> la rencontre <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’échange. Ce sont les mêmes formules qui reviennent alors lorsqueles éducateurs décryptent le contenu <strong>de</strong> leur pratique avec les groupes connus : « on passequotidiennement sur les secteurs où on a engagé un travail» ou encore « on passe dire bonjour aux<strong>jeunes</strong> ».La permanence <strong>de</strong>s outils <strong>et</strong> mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> faire ne surprend pas puisqu’il s’agit là <strong>de</strong> la spécificité <strong>de</strong>l’intervention en Prévention spécialisée. Mais la continuité en termes <strong>de</strong> métho<strong>de</strong> cache unedifférence d’usage ou d’objectif. Parvenus à établir une relation durable, même si elle est irrégulière<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 169
avec les <strong>jeunes</strong>, les éducateurs se situent davantage dans une logique immédiate d’action : « quandon se sent accepté <strong>et</strong> reconnu, on essaie <strong>de</strong> faire émerger la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> », « instaurer une relation <strong>de</strong>confiance <strong>et</strong> envisager une action collective plus poussée ». Ils agissent moins en référence à unevisée éducative d’ensemble qui, d’évi<strong>de</strong>nce, est présente dès l’abord du groupe mais reste lointaine,qu’avec une perspective concrète d’action qui peut se réaliser à tout moment puisque le cadre en estposé. Néanmoins, c<strong>et</strong>te perspective peut m<strong>et</strong>tre du temps ou ne jamais advenir, du moins dans laforme dans laquelle est apparu le groupe.L’inscription dans une temporalité incertaine constitue, en eff<strong>et</strong>, un autre aspect <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te relationéducative qui, <strong>de</strong> ce fait, doit se montrer patiente. L’incertitu<strong>de</strong> provient d’abord <strong>de</strong> la difficulté àentreprendre un travail régulier <strong>et</strong> suivi avec les collectifs qui, eux-mêmes, ont une vie interneperturbée ou adossée à <strong>de</strong>s rythmes qui leur sont propres, selon l’évolution <strong>de</strong> leurs préoccupationsou <strong>de</strong>s histoires individuelles. « Il y a <strong>de</strong>s moments où on les voit, <strong>de</strong>s moments où on ne les voit pas »constatent les éducateurs qui composent avec c<strong>et</strong>te irrégularité. De même, ils intègrent dans lagestion <strong>de</strong> leur activité professionnelle le temps long du travail avec les groupes. L’expression d’une<strong>de</strong>man<strong>de</strong> ou d’une attente n’arrive qu’à l’issue d’une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> rue. Conséquence certainement <strong>de</strong>l’irrégularité ou <strong>de</strong> la dimension collective qui ralentit le temps, c<strong>et</strong> allongement <strong>de</strong> l’action estlargement souligné. Ces <strong>de</strong>ux caractéristiques, irrégularité <strong>et</strong> longue durée, <strong>de</strong>ssineraient ainsi un<strong>et</strong>emporalité spécifique du travail avec les groupes.S’il prend forme, le proj<strong>et</strong> éducatif peut s’amorcer alors à différents niveaux. Il est relié à une idéeconcrète dont les contours s’affinent progressivement en fonction <strong>de</strong>s potentialités décelées au seindu groupe, en fonction <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s individuelles ou collectives qui s’expriment ou qui sontpressenties par les éducateurs.Défaire le groupe ?La relation plus pérenne entre l’éducateur <strong>et</strong> les groupes naturels s’engage avec la poursuited’objectifs divers <strong>et</strong> porte l’action éducative au-<strong>de</strong>là du seul « être avec eux ». Elle peut conserverune visée collective ou revêtir une dimension plus individuelle, ou bien associer les <strong>de</strong>ux logiquesd’action. Elle peut affermir le caractère spontané ou naturel <strong>de</strong> l’organisation juvénile ou lecomprom<strong>et</strong>tre. L’intervention éducative, quelles qu’en soient les formes précises, introduit unedynamique nouvelle <strong>et</strong>, en cela, perturbe l’ordre collectif initial.Le travail avec les groupes, en eff<strong>et</strong>, ne se réalise pas forcément <strong>et</strong> à tout moment dans une formecollective. Passé le temps du premier abord, forcément collectif, il peut évoluer vers <strong>de</strong>saccompagnements socio-éducatifs effectués séparément en faveur <strong>de</strong> membres du groupe. C’estainsi, par exemple, qu’intervient l’équipe Mozaïc vis-à-vis d’un groupe qui squatte dans une impassedu quartier <strong>et</strong> qui est composé <strong>de</strong> grands adolescents confrontés à <strong>de</strong>s situations lour<strong>de</strong>s sur le planfamilial, scolaire ou professionnel <strong>et</strong> impliqués dans le trafic illicite 158 . Le souci premier <strong>de</strong> créer <strong>et</strong> <strong>de</strong>maintenir le lien a rendu possibles <strong>de</strong>s interventions individuelles. Ce sont les <strong>de</strong>ux <strong>jeunes</strong> déjàconnus par les éducateurs qui ont d’abord <strong>de</strong>mandé une ai<strong>de</strong>, ouvrant la voie aux autres personnes.Finalement, les éducateurs ont reçu beaucoup <strong>de</strong> sollicitations individuelles <strong>et</strong> ont accompagné158 Voir Partie 1, chapitre 3-3, « Cap Moqu<strong>et</strong>te »<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 170
- Page 5 and 6:
2 - Le sens d’une action communau
- Page 7 and 8:
AVANT PROPOSLe phénomène des band
- Page 10 and 11:
L’une et l’autre contribuent à
- Page 12 and 13:
Cette seconde étape a été engag
- Page 14 and 15:
CONSTATS ET PRECONISATIONS5 CONSTAT
- Page 16 and 17:
partenariales se développent parfo
- Page 18 and 19:
Les comportements violents et déli
- Page 20 and 21:
jeunes à la relation proposée. El
- Page 22 and 23:
7.2 - L’évaluation en préventio
- Page 24 and 25:
P 10. Prendre en compte les tension
- Page 26 and 27:
I - GROUPES DE JEUNES ET PRATIQUES
- Page 28 and 29:
sans emploi ou exclus de l’école
- Page 30 and 31:
devient « un régulateur social »
- Page 32 and 33:
libération, après la seconde guer
- Page 34 and 35:
l’animation sportive ou culturell
- Page 36 and 37:
L’approche de la personnalité gl
- Page 40 and 41:
ite permet de construire. De façon
- Page 42 and 43:
2 - Formes actuelles de regroupemen
- Page 44 and 45:
Les groupes virtuelsLes jeunes sont
- Page 46 and 47:
4 - Structuration et fonctionnement
- Page 48 and 49:
en tant que travailleur social. ..
- Page 50 and 51:
fonctionnement marginal et délictu
- Page 54 and 55:
liée à l’absence d’intériori
- Page 56 and 57:
Une pratique sociale collective a p
- Page 58 and 59:
CHAPITRE 5 : LES ATTENTES ET COMMAN
- Page 60 and 61:
« Le champ d’intervention de la
- Page 62 and 63:
Dans le projet de Contrat local de
- Page 64 and 65:
CHAPITRE 6 : AGIR AVEC LE GROUPELes
- Page 66 and 67:
Le comportement de jeunes en situat
- Page 68 and 69:
L’évaluation des actions entrepr
- Page 70 and 71:
5. Ces éducateurs vont essayer d
- Page 72 and 73:
La complexité des interactions dan
- Page 74 and 75:
La réflexion concernant cette rech
- Page 76 and 77:
P O S T F A C EL’incompréhension
- Page 78 and 79:
Les travaux du CTPS ne nient pas la
- Page 80 and 81:
ANNEXE : Questionnaire flashAnalyse
- Page 82 and 83:
MasculinFémininmixte18ansMono ethn
- Page 84 and 85:
CONSEIL TECHNIQUEDES CLUBS ET EQUIP
- Page 86 and 87:
II- PRATIQUES EDUCATIVES ET GROUPES
- Page 88 and 89:
son action sur les jeunes et sur le
- Page 90 and 91:
précarisées. Ce site nous a permi
- Page 92 and 93:
PARTIE 1 : Monographies des sitesCe
- Page 94 and 95:
les familles se connaissent entre e
- Page 96 and 97:
de 6 à 18 ans pendant leur temps l
- Page 98 and 99:
public. Pour l’association et ses
- Page 100 and 101:
dans l’espace public) et l’acco
- Page 102 and 103:
moyens : les éducateurs ne peuvent
- Page 104 and 105:
démarches liées au projet mais é
- Page 106 and 107:
Le projet Futsal : une salle en ges
- Page 108 and 109:
CHAPITRE 2 : Le Neuhof - JEEP1 - Le
- Page 110 and 111:
pourcentage, le plus haut comparati
- Page 112 and 113:
esponsables du collège qui, lors d
- Page 114 and 115:
La Jeep se compose d’une directio
- Page 116 and 117:
développent d’autres actions sur
- Page 118 and 119:
traduit le choix de l’équipe de
- Page 120 and 121: Par différence, le registre d’in
- Page 122 and 123: La présence dans les établissemen
- Page 124 and 125: organisé par les éducateurs de la
- Page 126 and 127: CHAPITRE 3 : Paris 18è - ARC 75/Mo
- Page 128 and 129: commune à tous les jeunes du quart
- Page 130 and 131: En 2007, l'association ARC 75 a men
- Page 132 and 133: d'intervention pour ARC 75 a été
- Page 134 and 135: L'équipe organise son travail de m
- Page 136 and 137: Outre l’absence de qualification
- Page 138 and 139: Les projets Scopados s’inscrivent
- Page 140 and 141: PARTIE 2 : éléments d’analyseL
- Page 142 and 143: Enfin, un autre critère central da
- Page 144 and 145: La construction de cette identité
- Page 146 and 147: epérer si le groupe permet au jeun
- Page 148 and 149: On voit donc que le groupe protège
- Page 150 and 151: Souvent, les éducateurs remarquent
- Page 152 and 153: La stabilité des groupesDe manièr
- Page 156 and 157: jeunes, comme nous l’explique Dav
- Page 158 and 159: Pour conclure, les jeunes membres d
- Page 160 and 161: pairs. » 151 Ainsi, les jeunes rè
- Page 162 and 163: Le squat qui peut, par exemple, êt
- Page 164 and 165: s’instaure le contact entre les
- Page 166 and 167: associatives. Ils sont liés aux ca
- Page 168 and 169: signifie qu’il constitue pour eux
- Page 172 and 173: plusieurs membres du groupe. Vraise
- Page 174 and 175: l’activité de boxe thaïlandaise
- Page 176 and 177: La composition du groupe témoigne
- Page 178 and 179: « Il faut un support concret » af
- Page 180 and 181: modifier les comportements individu
- Page 182 and 183: l’ensemble des raisons. Celles-ci
- Page 184 and 185: champ professionnel 176 .A certaine
- Page 186 and 187: individuels sur le plan de la sant
- Page 188 and 189: a traversé les mouvements éducati
- Page 190 and 191: econstruire ensuite différemment,
- Page 192 and 193: empirique de l’action auprès des
- Page 194 and 195: manifesté à ces occasions à cett
- Page 196 and 197: d’entraînement au petit matin da
- Page 198 and 199: compétences tiennent autant à une
- Page 200 and 201: correspondants de nuit, animateurs,
- Page 202 and 203: ANNEXESGroupes de jeunes et pratiqu
- Page 204 and 205: Le Conseil Technique remercie égal
- Page 206 and 207: DESCOURTIS Jean-Luc, directeur, ARC
- Page 208 and 209: CHOBEAUX François, Les nomades du
- Page 210 and 211: Rapports et étudesAPASE, Les jeune
- Page 212: Communauté d’agglomération du P