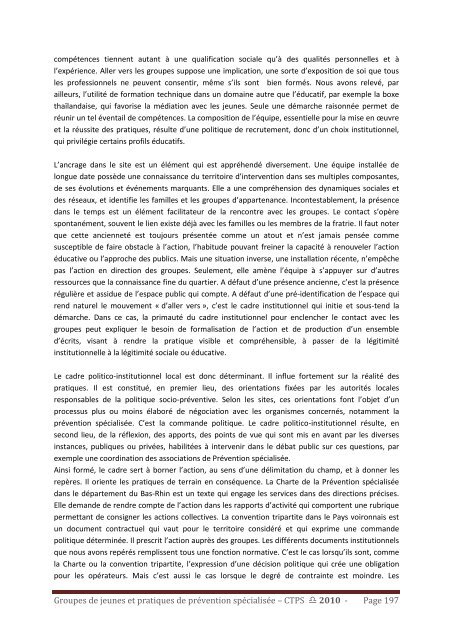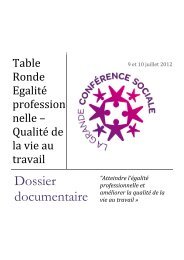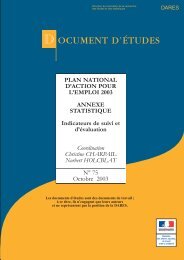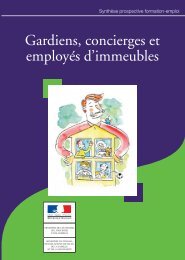compétences tiennent autant à une qualification sociale qu’à <strong>de</strong>s qualités personnelles <strong>et</strong> àl’expérience. Aller vers les groupes suppose une implication, une sorte d’exposition <strong>de</strong> soi que tousles professionnels ne peuvent consentir, même s’ils sont bien formés. Nous avons relevé, parailleurs, l’utilité <strong>de</strong> formation technique dans un domaine autre que l’éducatif, par exemple la box<strong>et</strong>haïlandaise, qui favorise la médiation avec les <strong>jeunes</strong>. Seule une démarche raisonnée perm<strong>et</strong> <strong>de</strong>réunir un tel éventail <strong>de</strong> compétences. La composition <strong>de</strong> l’équipe, essentielle pour la mise en œuvre<strong>et</strong> la réussite <strong>de</strong>s <strong>pratiques</strong>, résulte d’une politique <strong>de</strong> recrutement, donc d’un choix institutionnel,qui privilégie certains profils éducatifs.L’ancrage dans le site est un élément qui est appréhendé diversement. Une équipe installée <strong>de</strong>longue date possè<strong>de</strong> une connaissance du territoire d’intervention dans ses multiples composantes,<strong>de</strong> ses évolutions <strong>et</strong> événements marquants. Elle a une compréhension <strong>de</strong>s dynamiques sociales <strong>et</strong><strong>de</strong>s réseaux, <strong>et</strong> i<strong>de</strong>ntifie les familles <strong>et</strong> les groupes d’appartenance. Incontestablement, la présencedans le temps est un élément facilitateur <strong>de</strong> la rencontre avec les groupes. Le contact s’opèrespontanément, souvent le lien existe déjà avec les familles ou les membres <strong>de</strong> la fratrie. Il faut noterque c<strong>et</strong>te ancienn<strong>et</strong>é est toujours présentée comme un atout <strong>et</strong> n’est jamais pensée commesusceptible <strong>de</strong> faire obstacle à l’action, l’habitu<strong>de</strong> pouvant freiner la capacité à renouveler l’actionéducative ou l’approche <strong>de</strong>s publics. Mais une situation inverse, une installation récente, n’empêchepas l’action en direction <strong>de</strong>s groupes. Seulement, elle amène l’équipe à s’appuyer sur d’autresressources que la connaissance fine du quartier. A défaut d’une présence ancienne, c’est la présencerégulière <strong>et</strong> assidue <strong>de</strong> l’espace public qui compte. A défaut d’une pré-i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> l’espace quirend naturel le mouvement « d’aller vers », c’est le cadre institutionnel qui initie <strong>et</strong> sous-tend ladémarche. Dans ce cas, la primauté du cadre institutionnel pour enclencher le contact avec lesgroupes peut expliquer le besoin <strong>de</strong> formalisation <strong>de</strong> l’action <strong>et</strong> <strong>de</strong> production d’un ensembled’écrits, visant à rendre la pratique visible <strong>et</strong> compréhensible, à passer <strong>de</strong> la légitimitéinstitutionnelle à la légitimité sociale ou éducative.Le cadre politico-institutionnel local est donc déterminant. Il influe fortement sur la réalité <strong>de</strong>s<strong>pratiques</strong>. Il est constitué, en premier lieu, <strong>de</strong>s orientations fixées par les autorités localesresponsables <strong>de</strong> la politique socio-préventive. Selon les sites, ces orientations font l’obj<strong>et</strong> d’unprocessus plus ou moins élaboré <strong>de</strong> négociation avec les organismes concernés, notamment laprévention spécialisée. C’est la comman<strong>de</strong> politique. Le cadre politico-institutionnel résulte, ensecond lieu, <strong>de</strong> la réflexion, <strong>de</strong>s apports, <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> vue qui sont mis en avant par les diversesinstances, publiques ou privées, habilitées à intervenir dans le débat public sur ces questions, parexemple une coordination <strong>de</strong>s associations <strong>de</strong> Prévention spécialisée.Ainsi formé, le cadre sert à borner l’action, au sens d’une délimitation du champ, <strong>et</strong> à donner lesrepères. Il oriente les <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> terrain en conséquence. La Charte <strong>de</strong> la Prévention spécialiséedans le département du Bas-Rhin est un texte qui engage les services dans <strong>de</strong>s directions précises.Elle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> rendre compte <strong>de</strong> l’action dans les rapports d’activité qui comportent une rubriqueperm<strong>et</strong>tant <strong>de</strong> consigner les actions collectives. La convention tripartite dans le Pays voironnais estun document contractuel qui vaut pour le territoire considéré <strong>et</strong> qui exprime une comman<strong>de</strong>politique déterminée. Il prescrit l’action auprès <strong>de</strong>s groupes. Les différents documents institutionnelsque nous avons repérés remplissent tous une fonction normative. C’est le cas lorsqu’ils sont, commela Charte ou la convention tripartite, l’expression d’une décision politique qui crée une obligationpour les opérateurs. Mais c’est aussi le cas lorsque le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> contrainte est moindre. Les<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 197
documents produits localement, quelles que soient leur origine <strong>et</strong> leur nature, contribuent à créerune doctrine, un référentiel d’ensemble qui, peu ou prou, influe sur la conception <strong>de</strong> l’action àconduire par chaque institution <strong>et</strong> sur les voies à privilégier. A n’en pas douter, la mise en avant <strong>de</strong><strong>pratiques</strong> éducatives auprès <strong>de</strong> groupes dans les documents institutionnels, dans les propos <strong>de</strong>s élus,dans les écrits professionnels a pour eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> les faire exister, du moins <strong>de</strong> rendre familière l’idée <strong>de</strong>telles <strong>pratiques</strong>. A contrario, l’absence ou la discrétion du thème dans le débat local rend improbablece type <strong>de</strong> <strong>pratiques</strong>, sauf si elles bénéficient d’un portage particulier par une association ou unréseau <strong>de</strong> professionnels.La notion <strong>de</strong> cadre institutionnel renvoie également, <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te dimension est très liée à la précé<strong>de</strong>nte,au dispositif d’ensemble que forment les institutions présentes dans le champ local <strong>de</strong> laprévention/<strong>jeunes</strong>se <strong>et</strong> au sein duquel prennent place les équipes <strong>de</strong> prévention spécialisée. Lesmonographies donnent un aperçu <strong>de</strong> ce dispositif dans chaque site <strong>et</strong> en i<strong>de</strong>ntifient les principalescomposantes, pointant déjà quelques enjeux. En eff<strong>et</strong>, la position <strong>de</strong> chaque acteur, son périmètred’intervention, sa marge d’action dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong>s autres institutions. En ce sens, lecomportement <strong>de</strong> la Prévention est en partie lié à la composition du réseau partenarial <strong>et</strong> à ladynamique <strong>de</strong>s différents opérateurs, notamment ceux qui travaillent en proximité avec les <strong>jeunes</strong>.Le système d’acteurs, dans le 18 ème arrondissement à Paris, est assez lisible. Il comprend lesprincipaux dispositifs d’intervention, publics <strong>et</strong> privés, à vocation globale ou spécialisée <strong>de</strong>stinés à la<strong>jeunes</strong>se. Le site n’est pas inscrit dans la procédure <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong> la ville, ce qui le prive <strong>de</strong>moyens mais produit un paysage institutionnel où, semble-t-il, chaque acteur est i<strong>de</strong>ntifiable <strong>et</strong>reconnu dans son champ <strong>de</strong> compétence, occupe une place <strong>et</strong> un rôle précis. L’équipe <strong>de</strong> préventiona noué <strong>de</strong>s coopérations choisies <strong>et</strong> peu nombreuses, très liées à ses choix d’action qu’elle peutinvestir pleinement. C’est le cas pour l’intervention socio-éducative auprès <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong>.L’effort en direction <strong>de</strong> la <strong>jeunes</strong>se est soutenu dans le Pays voironnais, qui ne semble souffrir ni d’un« trop plein » ni d’un déficit. Les différentes composantes du dispositif <strong>jeunes</strong>se, en cours <strong>de</strong>construction, sont assez bien i<strong>de</strong>ntifiées. Les caractéristiques du territoire, étendue <strong>et</strong> semi-ruralité,perm<strong>et</strong>tent plus facilement, peut-être, à chacun <strong>de</strong> trouver sa place sur la base <strong>de</strong> ses missionspropres mais avec <strong>de</strong>s objectifs communs qui sont d’éviter l’isolement <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong>, <strong>de</strong> les amener versles offres qui leur sont <strong>de</strong>stinées, d’exercer une veille éducative. La mission d’aller vers les groupesest partagée entre la prévention <strong>et</strong> d’autres professionnels, en particulier les intervenants du secteur<strong>de</strong> l’animation. Ce partage s’effectue selon les inscriptions territoriales <strong>de</strong> chaque institution <strong>et</strong> enappui sur les proj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> logiques d’intervention spécifiques. Ce fonctionnement fait jouer lescomplémentarités, facilite la mise en réseau <strong>et</strong> l’optimisation <strong>de</strong>s ressources existantes, mais n’estpas exempt <strong>de</strong> divergences <strong>et</strong> d’enjeux liés à la maîtrise du champ.La configuration est autre dans le quartier du Neuhof. Dans c<strong>et</strong> espace urbain très délimité, le tissuinstitutionnel est <strong>de</strong>nse. L’équipe <strong>de</strong> prévention est un opérateur parmi <strong>de</strong> nombreux autres, ce quientraîne pour elle <strong>de</strong>s conséquences que nous avons entrevues à <strong>de</strong>ux niveaux.Tout d’abord, le fort maillage induit une disponibilité naturelle <strong>et</strong> permanente aux <strong>jeunes</strong>individuellement ou rassemblés, même si ceux-ci ne saisissent pas pour autant l’offre qui est à leurportée. Il existe, <strong>de</strong> fait, un réseau <strong>de</strong> veille, composé <strong>de</strong>s professionnels qui se connaissent entreeux, se rencontrent régulièrement <strong>et</strong> sont tous attentifs à la <strong>jeunes</strong>se du quartier : médiateurs,<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 198
- Page 5 and 6:
2 - Le sens d’une action communau
- Page 7 and 8:
AVANT PROPOSLe phénomène des band
- Page 10 and 11:
L’une et l’autre contribuent à
- Page 12 and 13:
Cette seconde étape a été engag
- Page 14 and 15:
CONSTATS ET PRECONISATIONS5 CONSTAT
- Page 16 and 17:
partenariales se développent parfo
- Page 18 and 19:
Les comportements violents et déli
- Page 20 and 21:
jeunes à la relation proposée. El
- Page 22 and 23:
7.2 - L’évaluation en préventio
- Page 24 and 25:
P 10. Prendre en compte les tension
- Page 26 and 27:
I - GROUPES DE JEUNES ET PRATIQUES
- Page 28 and 29:
sans emploi ou exclus de l’école
- Page 30 and 31:
devient « un régulateur social »
- Page 32 and 33:
libération, après la seconde guer
- Page 34 and 35:
l’animation sportive ou culturell
- Page 36 and 37:
L’approche de la personnalité gl
- Page 40 and 41:
ite permet de construire. De façon
- Page 42 and 43:
2 - Formes actuelles de regroupemen
- Page 44 and 45:
Les groupes virtuelsLes jeunes sont
- Page 46 and 47:
4 - Structuration et fonctionnement
- Page 48 and 49:
en tant que travailleur social. ..
- Page 50 and 51:
fonctionnement marginal et délictu
- Page 54 and 55:
liée à l’absence d’intériori
- Page 56 and 57:
Une pratique sociale collective a p
- Page 58 and 59:
CHAPITRE 5 : LES ATTENTES ET COMMAN
- Page 60 and 61:
« Le champ d’intervention de la
- Page 62 and 63:
Dans le projet de Contrat local de
- Page 64 and 65:
CHAPITRE 6 : AGIR AVEC LE GROUPELes
- Page 66 and 67:
Le comportement de jeunes en situat
- Page 68 and 69:
L’évaluation des actions entrepr
- Page 70 and 71:
5. Ces éducateurs vont essayer d
- Page 72 and 73:
La complexité des interactions dan
- Page 74 and 75:
La réflexion concernant cette rech
- Page 76 and 77:
P O S T F A C EL’incompréhension
- Page 78 and 79:
Les travaux du CTPS ne nient pas la
- Page 80 and 81:
ANNEXE : Questionnaire flashAnalyse
- Page 82 and 83:
MasculinFémininmixte18ansMono ethn
- Page 84 and 85:
CONSEIL TECHNIQUEDES CLUBS ET EQUIP
- Page 86 and 87:
II- PRATIQUES EDUCATIVES ET GROUPES
- Page 88 and 89:
son action sur les jeunes et sur le
- Page 90 and 91:
précarisées. Ce site nous a permi
- Page 92 and 93:
PARTIE 1 : Monographies des sitesCe
- Page 94 and 95:
les familles se connaissent entre e
- Page 96 and 97:
de 6 à 18 ans pendant leur temps l
- Page 98 and 99:
public. Pour l’association et ses
- Page 100 and 101:
dans l’espace public) et l’acco
- Page 102 and 103:
moyens : les éducateurs ne peuvent
- Page 104 and 105:
démarches liées au projet mais é
- Page 106 and 107:
Le projet Futsal : une salle en ges
- Page 108 and 109:
CHAPITRE 2 : Le Neuhof - JEEP1 - Le
- Page 110 and 111:
pourcentage, le plus haut comparati
- Page 112 and 113:
esponsables du collège qui, lors d
- Page 114 and 115:
La Jeep se compose d’une directio
- Page 116 and 117:
développent d’autres actions sur
- Page 118 and 119:
traduit le choix de l’équipe de
- Page 120 and 121:
Par différence, le registre d’in
- Page 122 and 123:
La présence dans les établissemen
- Page 124 and 125:
organisé par les éducateurs de la
- Page 126 and 127:
CHAPITRE 3 : Paris 18è - ARC 75/Mo
- Page 128 and 129:
commune à tous les jeunes du quart
- Page 130 and 131:
En 2007, l'association ARC 75 a men
- Page 132 and 133:
d'intervention pour ARC 75 a été
- Page 134 and 135:
L'équipe organise son travail de m
- Page 136 and 137:
Outre l’absence de qualification
- Page 138 and 139:
Les projets Scopados s’inscrivent
- Page 140 and 141:
PARTIE 2 : éléments d’analyseL
- Page 142 and 143:
Enfin, un autre critère central da
- Page 144 and 145:
La construction de cette identité
- Page 146 and 147:
epérer si le groupe permet au jeun
- Page 148 and 149: On voit donc que le groupe protège
- Page 150 and 151: Souvent, les éducateurs remarquent
- Page 152 and 153: La stabilité des groupesDe manièr
- Page 156 and 157: jeunes, comme nous l’explique Dav
- Page 158 and 159: Pour conclure, les jeunes membres d
- Page 160 and 161: pairs. » 151 Ainsi, les jeunes rè
- Page 162 and 163: Le squat qui peut, par exemple, êt
- Page 164 and 165: s’instaure le contact entre les
- Page 166 and 167: associatives. Ils sont liés aux ca
- Page 168 and 169: signifie qu’il constitue pour eux
- Page 170 and 171: interlocuteurs, de « patiente et r
- Page 172 and 173: plusieurs membres du groupe. Vraise
- Page 174 and 175: l’activité de boxe thaïlandaise
- Page 176 and 177: La composition du groupe témoigne
- Page 178 and 179: « Il faut un support concret » af
- Page 180 and 181: modifier les comportements individu
- Page 182 and 183: l’ensemble des raisons. Celles-ci
- Page 184 and 185: champ professionnel 176 .A certaine
- Page 186 and 187: individuels sur le plan de la sant
- Page 188 and 189: a traversé les mouvements éducati
- Page 190 and 191: econstruire ensuite différemment,
- Page 192 and 193: empirique de l’action auprès des
- Page 194 and 195: manifesté à ces occasions à cett
- Page 196 and 197: d’entraînement au petit matin da
- Page 200 and 201: correspondants de nuit, animateurs,
- Page 202 and 203: ANNEXESGroupes de jeunes et pratiqu
- Page 204 and 205: Le Conseil Technique remercie égal
- Page 206 and 207: DESCOURTIS Jean-Luc, directeur, ARC
- Page 208 and 209: CHOBEAUX François, Les nomades du
- Page 210 and 211: Rapports et étudesAPASE, Les jeune
- Page 212: Communauté d’agglomération du P