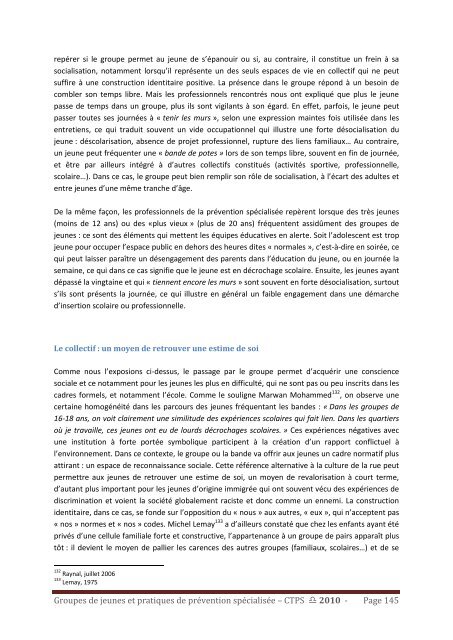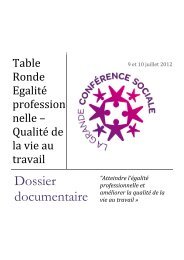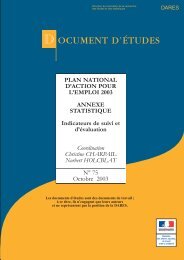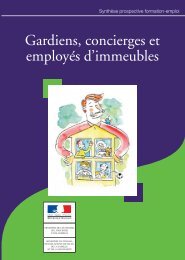epérer si le groupe perm<strong>et</strong> au jeune <strong>de</strong> s’épanouir ou si, au contraire, il constitue un frein à sasocialisation, notamment lorsqu’il représente un <strong>de</strong>s seuls espaces <strong>de</strong> vie en collectif qui ne peutsuffire à une construction i<strong>de</strong>ntitaire positive. La présence dans le groupe répond à un besoin <strong>de</strong>combler son temps libre. Mais les professionnels rencontrés nous ont expliqué que plus le jeunepasse <strong>de</strong> temps dans un groupe, plus ils sont vigilants à son égard. En eff<strong>et</strong>, parfois, le jeune peutpasser toutes ses journées à « tenir les murs », selon une expression maintes fois utilisée dans lesentr<strong>et</strong>iens, ce qui traduit souvent un vi<strong>de</strong> occupationnel qui illustre une forte désocialisation dujeune : déscolarisation, absence <strong>de</strong> proj<strong>et</strong> professionnel, rupture <strong>de</strong>s liens familiaux… Au contraire,un jeune peut fréquenter une « ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> potes » lors <strong>de</strong> son temps libre, souvent en fin <strong>de</strong> journée,<strong>et</strong> être par ailleurs intégré à d’autres collectifs constitués (activités sportive, professionnelle,scolaire…). Dans ce cas, le groupe peut bien remplir son rôle <strong>de</strong> socialisation, à l’écart <strong>de</strong>s adultes <strong>et</strong>entre <strong>jeunes</strong> d’une même tranche d’âge.De la même façon, les professionnels <strong>de</strong> la prévention spécialisée repèrent lorsque <strong>de</strong>s très <strong>jeunes</strong>(moins <strong>de</strong> 12 ans) ou <strong>de</strong>s «plus vieux » (plus <strong>de</strong> 20 ans) fréquentent assidûment <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong><strong>jeunes</strong> : ce sont <strong>de</strong>s éléments qui m<strong>et</strong>tent les équipes éducatives en alerte. Soit l’adolescent est tropjeune pour occuper l’espace public en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s heures dites « normales », c’est-à-dire en soirée, cequi peut laisser paraître un désengagement <strong>de</strong>s parents dans l’éducation du jeune, ou en journée lasemaine, ce qui dans ce cas signifie que le jeune est en décrochage scolaire. Ensuite, les <strong>jeunes</strong> ayantdépassé la vingtaine <strong>et</strong> qui « tiennent encore les murs » sont souvent en forte désocialisation, surtouts’ils sont présents la journée, ce qui illustre en général un faible engagement dans une démarched’insertion scolaire ou professionnelle.Le collectif : un moyen <strong>de</strong> r<strong>et</strong>rouver une estime <strong>de</strong> soiComme nous l’exposions ci-<strong>de</strong>ssus, le passage par le groupe perm<strong>et</strong> d’acquérir une consciencesociale <strong>et</strong> ce notamment pour les <strong>jeunes</strong> les plus en difficulté, qui ne sont pas ou peu inscrits dans lescadres formels, <strong>et</strong> notamment l’école. Comme le souligne Marwan Mohammed 132 , on observe unecertaine homogénéité dans les parcours <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> fréquentant les ban<strong>de</strong>s : « Dans les groupes <strong>de</strong>16-18 ans, on voit clairement une similitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s expériences scolaires qui fait lien. Dans les quartiersoù je travaille, ces <strong>jeunes</strong> ont eu <strong>de</strong> lourds décrochages scolaires. » Ces expériences négatives avecune institution à forte portée symbolique participent à la création d’un rapport conflictuel àl’environnement. Dans ce contexte, le groupe ou la ban<strong>de</strong> va offrir aux <strong>jeunes</strong> un cadre normatif plusattirant : un espace <strong>de</strong> reconnaissance sociale. C<strong>et</strong>te référence alternative à la culture <strong>de</strong> la rue peutperm<strong>et</strong>tre aux <strong>jeunes</strong> <strong>de</strong> r<strong>et</strong>rouver une estime <strong>de</strong> soi, un moyen <strong>de</strong> revalorisation à court terme,d’autant plus important pour les <strong>jeunes</strong> d’origine immigrée qui ont souvent vécu <strong>de</strong>s expériences <strong>de</strong>discrimination <strong>et</strong> voient la société globalement raciste <strong>et</strong> donc comme un ennemi. La constructioni<strong>de</strong>ntitaire, dans ce cas, se fon<strong>de</strong> sur l’opposition du « nous » aux autres, « eux », qui n’acceptent pas« nos » normes <strong>et</strong> « nos » co<strong>de</strong>s. Michel Lemay 133 a d’ailleurs constaté que chez les enfants ayant étéprivés d’une cellule familiale forte <strong>et</strong> constructive, l’appartenance à un groupe <strong>de</strong> pairs apparaît plustôt : il <strong>de</strong>vient le moyen <strong>de</strong> pallier les carences <strong>de</strong>s autres groupes (familiaux, scolaires…) <strong>et</strong> <strong>de</strong> se132 Raynal, juill<strong>et</strong> 2006133 Lemay, 1975<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 145
créer un espace sécurisé constitué par le collectif. On voit donc bien à travers ces <strong>de</strong>ux exemples quele groupe constitue un espace fort <strong>de</strong> reconnaissance <strong>et</strong> <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> soi, d’autant plus pourles <strong>jeunes</strong> en carence au niveau <strong>de</strong>s liens sociaux, qu’ils soient affectifs (famille souvent) ousymboliques (école, mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’emploi…).La bagarre <strong>et</strong> les rixes constituent, d’ailleurs, un outil <strong>de</strong> reconnaissance sociale : on r<strong>et</strong>rouve c<strong>et</strong>teidée chez Jean Monod <strong>et</strong> également, plus tard, chez Michel Kokoreff 134 « les bagarres jouent un rôleparadoxal. Elles sont un facteur <strong>de</strong> solidarité, qui compte plus que le motif réel <strong>de</strong> la dispute, <strong>et</strong> unmoyen <strong>de</strong> la tester. La violence favorise l’alliance. De même, aujourd’hui, s’embrouiller, c’est activer<strong>de</strong>s chaînes <strong>de</strong> solidarité. » Lorsque le groupe sort vainqueur d’une rixe, cela lui perm<strong>et</strong> d’acquérirune position particulièrement valorisante au sein <strong>de</strong> son quartier. C<strong>et</strong>te valorisation joue aussi à unniveau plus individuel. L’utilisation du portable pour filmer les bagarres illustre bien ce phénomène :la vidéo circule dans tous les réseaux <strong>de</strong> proximité <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong>, une façon pour eux <strong>de</strong> montrer leurréussite, peut être pas dans les créneaux habituels <strong>et</strong> normatifs <strong>de</strong> la société, mais à un niveau quileur perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> renforcer leur estime <strong>de</strong> soi, <strong>et</strong> celle que les autres développent par rapport à eux <strong>et</strong>au groupe : du respect en quelque sorte.En fait, le contexte vécu par ces <strong>jeunes</strong> <strong>de</strong> précarisation croissante, d’exclusion du marché du travailface à une société <strong>de</strong> consommation à laquelle ils souhaitent accé<strong>de</strong>r les conduit à se créer <strong>de</strong>nouvelles normes. On observe, en eff<strong>et</strong>, au sein <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> délinquants le développement<strong>de</strong>s valeurs propres à la bourgeoisie, telles que la compétition, le matérialisme, le désir d’ascensionsociale mais aussi la loyauté <strong>et</strong> la loi du plus fort, adossées à d’autres normes que celles <strong>de</strong> la réussitepar le travail légal. L’accomplissement <strong>de</strong> la réussite sociale peut alors passer par le développementd’activités délinquantes, souvent ancrées dans la violence <strong>et</strong> l’illégalité afin d’acquérir un statut <strong>et</strong>une reconnaissance dans les cercles <strong>et</strong> réseaux qui sont les leurs <strong>et</strong> <strong>de</strong> pouvoir accé<strong>de</strong>r à la société <strong>de</strong>consommation. Cela a notamment été étudié par Loïc Wacquant 135 .Enfin, le groupe constitue un fil<strong>et</strong> <strong>de</strong> sécurité pour ses membres. D’abord, l’eff<strong>et</strong> du nombredissua<strong>de</strong> les potentiels agresseurs, <strong>et</strong> même si le jeune est seul à un moment, en cas <strong>de</strong> problèmesavec d’autres <strong>jeunes</strong>, tout son groupe le soutiendra <strong>et</strong> ira, au besoin, se bagarrer pour lui. Mais, <strong>de</strong>plus, l’appartenance à un groupe <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> connu <strong>et</strong> reconnu au sein du micro-territoired’appartenance assoit la réputation <strong>de</strong> ses membres, ce qui a également un eff<strong>et</strong> dissuasif. C<strong>et</strong>teréputation du collectif, <strong>et</strong> par le même biais <strong>de</strong>s membres qui le composent, se forge à travers « lesdémonstrations, au besoin spectaculaires, <strong>de</strong> ses capacités physiques, tout en testant la capacité <strong>de</strong>réaction <strong>de</strong> l’autre. L’incapacité à réagir est alors associée à une faiblesse qui, comme la lâch<strong>et</strong>é,constitue le motif <strong>de</strong> stigmatisation. La bagarre fait alors figure <strong>de</strong> rite initiatique <strong>et</strong> fondateur. Maisla mise en spectacle <strong>de</strong> soi passe aussi par les échanges <strong>de</strong> parole, l’éloquence étant un critère <strong>de</strong>réputation <strong>de</strong> première importance. » 136134 Kokoreff, in « Ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> : un espace <strong>de</strong> reconnaissance sociale », Florence RAYNAL, Actualités SocialesHebdomadaires, n° 2464, juill<strong>et</strong> 2006135 Wacquant, 1994136 Rubi, 2005, page 130 : ce livre est consacré aux <strong>jeunes</strong> filles, mais concernant c<strong>et</strong> élément, l’auteur explique que ceprincipe s’applique également aux groupes <strong>de</strong> garçons.<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 146
- Page 5 and 6:
2 - Le sens d’une action communau
- Page 7 and 8:
AVANT PROPOSLe phénomène des band
- Page 10 and 11:
L’une et l’autre contribuent à
- Page 12 and 13:
Cette seconde étape a été engag
- Page 14 and 15:
CONSTATS ET PRECONISATIONS5 CONSTAT
- Page 16 and 17:
partenariales se développent parfo
- Page 18 and 19:
Les comportements violents et déli
- Page 20 and 21:
jeunes à la relation proposée. El
- Page 22 and 23:
7.2 - L’évaluation en préventio
- Page 24 and 25:
P 10. Prendre en compte les tension
- Page 26 and 27:
I - GROUPES DE JEUNES ET PRATIQUES
- Page 28 and 29:
sans emploi ou exclus de l’école
- Page 30 and 31:
devient « un régulateur social »
- Page 32 and 33:
libération, après la seconde guer
- Page 34 and 35:
l’animation sportive ou culturell
- Page 36 and 37:
L’approche de la personnalité gl
- Page 40 and 41:
ite permet de construire. De façon
- Page 42 and 43:
2 - Formes actuelles de regroupemen
- Page 44 and 45:
Les groupes virtuelsLes jeunes sont
- Page 46 and 47:
4 - Structuration et fonctionnement
- Page 48 and 49:
en tant que travailleur social. ..
- Page 50 and 51:
fonctionnement marginal et délictu
- Page 54 and 55:
liée à l’absence d’intériori
- Page 56 and 57:
Une pratique sociale collective a p
- Page 58 and 59:
CHAPITRE 5 : LES ATTENTES ET COMMAN
- Page 60 and 61:
« Le champ d’intervention de la
- Page 62 and 63:
Dans le projet de Contrat local de
- Page 64 and 65:
CHAPITRE 6 : AGIR AVEC LE GROUPELes
- Page 66 and 67:
Le comportement de jeunes en situat
- Page 68 and 69:
L’évaluation des actions entrepr
- Page 70 and 71:
5. Ces éducateurs vont essayer d
- Page 72 and 73:
La complexité des interactions dan
- Page 74 and 75:
La réflexion concernant cette rech
- Page 76 and 77:
P O S T F A C EL’incompréhension
- Page 78 and 79:
Les travaux du CTPS ne nient pas la
- Page 80 and 81:
ANNEXE : Questionnaire flashAnalyse
- Page 82 and 83:
MasculinFémininmixte18ansMono ethn
- Page 84 and 85:
CONSEIL TECHNIQUEDES CLUBS ET EQUIP
- Page 86 and 87:
II- PRATIQUES EDUCATIVES ET GROUPES
- Page 88 and 89:
son action sur les jeunes et sur le
- Page 90 and 91:
précarisées. Ce site nous a permi
- Page 92 and 93:
PARTIE 1 : Monographies des sitesCe
- Page 94 and 95:
les familles se connaissent entre e
- Page 96 and 97: de 6 à 18 ans pendant leur temps l
- Page 98 and 99: public. Pour l’association et ses
- Page 100 and 101: dans l’espace public) et l’acco
- Page 102 and 103: moyens : les éducateurs ne peuvent
- Page 104 and 105: démarches liées au projet mais é
- Page 106 and 107: Le projet Futsal : une salle en ges
- Page 108 and 109: CHAPITRE 2 : Le Neuhof - JEEP1 - Le
- Page 110 and 111: pourcentage, le plus haut comparati
- Page 112 and 113: esponsables du collège qui, lors d
- Page 114 and 115: La Jeep se compose d’une directio
- Page 116 and 117: développent d’autres actions sur
- Page 118 and 119: traduit le choix de l’équipe de
- Page 120 and 121: Par différence, le registre d’in
- Page 122 and 123: La présence dans les établissemen
- Page 124 and 125: organisé par les éducateurs de la
- Page 126 and 127: CHAPITRE 3 : Paris 18è - ARC 75/Mo
- Page 128 and 129: commune à tous les jeunes du quart
- Page 130 and 131: En 2007, l'association ARC 75 a men
- Page 132 and 133: d'intervention pour ARC 75 a été
- Page 134 and 135: L'équipe organise son travail de m
- Page 136 and 137: Outre l’absence de qualification
- Page 138 and 139: Les projets Scopados s’inscrivent
- Page 140 and 141: PARTIE 2 : éléments d’analyseL
- Page 142 and 143: Enfin, un autre critère central da
- Page 144 and 145: La construction de cette identité
- Page 148 and 149: On voit donc que le groupe protège
- Page 150 and 151: Souvent, les éducateurs remarquent
- Page 152 and 153: La stabilité des groupesDe manièr
- Page 156 and 157: jeunes, comme nous l’explique Dav
- Page 158 and 159: Pour conclure, les jeunes membres d
- Page 160 and 161: pairs. » 151 Ainsi, les jeunes rè
- Page 162 and 163: Le squat qui peut, par exemple, êt
- Page 164 and 165: s’instaure le contact entre les
- Page 166 and 167: associatives. Ils sont liés aux ca
- Page 168 and 169: signifie qu’il constitue pour eux
- Page 170 and 171: interlocuteurs, de « patiente et r
- Page 172 and 173: plusieurs membres du groupe. Vraise
- Page 174 and 175: l’activité de boxe thaïlandaise
- Page 176 and 177: La composition du groupe témoigne
- Page 178 and 179: « Il faut un support concret » af
- Page 180 and 181: modifier les comportements individu
- Page 182 and 183: l’ensemble des raisons. Celles-ci
- Page 184 and 185: champ professionnel 176 .A certaine
- Page 186 and 187: individuels sur le plan de la sant
- Page 188 and 189: a traversé les mouvements éducati
- Page 190 and 191: econstruire ensuite différemment,
- Page 192 and 193: empirique de l’action auprès des
- Page 194 and 195: manifesté à ces occasions à cett
- Page 196 and 197:
d’entraînement au petit matin da
- Page 198 and 199:
compétences tiennent autant à une
- Page 200 and 201:
correspondants de nuit, animateurs,
- Page 202 and 203:
ANNEXESGroupes de jeunes et pratiqu
- Page 204 and 205:
Le Conseil Technique remercie égal
- Page 206 and 207:
DESCOURTIS Jean-Luc, directeur, ARC
- Page 208 and 209:
CHOBEAUX François, Les nomades du
- Page 210 and 211:
Rapports et étudesAPASE, Les jeune
- Page 212:
Communauté d’agglomération du P