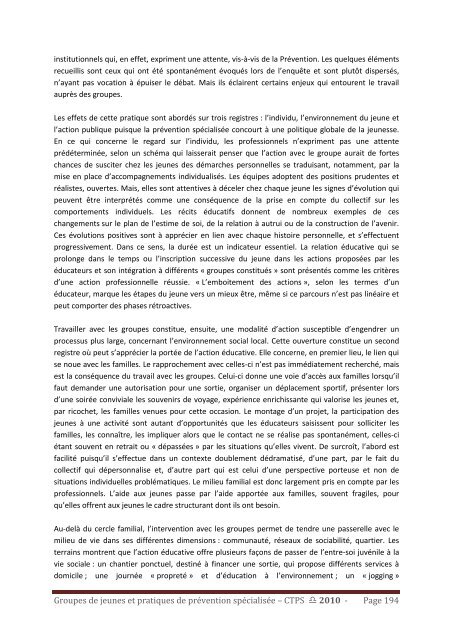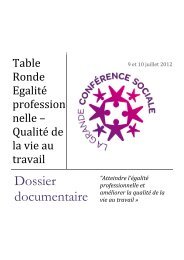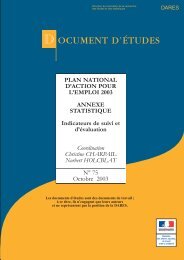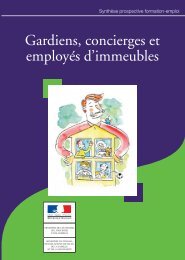manifesté à ces occasions à c<strong>et</strong>te pratique éducative, ils contribuent à « réassurer » le professionneldans son choix d’intervention.Ainsi, le soutien institutionnel, le recours aux aptitu<strong>de</strong>s personnelles, l’autorité que confèrel’expérience, les formations en travail social génèrent un ensemble <strong>de</strong> savoirs. Par ces différentsprocessus d’apprentissage <strong>et</strong> d’étayage <strong>de</strong> la pratique, l’intervenant se qualifie pour aller vers lesgroupes <strong>et</strong> agir avec eux. Il se constitue progressivement ce qui pourrait être un socle <strong>de</strong>compétences. Ce socle est postulé implicitement lorsque les professionnels s’accor<strong>de</strong>nt sur l’idéeque ce type d’intervention requiert <strong>de</strong>s qualités qui ne sont pas complètement i<strong>de</strong>ntiques à celles quisont utiles pour, par exemple, effectuer un travail d’accompagnement individuel. Mais, il n’est pasi<strong>de</strong>ntifié clairement dans le sens où la nature <strong>de</strong>s compétences qui le composeraient n’a fait jamaisl’obj<strong>et</strong> d’une déclinaison rigoureuse. D’ailleurs, il n’a jamais été fait état <strong>de</strong> tentative visant àélaborer un référentiel <strong>de</strong> compétences comme cela a été le cas pour certaines interventions socioéducatives(AEMO, AED). L’absence d’une telle démarche illustre l’écart entre la revendication,discrète mais réelle, d’une spécificité <strong>de</strong> savoirs <strong>et</strong> le <strong>de</strong>gré, faible, <strong>de</strong> formalisation. La seuleformalisation qui s’opère est celle qui s’effectue en interne <strong>et</strong> a posteriori, selon une métho<strong>de</strong>inductive qui consiste à raisonner <strong>et</strong> à conceptualiser à partir <strong>de</strong> situations empiriques pour dégagerune compréhension <strong>de</strong>s phénomènes <strong>et</strong> <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> conduite. La connaissance d’ensemble, ainsiproduite, ne peut être détachée d’une réflexion, sous une forme ou une autre, <strong>de</strong>s eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> l’actionéducative.Que produit l’action auprès <strong>de</strong>s groupes ?S’interroger sur ce que produit l’action socio-éducative constitue une préoccupation présente sur l<strong>et</strong>errain, où elle affleure rapi<strong>de</strong>ment, <strong>et</strong> dans la pensée <strong>de</strong>s responsables à l’origine <strong>de</strong> ce travail.Difficile, en eff<strong>et</strong>, <strong>de</strong> faire l’économie d’une réflexion sur les eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> la pratique étudiée. D’unemanière générale, la prévention spécialisée est tenue d’analyser l’impact <strong>de</strong> son action. La loi du 2janvier 2002 a, en eff<strong>et</strong>, rendu obligatoire <strong>et</strong> généralisé les démarches d’évaluation exigeant <strong>de</strong>sprofessionnels la mise en place d’outils <strong>de</strong> suivi <strong>et</strong> <strong>de</strong> formalisation <strong>de</strong>s <strong>pratiques</strong>. Ces démarchessont encore en construction. En attendant, les rapports annuels <strong>de</strong>s trois équipes ren<strong>de</strong>nt compte <strong>de</strong>l’activité menée sur le plan collectif. Ils fournissent un ensemble <strong>de</strong> données qualitatives ouquantitatives -nombre d’interventions collectives, cartographie <strong>de</strong>s groupes, analyse d’actionsréalisées...- <strong>et</strong> livrent un ensemble d’observations <strong>et</strong> d’analyses qui constituent autant <strong>de</strong> tentativepour appréhen<strong>de</strong>r les impacts <strong>de</strong> l’action.Partant, notre démarche <strong>de</strong> repérage <strong>de</strong> ces eff<strong>et</strong>s n’est pas <strong>de</strong> nature évaluative. Nous n’avons pascherché à répertorier <strong>de</strong>s données ou <strong>de</strong>s faits objectifs, à partir d’indicateurs appropriés, pourmesurer <strong>de</strong>s transformations. Là n’est pas notre intention. Notre visée est autre <strong>et</strong> plus mo<strong>de</strong>ste,exploratoire, consistant simplement à rassembler <strong>de</strong>s fragments d’entr<strong>et</strong>iens qui perm<strong>et</strong>tentd’alimenter le débat non pas sur l’efficacité <strong>et</strong> la performance <strong>de</strong> la Prévention spécialisée mais surson rôle. Dans ce sens, nous nous sommes intéressées aux attentes <strong>de</strong>s éducateurs lorsqu’ilsentreprennent ce type <strong>de</strong> pratique, <strong>et</strong> à la façon dont ils interprètent, perçoivent les processus quis’ensuivent en fonction <strong>de</strong>s objectifs éducatifs qu’ils se donnent. Nous avons également étéattentives aux réflexions <strong>de</strong>s partenaires <strong>de</strong> la prévention, opérateurs <strong>de</strong> proximité ou responsables<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 193
institutionnels qui, en eff<strong>et</strong>, expriment une attente, vis-à-vis <strong>de</strong> la Prévention. Les quelques élémentsrecueillis sont ceux qui ont été spontanément évoqués lors <strong>de</strong> l’enquête <strong>et</strong> sont plutôt dispersés,n’ayant pas vocation à épuiser le débat. Mais ils éclairent certains enjeux qui entourent le travailauprès <strong>de</strong>s groupes.Les eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te pratique sont abordés sur trois registres : l’individu, l’environnement du jeune <strong>et</strong>l’action publique puisque la prévention spécialisée concourt à une politique globale <strong>de</strong> la <strong>jeunes</strong>se.En ce qui concerne le regard sur l’individu, les professionnels n’expriment pas une attenteprédéterminée, selon un schéma qui laisserait penser que l’action avec le groupe aurait <strong>de</strong> forteschances <strong>de</strong> susciter chez les <strong>jeunes</strong> <strong>de</strong>s démarches personnelles se traduisant, notamment, par lamise en place d’accompagnements individualisés. Les équipes adoptent <strong>de</strong>s positions pru<strong>de</strong>ntes <strong>et</strong>réalistes, ouvertes. Mais, elles sont attentives à déceler chez chaque jeune les signes d’évolution quipeuvent être interprétés comme une conséquence <strong>de</strong> la prise en compte du collectif sur lescomportements individuels. Les récits éducatifs donnent <strong>de</strong> nombreux exemples <strong>de</strong> ceschangements sur le plan <strong>de</strong> l’estime <strong>de</strong> soi, <strong>de</strong> la relation à autrui ou <strong>de</strong> la construction <strong>de</strong> l’avenir.Ces évolutions positives sont à apprécier en lien avec chaque histoire personnelle, <strong>et</strong> s’effectuentprogressivement. Dans ce sens, la durée est un indicateur essentiel. La relation éducative qui seprolonge dans le temps ou l’inscription successive du jeune dans les actions proposées par leséducateurs <strong>et</strong> son intégration à différents « groupes constitués » sont présentés comme les critèresd’une action professionnelle réussie. « L’emboitement <strong>de</strong>s actions », selon les termes d’unéducateur, marque les étapes du jeune vers un mieux être, même si ce parcours n’est pas linéaire <strong>et</strong>peut comporter <strong>de</strong>s phases rétroactives.Travailler avec les groupes constitue, ensuite, une modalité d’action susceptible d’engendrer unprocessus plus large, concernant l’environnement social local. C<strong>et</strong>te ouverture constitue un secondregistre où peut s’apprécier la portée <strong>de</strong> l’action éducative. Elle concerne, en premier lieu, le lien quise noue avec les familles. Le rapprochement avec celles-ci n’est pas immédiatement recherché, maisest la conséquence du travail avec les groupes. Celui-ci donne une voie d’accès aux familles lorsqu’ilfaut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r une autorisation pour une sortie, organiser un déplacement sportif, présenter lorsd’une soirée conviviale les souvenirs <strong>de</strong> voyage, expérience enrichissante qui valorise les <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong>,par ricoch<strong>et</strong>, les familles venues pour c<strong>et</strong>te occasion. Le montage d’un proj<strong>et</strong>, la participation <strong>de</strong>s<strong>jeunes</strong> à une activité sont autant d’opportunités que les éducateurs saisissent pour solliciter lesfamilles, les connaître, les impliquer alors que le contact ne se réalise pas spontanément, celles-ciétant souvent en r<strong>et</strong>rait ou « dépassées » par les situations qu’elles vivent. De surcroît, l’abord estfacilité puisqu’il s’effectue dans un contexte doublement dédramatisé, d’une part, par le fait ducollectif qui dépersonnalise <strong>et</strong>, d’autre part qui est celui d’une perspective porteuse <strong>et</strong> non <strong>de</strong>situations individuelles problématiques. Le milieu familial est donc largement pris en compte par lesprofessionnels. L’ai<strong>de</strong> aux <strong>jeunes</strong> passe par l’ai<strong>de</strong> apportée aux familles, souvent fragiles, pourqu’elles offrent aux <strong>jeunes</strong> le cadre structurant dont ils ont besoin.Au-<strong>de</strong>là du cercle familial, l’intervention avec les groupes perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> tendre une passerelle avec lemilieu <strong>de</strong> vie dans ses différentes dimensions : communauté, réseaux <strong>de</strong> sociabilité, quartier. Lesterrains montrent que l’action éducative offre plusieurs façons <strong>de</strong> passer <strong>de</strong> l’entre-soi juvénile à lavie sociale : un chantier ponctuel, <strong>de</strong>stiné à financer une sortie, qui propose différents services àdomicile ; une journée « propr<strong>et</strong>é » <strong>et</strong> d’éducation à l’environnement ; un « jogging »<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 194
- Page 5 and 6:
2 - Le sens d’une action communau
- Page 7 and 8:
AVANT PROPOSLe phénomène des band
- Page 10 and 11:
L’une et l’autre contribuent à
- Page 12 and 13:
Cette seconde étape a été engag
- Page 14 and 15:
CONSTATS ET PRECONISATIONS5 CONSTAT
- Page 16 and 17:
partenariales se développent parfo
- Page 18 and 19:
Les comportements violents et déli
- Page 20 and 21:
jeunes à la relation proposée. El
- Page 22 and 23:
7.2 - L’évaluation en préventio
- Page 24 and 25:
P 10. Prendre en compte les tension
- Page 26 and 27:
I - GROUPES DE JEUNES ET PRATIQUES
- Page 28 and 29:
sans emploi ou exclus de l’école
- Page 30 and 31:
devient « un régulateur social »
- Page 32 and 33:
libération, après la seconde guer
- Page 34 and 35:
l’animation sportive ou culturell
- Page 36 and 37:
L’approche de la personnalité gl
- Page 40 and 41:
ite permet de construire. De façon
- Page 42 and 43:
2 - Formes actuelles de regroupemen
- Page 44 and 45:
Les groupes virtuelsLes jeunes sont
- Page 46 and 47:
4 - Structuration et fonctionnement
- Page 48 and 49:
en tant que travailleur social. ..
- Page 50 and 51:
fonctionnement marginal et délictu
- Page 54 and 55:
liée à l’absence d’intériori
- Page 56 and 57:
Une pratique sociale collective a p
- Page 58 and 59:
CHAPITRE 5 : LES ATTENTES ET COMMAN
- Page 60 and 61:
« Le champ d’intervention de la
- Page 62 and 63:
Dans le projet de Contrat local de
- Page 64 and 65:
CHAPITRE 6 : AGIR AVEC LE GROUPELes
- Page 66 and 67:
Le comportement de jeunes en situat
- Page 68 and 69:
L’évaluation des actions entrepr
- Page 70 and 71:
5. Ces éducateurs vont essayer d
- Page 72 and 73:
La complexité des interactions dan
- Page 74 and 75:
La réflexion concernant cette rech
- Page 76 and 77:
P O S T F A C EL’incompréhension
- Page 78 and 79:
Les travaux du CTPS ne nient pas la
- Page 80 and 81:
ANNEXE : Questionnaire flashAnalyse
- Page 82 and 83:
MasculinFémininmixte18ansMono ethn
- Page 84 and 85:
CONSEIL TECHNIQUEDES CLUBS ET EQUIP
- Page 86 and 87:
II- PRATIQUES EDUCATIVES ET GROUPES
- Page 88 and 89:
son action sur les jeunes et sur le
- Page 90 and 91:
précarisées. Ce site nous a permi
- Page 92 and 93:
PARTIE 1 : Monographies des sitesCe
- Page 94 and 95:
les familles se connaissent entre e
- Page 96 and 97:
de 6 à 18 ans pendant leur temps l
- Page 98 and 99:
public. Pour l’association et ses
- Page 100 and 101:
dans l’espace public) et l’acco
- Page 102 and 103:
moyens : les éducateurs ne peuvent
- Page 104 and 105:
démarches liées au projet mais é
- Page 106 and 107:
Le projet Futsal : une salle en ges
- Page 108 and 109:
CHAPITRE 2 : Le Neuhof - JEEP1 - Le
- Page 110 and 111:
pourcentage, le plus haut comparati
- Page 112 and 113:
esponsables du collège qui, lors d
- Page 114 and 115:
La Jeep se compose d’une directio
- Page 116 and 117:
développent d’autres actions sur
- Page 118 and 119:
traduit le choix de l’équipe de
- Page 120 and 121:
Par différence, le registre d’in
- Page 122 and 123:
La présence dans les établissemen
- Page 124 and 125:
organisé par les éducateurs de la
- Page 126 and 127:
CHAPITRE 3 : Paris 18è - ARC 75/Mo
- Page 128 and 129:
commune à tous les jeunes du quart
- Page 130 and 131:
En 2007, l'association ARC 75 a men
- Page 132 and 133:
d'intervention pour ARC 75 a été
- Page 134 and 135:
L'équipe organise son travail de m
- Page 136 and 137:
Outre l’absence de qualification
- Page 138 and 139:
Les projets Scopados s’inscrivent
- Page 140 and 141:
PARTIE 2 : éléments d’analyseL
- Page 142 and 143:
Enfin, un autre critère central da
- Page 144 and 145: La construction de cette identité
- Page 146 and 147: epérer si le groupe permet au jeun
- Page 148 and 149: On voit donc que le groupe protège
- Page 150 and 151: Souvent, les éducateurs remarquent
- Page 152 and 153: La stabilité des groupesDe manièr
- Page 156 and 157: jeunes, comme nous l’explique Dav
- Page 158 and 159: Pour conclure, les jeunes membres d
- Page 160 and 161: pairs. » 151 Ainsi, les jeunes rè
- Page 162 and 163: Le squat qui peut, par exemple, êt
- Page 164 and 165: s’instaure le contact entre les
- Page 166 and 167: associatives. Ils sont liés aux ca
- Page 168 and 169: signifie qu’il constitue pour eux
- Page 170 and 171: interlocuteurs, de « patiente et r
- Page 172 and 173: plusieurs membres du groupe. Vraise
- Page 174 and 175: l’activité de boxe thaïlandaise
- Page 176 and 177: La composition du groupe témoigne
- Page 178 and 179: « Il faut un support concret » af
- Page 180 and 181: modifier les comportements individu
- Page 182 and 183: l’ensemble des raisons. Celles-ci
- Page 184 and 185: champ professionnel 176 .A certaine
- Page 186 and 187: individuels sur le plan de la sant
- Page 188 and 189: a traversé les mouvements éducati
- Page 190 and 191: econstruire ensuite différemment,
- Page 192 and 193: empirique de l’action auprès des
- Page 196 and 197: d’entraînement au petit matin da
- Page 198 and 199: compétences tiennent autant à une
- Page 200 and 201: correspondants de nuit, animateurs,
- Page 202 and 203: ANNEXESGroupes de jeunes et pratiqu
- Page 204 and 205: Le Conseil Technique remercie égal
- Page 206 and 207: DESCOURTIS Jean-Luc, directeur, ARC
- Page 208 and 209: CHOBEAUX François, Les nomades du
- Page 210 and 211: Rapports et étudesAPASE, Les jeune
- Page 212: Communauté d’agglomération du P