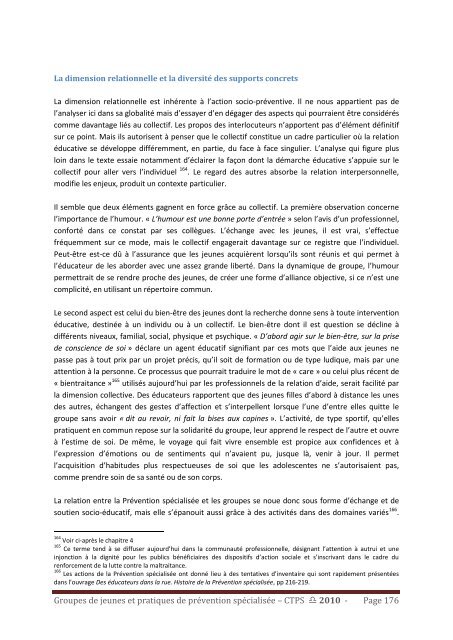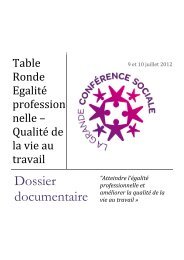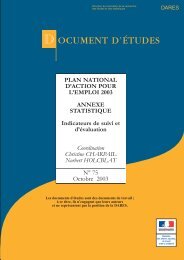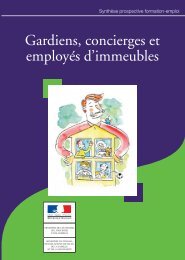Groupes de jeunes et pratiques de prévention spécialisée
Groupes de jeunes et pratiques de prévention spécialisée
Groupes de jeunes et pratiques de prévention spécialisée
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La dimension relationnelle <strong>et</strong> la diversité <strong>de</strong>s supports concr<strong>et</strong>sLa dimension relationnelle est inhérente à l’action socio-préventive. Il ne nous appartient pas <strong>de</strong>l’analyser ici dans sa globalité mais d’essayer d’en dégager <strong>de</strong>s aspects qui pourraient être considéréscomme davantage liés au collectif. Les propos <strong>de</strong>s interlocuteurs n’apportent pas d’élément définitifsur ce point. Mais ils autorisent à penser que le collectif constitue un cadre particulier où la relationéducative se développe différemment, en partie, du face à face singulier. L’analyse qui figure plusloin dans le texte essaie notamment d’éclairer la façon dont la démarche éducative s’appuie sur lecollectif pour aller vers l’individuel 164 . Le regard <strong>de</strong>s autres absorbe la relation interpersonnelle,modifie les enjeux, produit un contexte particulier.Il semble que <strong>de</strong>ux éléments gagnent en force grâce au collectif. La première observation concernel’importance <strong>de</strong> l’humour. « L’humour est une bonne porte d’entrée » selon l’avis d’un professionnel,conforté dans ce constat par ses collègues. L’échange avec les <strong>jeunes</strong>, il est vrai, s’effectuefréquemment sur ce mo<strong>de</strong>, mais le collectif engagerait davantage sur ce registre que l’individuel.Peut-être est-ce dû à l’assurance que les <strong>jeunes</strong> acquièrent lorsqu’ils sont réunis <strong>et</strong> qui perm<strong>et</strong> àl’éducateur <strong>de</strong> les abor<strong>de</strong>r avec une assez gran<strong>de</strong> liberté. Dans la dynamique <strong>de</strong> groupe, l’humourperm<strong>et</strong>trait <strong>de</strong> se rendre proche <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong>, <strong>de</strong> créer une forme d’alliance objective, si ce n’est unecomplicité, en utilisant un répertoire commun.Le second aspect est celui du bien-être <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> dont la recherche donne sens à toute interventionéducative, <strong>de</strong>stinée à un individu ou à un collectif. Le bien-être dont il est question se décline àdifférents niveaux, familial, social, physique <strong>et</strong> psychique. « D’abord agir sur le bien-être, sur la prise<strong>de</strong> conscience <strong>de</strong> soi » déclare un agent éducatif signifiant par ces mots que l’ai<strong>de</strong> aux <strong>jeunes</strong> nepasse pas à tout prix par un proj<strong>et</strong> précis, qu’il soit <strong>de</strong> formation ou <strong>de</strong> type ludique, mais par uneattention à la personne. Ce processus que pourrait traduire le mot <strong>de</strong> « care » ou celui plus récent <strong>de</strong>« bientraitance » 165 utilisés aujourd’hui par les professionnels <strong>de</strong> la relation d’ai<strong>de</strong>, serait facilité parla dimension collective. Des éducateurs rapportent que <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> filles d’abord à distance les unes<strong>de</strong>s autres, échangent <strong>de</strong>s gestes d’affection <strong>et</strong> s’interpellent lorsque l’une d’entre elles quitte legroupe sans avoir « dit au revoir, ni fait la bises aux copines ». L’activité, <strong>de</strong> type sportif, qu’ellespratiquent en commun repose sur la solidarité du groupe, leur apprend le respect <strong>de</strong> l’autre <strong>et</strong> ouvreà l’estime <strong>de</strong> soi. De même, le voyage qui fait vivre ensemble est propice aux confi<strong>de</strong>nces <strong>et</strong> àl’expression d’émotions ou <strong>de</strong> sentiments qui n’avaient pu, jusque là, venir à jour. Il perm<strong>et</strong>l’acquisition d’habitu<strong>de</strong>s plus respectueuses <strong>de</strong> soi que les adolescentes ne s’autorisaient pas,comme prendre soin <strong>de</strong> sa santé ou <strong>de</strong> son corps.La relation entre la Prévention spécialisée <strong>et</strong> les groupes se noue donc sous forme d’échange <strong>et</strong> <strong>de</strong>soutien socio-éducatif, mais elle s’épanouit aussi grâce à <strong>de</strong>s activités dans <strong>de</strong>s domaines variés 166 .164 Voir ci-après le chapitre 4165 Ce terme tend à se diffuser aujourd’hui dans la communauté professionnelle, désignant l’attention à autrui <strong>et</strong> uneinjonction à la dignité pour les publics bénéficiaires <strong>de</strong>s dispositifs d’action sociale <strong>et</strong> s’inscrivant dans le cadre durenforcement <strong>de</strong> la lutte contre la maltraitance.166 Les actions <strong>de</strong> la Prévention spécialisée ont donné lieu à <strong>de</strong>s tentatives d’inventaire qui sont rapi<strong>de</strong>ment présentéesdans l’ouvrage Des éducateurs dans la rue. Histoire <strong>de</strong> la Prévention spécialisée, pp 216-219.<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 176