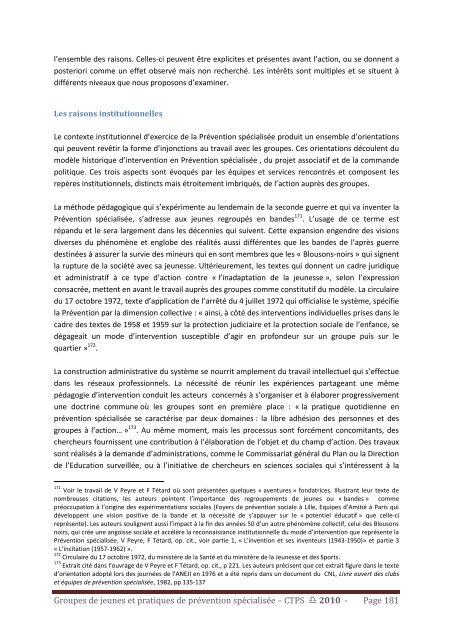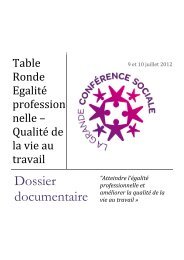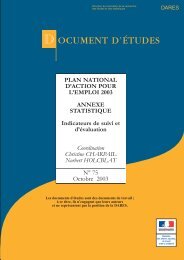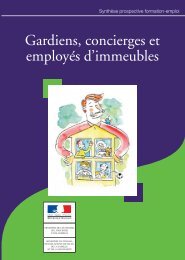l’ensemble <strong>de</strong>s raisons. Celles-ci peuvent être explicites <strong>et</strong> présentes avant l’action, ou se donnent aposteriori comme un eff<strong>et</strong> observé mais non recherché. Les intérêts sont multiples <strong>et</strong> se situent àdifférents niveaux que nous proposons d’examiner.Les raisons institutionnellesLe contexte institutionnel d’exercice <strong>de</strong> la Prévention spécialisée produit un ensemble d’orientationsqui peuvent revêtir la forme d’injonctions au travail avec les groupes. Ces orientations découlent dumodèle historique d’intervention en Prévention spécialisée , du proj<strong>et</strong> associatif <strong>et</strong> <strong>de</strong> la comman<strong>de</strong>politique. Ces trois aspects sont évoqués par les équipes <strong>et</strong> services rencontrés <strong>et</strong> composent lesrepères institutionnels, distincts mais étroitement imbriqués, <strong>de</strong> l’action auprès <strong>de</strong>s groupes.La métho<strong>de</strong> pédagogique qui s’expérimente au len<strong>de</strong>main <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> guerre <strong>et</strong> qui va inventer laPrévention spécialisée, s’adresse aux <strong>jeunes</strong> regroupés en ban<strong>de</strong>s 171 . L’usage <strong>de</strong> ce terme estrépandu <strong>et</strong> le sera largement dans les décennies qui suivent. C<strong>et</strong>te expansion engendre <strong>de</strong>s visionsdiverses du phénomène <strong>et</strong> englobe <strong>de</strong>s réalités aussi différentes que les ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’après guerre<strong>de</strong>stinées à assurer la survie <strong>de</strong>s mineurs qui en sont membres que les « Blousons-noirs » qui signentla rupture <strong>de</strong> la société avec sa <strong>jeunes</strong>se. Ultérieurement, les textes qui donnent un cadre juridique<strong>et</strong> administratif à ce type d’action contre « l’inadaptation <strong>de</strong> la <strong>jeunes</strong>se », selon l’expressionconsacrée, m<strong>et</strong>tent en avant le travail auprès <strong>de</strong>s groupes comme constitutif du modèle. La circulairedu 17 octobre 1972, texte d’application <strong>de</strong> l’arrêté du 4 juill<strong>et</strong> 1972 qui officialise le système, spécifiela Prévention par la dimension collective : « ainsi, à côté <strong>de</strong>s interventions individuelles prises dans lecadre <strong>de</strong>s textes <strong>de</strong> 1958 <strong>et</strong> 1959 sur la protection judiciaire <strong>et</strong> la protection sociale <strong>de</strong> l’enfance, sedégageait un mo<strong>de</strong> d’intervention susceptible d’agir en profon<strong>de</strong>ur sur un groupe puis sur lequartier » 172 .La construction administrative du système se nourrit amplement du travail intellectuel qui s’effectuedans les réseaux professionnels. La nécessité <strong>de</strong> réunir les expériences partageant une mêmepédagogie d’intervention conduit les acteurs concernés à s’organiser <strong>et</strong> à élaborer progressivementune doctrine commune où les groupes sont en première place : « la pratique quotidienne enprévention spécialisée se caractérise par <strong>de</strong>ux domaines : la libre adhésion <strong>de</strong>s personnes <strong>et</strong> <strong>de</strong>sgroupes à l’action… » 173 . Au même moment, mais les processus sont forcément concomitants, <strong>de</strong>schercheurs fournissent une contribution à l’élaboration <strong>de</strong> l’obj<strong>et</strong> <strong>et</strong> du champ d’action. Des travauxsont réalisés à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’administrations, comme le Commissariat général du Plan ou la Direction<strong>de</strong> l’Education surveillée, ou à l’initiative <strong>de</strong> chercheurs en sciences sociales qui s’intéressent à la171 Voir le travail <strong>de</strong> V Peyre <strong>et</strong> F Tétard où sont présentées quelques « aventures » fondatrices. Illustrant leur texte <strong>de</strong>nombreuses citations, les auteurs pointent l’importance <strong>de</strong>s regroupements <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> ou « ban<strong>de</strong>s » commepréoccupation à l’origine <strong>de</strong>s expérimentations sociales (Foyers <strong>de</strong> prévention sociale à Lille, Equipes d’Amitié à Paris quidéveloppent une vision positive <strong>de</strong> la ban<strong>de</strong> <strong>et</strong> la nécessité <strong>de</strong> s’appuyer sur le « potentiel éducatif » que celle-cireprésente). Les auteurs soulignent aussi l’impact à la fin <strong>de</strong>s années 50 d’un autre phénomène collectif, celui <strong>de</strong>s Blousonsnoirs, qui crée une angoisse sociale <strong>et</strong> accélère la reconnaissance institutionnelle du mo<strong>de</strong> d’intervention que représente laPrévention spécialisée. V Peyre, F Tétard, op. cit., voir partie 1, « L’invention <strong>et</strong> ses inventeurs (1943-1950)» <strong>et</strong> partie 3« L’incitation (1957-1962) ».172 Circulaire du 17 octobre 1972, du ministère <strong>de</strong> la Santé <strong>et</strong> du ministère <strong>de</strong> la Jeunesse <strong>et</strong> <strong>de</strong>s Sports.173 Extrait cité dans l’ouvrage <strong>de</strong> V Peyre <strong>et</strong> F Tétard, op. cit., p 221. Les auteurs précisent que c<strong>et</strong> extrait figure dans le texted’orientation adopté lors <strong>de</strong>s journées <strong>de</strong> l’ANEJI en 1976 <strong>et</strong> a été repris dans un document du CNL, Livre ouvert <strong>de</strong>s clubs<strong>et</strong> équipes <strong>de</strong> prévention spécialisée, 1982, pp 135-137<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 181
<strong>jeunes</strong>se. Le regroupement du jeune fait parti <strong>de</strong>s principales thématiques <strong>de</strong> recherche. Il est étudiécomme une composante fondatrice du modèle né en réponse aux problèmes <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> <strong>de</strong>squartiers, ou est traité en lien avec une préoccupation sécuritaire 174 .Le phénomène <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> traverse donc l’histoire <strong>de</strong> la Prévention spécialisée, commeélément du problème <strong>et</strong> comme cible naturelle <strong>de</strong> la réponse. Revendiqué, à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés différents,c<strong>et</strong> héritage tend à se r<strong>et</strong>rouver dans les proj<strong>et</strong>s associatifs actuels. Il a été <strong>de</strong> tout temps au cœur duproj<strong>et</strong> <strong>de</strong> la structure parisienne qui a construit son i<strong>de</strong>ntité professionnelle sur c<strong>et</strong>te orientationcollective. Pour elle, le travail avec les groupes est « systématique » <strong>et</strong> « s’inscrit historiquement dansla norme <strong>de</strong> la Prévention ». L’association a consacré <strong>de</strong>s journées d’étu<strong>de</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> formation au thème.Les équipes voironnaise <strong>et</strong> strasbourgeoise font également référence au proj<strong>et</strong> associatif ou auproj<strong>et</strong> <strong>de</strong> service qui a inscrit l’aspect collectif comme un axe prioritaire <strong>de</strong> travail, ce que résume unéducateur : « c’est marqué dans notre mission <strong>et</strong> c’est décliné dans le proj<strong>et</strong> associatif ».La troisième raison <strong>de</strong> type institutionnel explicative <strong>de</strong> l’effort éducatif auprès <strong>de</strong>s groupes rési<strong>de</strong>dans la comman<strong>de</strong> politique. Celle-ci s’exprime en général sous forme <strong>de</strong> convention qui précise lesorientations concrètes <strong>de</strong> la Prévention dans le site concerné <strong>et</strong> constitue un document <strong>de</strong> référence.Ce document, fruit d’une négociation entre l’instance politique <strong>et</strong> les responsables professionnels,peut m<strong>et</strong>tre en avant <strong>de</strong> façon particulière, voire prioritaire, l’action auprès <strong>de</strong>s groupes. C’estl’exemple <strong>de</strong> la convention qui lie les trois partenaires du Pays voironnais : « ce qui est <strong>de</strong>mandé dansla convention, c’est qu’on intervienne d’abord auprès <strong>de</strong>s groupes ». Dans d’autres contextes, lacomman<strong>de</strong> est plus diversifiée <strong>et</strong> cherche à concilier les <strong>de</strong>ux logiques individuelle <strong>et</strong> collective. LaCharte départementale <strong>de</strong> la Prévention spécialisée dans le Bas-Rhin, d’octobre 2006, évoque àquelques reprises les interventions collectives <strong>et</strong> inclut dans les orientations cadres le travail auprès<strong>de</strong>s groupes.La référence au collectif figure donc, peu ou prou, dans les différents documents institutionnelsproduits par les autorités publiques <strong>et</strong> par les organismes professionnels. C<strong>et</strong>te référence puise salégitimité dans l’histoire. Mais la raison historique vaut car le proj<strong>et</strong> éducatif d’origine conserveaujourd’hui toute sa force face aux évolutions contemporaines. Les propos recueillis laissent penser,d’ailleurs, que la thématique du groupe est en train d’acquérir une force renouvelée dans le contexteactuel. On assisterait même à un « emballement » <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te thématique dont plusieurs évènementsou réflexions témoignent : la mise sur agenda politique <strong>de</strong> la question <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong>, la loi du5 mars 2007 réformant la protection <strong>de</strong> l’enfance qui instaure les groupes <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> comme publicprioritaire <strong>de</strong> la Prévention spécialisée 175 , les travaux réalisés par les instances représentatives du174 Les étu<strong>de</strong>s sur la délinquance <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> en groupe <strong>et</strong> sur les ban<strong>de</strong>s qui se multiplient dans la pério<strong>de</strong>, vont susciter<strong>de</strong>s polémiques dont les termes revêtent une tonalité très actuelle. On peut citer notamment la réflexion coordonnée parHenri Michard <strong>et</strong> Jacques Selosse du Centre <strong>de</strong> Recherche <strong>et</strong> d’Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Education surveillée (CFRES) sur les ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong><strong>jeunes</strong>. : « l’attention <strong>de</strong> l’opinion publique est attirée <strong>de</strong>puis plusieurs années sur <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> qui semanifestent par <strong>de</strong>s excentricités, <strong>de</strong>s désordres, <strong>de</strong>s comportements plus ou moins répréhensibles troublant l’ordrepublic… », La délinquance <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> en groupe. Contribution à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la société adolescente, Paris, éd Cujas, 1963.Quelques années plus tard, l’<strong>et</strong>hnologue Jean Monod porte un regard critique sur le travail précé<strong>de</strong>nt <strong>et</strong> livre sa propreanalyse : « les données qu’elles (les étu<strong>de</strong>s) chiffrent reposent sur <strong>de</strong>s observations déficientes, doublement faussées parl’interrogatoire policier <strong>et</strong> judiciaire. Les ban<strong>de</strong>s qui nous sont présentées sont <strong>de</strong>s cadavres ». Voir V. Peyre, F.Tétard, op.cit., p 171-172.175 Voir la loi du 5 mars 2007 réformant la protection <strong>de</strong> l’enfance, annexe 14 sur la Prévention spécialisée : « La Préventionspécialisée s’adressant à <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong>… ». Source : Gui<strong>de</strong> pratique <strong>de</strong> la Protection <strong>de</strong> l’enfant <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’adolescent,ministère <strong>de</strong> la Santé <strong>et</strong> <strong>de</strong>s Solidarités, 2007.<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 182
- Page 5 and 6:
2 - Le sens d’une action communau
- Page 7 and 8:
AVANT PROPOSLe phénomène des band
- Page 10 and 11:
L’une et l’autre contribuent à
- Page 12 and 13:
Cette seconde étape a été engag
- Page 14 and 15:
CONSTATS ET PRECONISATIONS5 CONSTAT
- Page 16 and 17:
partenariales se développent parfo
- Page 18 and 19:
Les comportements violents et déli
- Page 20 and 21:
jeunes à la relation proposée. El
- Page 22 and 23:
7.2 - L’évaluation en préventio
- Page 24 and 25:
P 10. Prendre en compte les tension
- Page 26 and 27:
I - GROUPES DE JEUNES ET PRATIQUES
- Page 28 and 29:
sans emploi ou exclus de l’école
- Page 30 and 31:
devient « un régulateur social »
- Page 32 and 33:
libération, après la seconde guer
- Page 34 and 35:
l’animation sportive ou culturell
- Page 36 and 37:
L’approche de la personnalité gl
- Page 40 and 41:
ite permet de construire. De façon
- Page 42 and 43:
2 - Formes actuelles de regroupemen
- Page 44 and 45:
Les groupes virtuelsLes jeunes sont
- Page 46 and 47:
4 - Structuration et fonctionnement
- Page 48 and 49:
en tant que travailleur social. ..
- Page 50 and 51:
fonctionnement marginal et délictu
- Page 54 and 55:
liée à l’absence d’intériori
- Page 56 and 57:
Une pratique sociale collective a p
- Page 58 and 59:
CHAPITRE 5 : LES ATTENTES ET COMMAN
- Page 60 and 61:
« Le champ d’intervention de la
- Page 62 and 63:
Dans le projet de Contrat local de
- Page 64 and 65:
CHAPITRE 6 : AGIR AVEC LE GROUPELes
- Page 66 and 67:
Le comportement de jeunes en situat
- Page 68 and 69:
L’évaluation des actions entrepr
- Page 70 and 71:
5. Ces éducateurs vont essayer d
- Page 72 and 73:
La complexité des interactions dan
- Page 74 and 75:
La réflexion concernant cette rech
- Page 76 and 77:
P O S T F A C EL’incompréhension
- Page 78 and 79:
Les travaux du CTPS ne nient pas la
- Page 80 and 81:
ANNEXE : Questionnaire flashAnalyse
- Page 82 and 83:
MasculinFémininmixte18ansMono ethn
- Page 84 and 85:
CONSEIL TECHNIQUEDES CLUBS ET EQUIP
- Page 86 and 87:
II- PRATIQUES EDUCATIVES ET GROUPES
- Page 88 and 89:
son action sur les jeunes et sur le
- Page 90 and 91:
précarisées. Ce site nous a permi
- Page 92 and 93:
PARTIE 1 : Monographies des sitesCe
- Page 94 and 95:
les familles se connaissent entre e
- Page 96 and 97:
de 6 à 18 ans pendant leur temps l
- Page 98 and 99:
public. Pour l’association et ses
- Page 100 and 101:
dans l’espace public) et l’acco
- Page 102 and 103:
moyens : les éducateurs ne peuvent
- Page 104 and 105:
démarches liées au projet mais é
- Page 106 and 107:
Le projet Futsal : une salle en ges
- Page 108 and 109:
CHAPITRE 2 : Le Neuhof - JEEP1 - Le
- Page 110 and 111:
pourcentage, le plus haut comparati
- Page 112 and 113:
esponsables du collège qui, lors d
- Page 114 and 115:
La Jeep se compose d’une directio
- Page 116 and 117:
développent d’autres actions sur
- Page 118 and 119:
traduit le choix de l’équipe de
- Page 120 and 121:
Par différence, le registre d’in
- Page 122 and 123:
La présence dans les établissemen
- Page 124 and 125:
organisé par les éducateurs de la
- Page 126 and 127:
CHAPITRE 3 : Paris 18è - ARC 75/Mo
- Page 128 and 129:
commune à tous les jeunes du quart
- Page 130 and 131:
En 2007, l'association ARC 75 a men
- Page 132 and 133: d'intervention pour ARC 75 a été
- Page 134 and 135: L'équipe organise son travail de m
- Page 136 and 137: Outre l’absence de qualification
- Page 138 and 139: Les projets Scopados s’inscrivent
- Page 140 and 141: PARTIE 2 : éléments d’analyseL
- Page 142 and 143: Enfin, un autre critère central da
- Page 144 and 145: La construction de cette identité
- Page 146 and 147: epérer si le groupe permet au jeun
- Page 148 and 149: On voit donc que le groupe protège
- Page 150 and 151: Souvent, les éducateurs remarquent
- Page 152 and 153: La stabilité des groupesDe manièr
- Page 156 and 157: jeunes, comme nous l’explique Dav
- Page 158 and 159: Pour conclure, les jeunes membres d
- Page 160 and 161: pairs. » 151 Ainsi, les jeunes rè
- Page 162 and 163: Le squat qui peut, par exemple, êt
- Page 164 and 165: s’instaure le contact entre les
- Page 166 and 167: associatives. Ils sont liés aux ca
- Page 168 and 169: signifie qu’il constitue pour eux
- Page 170 and 171: interlocuteurs, de « patiente et r
- Page 172 and 173: plusieurs membres du groupe. Vraise
- Page 174 and 175: l’activité de boxe thaïlandaise
- Page 176 and 177: La composition du groupe témoigne
- Page 178 and 179: « Il faut un support concret » af
- Page 180 and 181: modifier les comportements individu
- Page 184 and 185: champ professionnel 176 .A certaine
- Page 186 and 187: individuels sur le plan de la sant
- Page 188 and 189: a traversé les mouvements éducati
- Page 190 and 191: econstruire ensuite différemment,
- Page 192 and 193: empirique de l’action auprès des
- Page 194 and 195: manifesté à ces occasions à cett
- Page 196 and 197: d’entraînement au petit matin da
- Page 198 and 199: compétences tiennent autant à une
- Page 200 and 201: correspondants de nuit, animateurs,
- Page 202 and 203: ANNEXESGroupes de jeunes et pratiqu
- Page 204 and 205: Le Conseil Technique remercie égal
- Page 206 and 207: DESCOURTIS Jean-Luc, directeur, ARC
- Page 208 and 209: CHOBEAUX François, Les nomades du
- Page 210 and 211: Rapports et étudesAPASE, Les jeune
- Page 212: Communauté d’agglomération du P