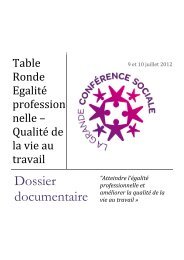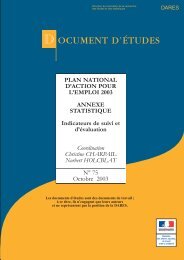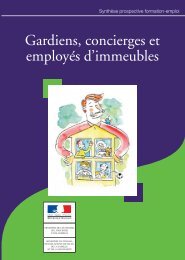La construction <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te i<strong>de</strong>ntité est centrale, <strong>et</strong> se reflète dans l’image <strong>de</strong> soi : une i<strong>de</strong>ntitéextériorisée, pouvant être formalisée verbalement, qui contient à la fois ce que l’on donne à voir <strong>de</strong>nous mais aussi ce que les autres observent <strong>de</strong> nous, qui peut parfois être superficiel. C<strong>et</strong>te image <strong>de</strong>soi est donc liée aux interactions avec les autres : s’ils nous renvoient une image négative <strong>de</strong> nousmêmes,nous aurons tendance à nous dévaloriser. Elle découle donc pour une large part d’unjugement normatif imposé par autrui : l’individu est jugé négativement lorsque son comportementne correspond pas aux attentes répondant aux normes sociales.Ainsi, ce refl<strong>et</strong> <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> chacun peut se développer selon <strong>de</strong>ux orientations : soit une i<strong>de</strong>ntiténégative qui se caractérise par « un sentiment <strong>de</strong> mal être, d’impuissance, d’être mal considéré parles autres, d’avoir <strong>de</strong> mauvaises représentations <strong>de</strong> ses activités <strong>et</strong> <strong>de</strong> soi » 126 ; soit à l’inverse, unei<strong>de</strong>ntité positive constituée par « le sentiment d’avoir <strong>de</strong>s qualités, <strong>de</strong> pouvoir influer sur les êtres <strong>et</strong>les choses, <strong>de</strong> maîtriser (au moins partiellement) l’environnement <strong>et</strong> d’avoir <strong>de</strong>s représentations <strong>de</strong>soi plutôt favorables ». Les personnes ayant une image <strong>de</strong> soi positive construisent plus facilement<strong>de</strong>s proj<strong>et</strong>s d’avenir <strong>et</strong> surmontent plus facilement les obstacles <strong>et</strong> les échecs.Au cours <strong>de</strong> sa vie, l’homme appartient à divers groupes sociaux, qui forgent son i<strong>de</strong>ntité sociale.Certaines appartenances sont constitutives d’un choix, mais pas toutes : on peut fréquenter ungroupe, par exemple dans le milieu professionnel ou scolaire, par obligation. Ces multiplesappartenances créent parfois <strong>de</strong>s divergences d’intérêts qui provoquent <strong>de</strong>s conflits d’i<strong>de</strong>ntité quimenacent la cohérence <strong>de</strong> l’image <strong>de</strong> soi <strong>et</strong> obligent à <strong>de</strong>s compromis. Mais « l’individu cherchel’appartenance, la sociabilité, parfois la similitu<strong>de</strong> aux autres, mais jusqu’à un certain point » 127 car sila socialisation passe par un partage <strong>de</strong>s valeurs, une construction i<strong>de</strong>ntitaire positive ne peuts’accomplir que dans la mesure où l’individu <strong>de</strong>meure un être distinct. Ainsi, quand l’individu al’impression d’une trop forte conformité aux autres, il cherchera au contraire à se différencier par <strong>de</strong>nouvelles manières d’être <strong>et</strong> <strong>de</strong> faire.Tout l’enjeu pour les éducateurs <strong>de</strong> prévention spécialisée, <strong>et</strong> pour l’ensemble <strong>de</strong>s professionnelsintervenant auprès <strong>de</strong>s personnes en difficulté <strong>de</strong> socialisation, rési<strong>de</strong> justement dans leur capacité àperm<strong>et</strong>tre à la personne d’acquérir une image positive d’elle-même, <strong>et</strong> donc <strong>de</strong> déconstruirel’i<strong>de</strong>ntité négative qu’elle aurait pu se forger. L’adolescence est une pério<strong>de</strong> charnière dans c<strong>et</strong>teconstruction i<strong>de</strong>ntitaire, dans le sens où elle constitue une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> renouvellement <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité :le passage d’un état <strong>de</strong> dépendance vers celui d’indépendance, caractéristique du statut d’adulte.Durant c<strong>et</strong>te pério<strong>de</strong>, l’image <strong>de</strong> soi est particulièrement constituée par les liens à autrui, <strong>et</strong>notamment aux affinités <strong>de</strong> groupe, comme nous allons le voir ci-<strong>de</strong>ssous.La fonction socialisante du groupe au cours <strong>de</strong> l’adolescenceDès le plus jeune âge, l’enfant est amené à se construire dans un collectif d’abord restreint du couplemère-enfant, puis familial <strong>et</strong>, enfin, supra familial. A partir du jardin d’enfant <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’école maternelle,le jeune enfant s’inscrit dans un fonctionnement collectif, souvent axé sur le jeu. Le groupe existealors uniquement sur la base d’une activité.126 Malewska-Peyre, 1999127 Malewska-Peyre, 1999<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 143
Il faut attendre l’âge <strong>de</strong> neuf ou dix ans pour voir l’apparition <strong>de</strong> groupes qui existent au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>l’activité qui leur a donné naissance, avec l’apparition <strong>de</strong> liens affectifs qui perm<strong>et</strong>tent à l’enfantd’acquérir une conscience sociale. A l’adolescence, le groupe acquiert <strong>de</strong>s caractéristiquesparticulières. « Face à l’évolution psycho-sociologique que *l’adolescent+ subit, au milieu familial quiréagit souvent à ses outrances, il lui faut découvrir les moyens <strong>de</strong> s’affirmer tout en r<strong>et</strong>rouvant unesécurité <strong>et</strong> une i<strong>de</strong>ntité. Le groupe, qu’il s’agisse d’un mouvement <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong>se, d’un gang ou d’uneclique, apporte une solution à c<strong>et</strong>te crise. » 128C’est à partir <strong>de</strong> l’âge du collège que l’on r<strong>et</strong>rouve les <strong>jeunes</strong> dans la rue, rarement plus tôt, <strong>et</strong> ceux-cioccupent l’espace public jusqu’à l’âge <strong>de</strong> 20 ans environ. En eff<strong>et</strong>, à partir <strong>de</strong> c<strong>et</strong> âge, ils investissentmoins le groupe puisqu’ils commencent à acquérir une certaine autonomie : ils ont un travail qui lesastreint à certains horaires, développent <strong>de</strong>s relations amoureuses qui ne peuvent s’épanouir au seindu groupe <strong>de</strong> pairs <strong>et</strong>, parfois, disposent d’un logement individuel qui leur perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> rester chez eux<strong>et</strong>/ou <strong>de</strong> recevoir le groupe. Ils peuvent également simplement avoir déménagé. Dans tous les cas, àces âges, l’inscription dans le groupe est moins forte, plus disparate. Plus généralement, on note uneindividualisation progressive <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> avec l’âge, avec une pério<strong>de</strong> charnière d’équilibre entrel’individuel <strong>et</strong> le collectif vers l’âge <strong>de</strong> 17 ans.Il semble important <strong>de</strong> rappeler que le groupe <strong>de</strong> pairs a une fonction propre <strong>et</strong> centrale, lasociabilité <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong>, car il constitue un entre-soi pour les <strong>jeunes</strong> qui leur perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> se construire entant qu’individu, sans la présence <strong>de</strong>s adultes, en se r<strong>et</strong>rouvant pour être ensemble, pour discuter,pour partager. Car l’homme est un "animal" social <strong>et</strong>, comme le souligne Michel Lemay, « nonseulement son avenir est dépendant <strong>de</strong>s autres, mais il ne parviendra à se connaître lui-même quelorsqu’il commencera à découvrir l’existence d’autrui. Il va donc exister chez tout individu, <strong>et</strong> ceci dèsles premiers mois <strong>de</strong> sa vie, l’intense besoin <strong>de</strong> se chercher dans les autres. » 129 Le groupe constituedonc pour les <strong>jeunes</strong> un espace particulier au sein duquel ils se développent sans l’autorité directe<strong>de</strong>s adultes. « La fonction du groupe à l'adolescence est structurante. Les groupes viennent conforterune i<strong>de</strong>ntité personnelle <strong>et</strong>, en général, masculine. Ce sont <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> qui connaissent <strong>de</strong>s défauts <strong>de</strong>filiation, or on trouve son i<strong>de</strong>ntité dans la filiation. Eux vont trouver une affiliation dans le groupe. » 130C<strong>et</strong>te construction i<strong>de</strong>ntitaire est fondée sur <strong>de</strong>ux principes : le mimétisme (m<strong>et</strong>tre en soi quelquechose d’autrui, puis créer <strong>de</strong>s liens assez forts pour perm<strong>et</strong>tre à autrui <strong>de</strong> prendre quelque chose <strong>de</strong>soi-même) <strong>et</strong> l’agressivité (opposition constructive à autrui). « Ces <strong>de</strong>ux attitu<strong>de</strong>s opposées vont secombiner, se dissocier, selon <strong>de</strong>s paliers successifs qui finissent par amener l’être humain à s’intégrerdans un ensemble social cohérent. (…) Le groupe est le moyen donné à chaque être humain <strong>de</strong>s’i<strong>de</strong>ntifier à son semblable <strong>et</strong> d’arriver ainsi à sa maturité <strong>et</strong> à son autonomie. » 131Quand la fréquentation du groupe est symptomatique d’un mal-être socialLes professionnels <strong>de</strong> la prévention spécialisée sont bien conscients que la présence <strong>de</strong>s <strong>jeunes</strong> dans<strong>de</strong>s collectifs est primordiale pour leur construction i<strong>de</strong>ntitaire. L’enjeu pour eux est <strong>de</strong> savoir128 Lemay, 1975, page 16129 Lemay, 1975, page 9130 Entr<strong>et</strong>ien avec <strong>de</strong>s psychologues <strong>de</strong> Prévention spécialisée131 Lemay, 1975, page 12<strong>Groupes</strong> <strong>de</strong> <strong>jeunes</strong> <strong>et</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> prévention spécialisée – CTPS 2010 - Page 144
- Page 5 and 6:
2 - Le sens d’une action communau
- Page 7 and 8:
AVANT PROPOSLe phénomène des band
- Page 10 and 11:
L’une et l’autre contribuent à
- Page 12 and 13:
Cette seconde étape a été engag
- Page 14 and 15:
CONSTATS ET PRECONISATIONS5 CONSTAT
- Page 16 and 17:
partenariales se développent parfo
- Page 18 and 19:
Les comportements violents et déli
- Page 20 and 21:
jeunes à la relation proposée. El
- Page 22 and 23:
7.2 - L’évaluation en préventio
- Page 24 and 25:
P 10. Prendre en compte les tension
- Page 26 and 27:
I - GROUPES DE JEUNES ET PRATIQUES
- Page 28 and 29:
sans emploi ou exclus de l’école
- Page 30 and 31:
devient « un régulateur social »
- Page 32 and 33:
libération, après la seconde guer
- Page 34 and 35:
l’animation sportive ou culturell
- Page 36 and 37:
L’approche de la personnalité gl
- Page 40 and 41:
ite permet de construire. De façon
- Page 42 and 43:
2 - Formes actuelles de regroupemen
- Page 44 and 45:
Les groupes virtuelsLes jeunes sont
- Page 46 and 47:
4 - Structuration et fonctionnement
- Page 48 and 49:
en tant que travailleur social. ..
- Page 50 and 51:
fonctionnement marginal et délictu
- Page 54 and 55:
liée à l’absence d’intériori
- Page 56 and 57:
Une pratique sociale collective a p
- Page 58 and 59:
CHAPITRE 5 : LES ATTENTES ET COMMAN
- Page 60 and 61:
« Le champ d’intervention de la
- Page 62 and 63:
Dans le projet de Contrat local de
- Page 64 and 65:
CHAPITRE 6 : AGIR AVEC LE GROUPELes
- Page 66 and 67:
Le comportement de jeunes en situat
- Page 68 and 69:
L’évaluation des actions entrepr
- Page 70 and 71:
5. Ces éducateurs vont essayer d
- Page 72 and 73:
La complexité des interactions dan
- Page 74 and 75:
La réflexion concernant cette rech
- Page 76 and 77:
P O S T F A C EL’incompréhension
- Page 78 and 79:
Les travaux du CTPS ne nient pas la
- Page 80 and 81:
ANNEXE : Questionnaire flashAnalyse
- Page 82 and 83:
MasculinFémininmixte18ansMono ethn
- Page 84 and 85:
CONSEIL TECHNIQUEDES CLUBS ET EQUIP
- Page 86 and 87:
II- PRATIQUES EDUCATIVES ET GROUPES
- Page 88 and 89:
son action sur les jeunes et sur le
- Page 90 and 91:
précarisées. Ce site nous a permi
- Page 92 and 93:
PARTIE 1 : Monographies des sitesCe
- Page 94 and 95: les familles se connaissent entre e
- Page 96 and 97: de 6 à 18 ans pendant leur temps l
- Page 98 and 99: public. Pour l’association et ses
- Page 100 and 101: dans l’espace public) et l’acco
- Page 102 and 103: moyens : les éducateurs ne peuvent
- Page 104 and 105: démarches liées au projet mais é
- Page 106 and 107: Le projet Futsal : une salle en ges
- Page 108 and 109: CHAPITRE 2 : Le Neuhof - JEEP1 - Le
- Page 110 and 111: pourcentage, le plus haut comparati
- Page 112 and 113: esponsables du collège qui, lors d
- Page 114 and 115: La Jeep se compose d’une directio
- Page 116 and 117: développent d’autres actions sur
- Page 118 and 119: traduit le choix de l’équipe de
- Page 120 and 121: Par différence, le registre d’in
- Page 122 and 123: La présence dans les établissemen
- Page 124 and 125: organisé par les éducateurs de la
- Page 126 and 127: CHAPITRE 3 : Paris 18è - ARC 75/Mo
- Page 128 and 129: commune à tous les jeunes du quart
- Page 130 and 131: En 2007, l'association ARC 75 a men
- Page 132 and 133: d'intervention pour ARC 75 a été
- Page 134 and 135: L'équipe organise son travail de m
- Page 136 and 137: Outre l’absence de qualification
- Page 138 and 139: Les projets Scopados s’inscrivent
- Page 140 and 141: PARTIE 2 : éléments d’analyseL
- Page 142 and 143: Enfin, un autre critère central da
- Page 146 and 147: epérer si le groupe permet au jeun
- Page 148 and 149: On voit donc que le groupe protège
- Page 150 and 151: Souvent, les éducateurs remarquent
- Page 152 and 153: La stabilité des groupesDe manièr
- Page 156 and 157: jeunes, comme nous l’explique Dav
- Page 158 and 159: Pour conclure, les jeunes membres d
- Page 160 and 161: pairs. » 151 Ainsi, les jeunes rè
- Page 162 and 163: Le squat qui peut, par exemple, êt
- Page 164 and 165: s’instaure le contact entre les
- Page 166 and 167: associatives. Ils sont liés aux ca
- Page 168 and 169: signifie qu’il constitue pour eux
- Page 170 and 171: interlocuteurs, de « patiente et r
- Page 172 and 173: plusieurs membres du groupe. Vraise
- Page 174 and 175: l’activité de boxe thaïlandaise
- Page 176 and 177: La composition du groupe témoigne
- Page 178 and 179: « Il faut un support concret » af
- Page 180 and 181: modifier les comportements individu
- Page 182 and 183: l’ensemble des raisons. Celles-ci
- Page 184 and 185: champ professionnel 176 .A certaine
- Page 186 and 187: individuels sur le plan de la sant
- Page 188 and 189: a traversé les mouvements éducati
- Page 190 and 191: econstruire ensuite différemment,
- Page 192 and 193: empirique de l’action auprès des
- Page 194 and 195:
manifesté à ces occasions à cett
- Page 196 and 197:
d’entraînement au petit matin da
- Page 198 and 199:
compétences tiennent autant à une
- Page 200 and 201:
correspondants de nuit, animateurs,
- Page 202 and 203:
ANNEXESGroupes de jeunes et pratiqu
- Page 204 and 205:
Le Conseil Technique remercie égal
- Page 206 and 207:
DESCOURTIS Jean-Luc, directeur, ARC
- Page 208 and 209:
CHOBEAUX François, Les nomades du
- Page 210 and 211:
Rapports et étudesAPASE, Les jeune
- Page 212:
Communauté d’agglomération du P