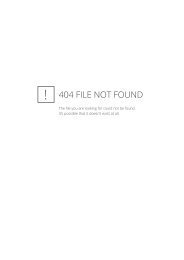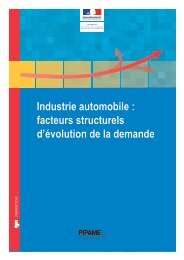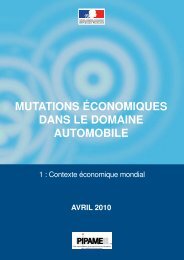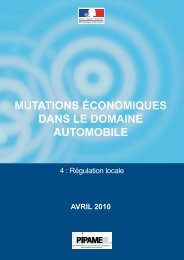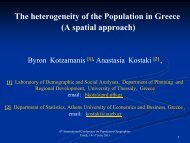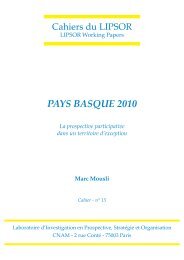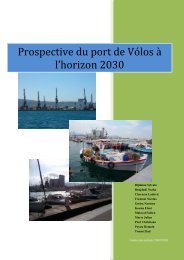prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PROSPECTIVE ET PLANIFICATION TERRITORIALES<br />
105<br />
1) une vision du futur suivie d’un proj<strong>et</strong> finalisé autour de la question « quelle société<br />
voulons-nous à un horizon 2020/30 ?» avec une volonté claire de <strong>prospective</strong><br />
stratégique ;<br />
2) une <strong>planification</strong> spatiale à renouveler avec une présence en demi-teinte de la<br />
<strong>prospective</strong><br />
3) un processus de « <strong>prospective</strong> en continu » ;<br />
4) un mode de conception sans <strong>prospective</strong> intégrée dans les SCOT, mais présente dans<br />
les débats de société locaux, sans passerelle explicite entre les deux univers ;<br />
5) des SCOT sans ambition stratégique <strong>et</strong> sans intégration de l’approche <strong>prospective</strong>.<br />
Selon le cas, la <strong>prospective</strong> comme outil d’aide à la décision <strong>et</strong> d’intelligence territoriale n’a<br />
pas la même utilité <strong>et</strong> est instrumentalisée de façons différentes.<br />
a) L’approche 1 est basée sur un exercice de <strong>prospective</strong> territoriale qui débouche sur un<br />
proj<strong>et</strong> de territoire <strong>et</strong> sur un processus de <strong>planification</strong> de l’aménagement de l’espace<br />
raisonné, discuté, approprié.<br />
<strong>La</strong> <strong>prospective</strong> prend une place importante dans les deux modes d’expression majeurs,<br />
exploratoire <strong>et</strong> normatif : définir un futur souhaitable parmi différentes trajectoires de futurs<br />
possibles, m<strong>et</strong>tre c<strong>et</strong>te vision en débat, en déduire des orientations stratégiques finalisées<br />
dans le temps <strong>et</strong> l’espace, engager des exercices de <strong>prospective</strong> tournée vers la faisabilité des<br />
intentions, portant sur des échéances intermédiaires <strong>et</strong> d’approfondissement de certains<br />
enjeux ou thèmes, traduire le tout sous la forme d’un proj<strong>et</strong> d’ensemble puis de PADD (là où<br />
la distinction est maintenue). Le spatial relève à la fois d’une logique inductive <strong>et</strong> déductive.<br />
<strong>La</strong> pensée <strong>prospective</strong> précède non seulement l’action, mais également le discours <strong>et</strong> les<br />
représentations du possible. Elle est systémique <strong>et</strong> reconnaît les logiques de la complexité ;<br />
elle est cognitive, s’appuie sur les trajectoires de longues durées des territoires <strong>et</strong> resitue à<br />
leur juste place le discours des acteurs. <strong>La</strong> connaissance des enjeux locaux nourrit le débat<br />
prospectif sans obscurcir les questions de fond. Le débat public n’est pas limité au partage<br />
des résultats de l’activité d’étude, mais est intégré au processus d’élaboration même allant<br />
de la réflexion à l’action <strong>et</strong> de l’action à la réflexion. Les « boucles » (stratégie, décision,<br />
mise en œuvre) sont relativement courtes, de façon à pouvoir modifier le cours de choses sur<br />
le mode « in itinere » ou « chemin faisant ». L’évaluation des actions menées antérieurement<br />
trouve sa place dans un processus réactif fortement affiché par les acteurs. L’ensemble des<br />
outils de l’action stratégique <strong>et</strong> les structures de mise en œuvre des politiques sont mobilisés.<br />
L’ingénierie est intégrée à la démarche ascendante <strong>et</strong> descendante. Un état d’esprit général<br />
demeure à cultiver : il n’y pas d’un côté ceux qui « pensent » <strong>et</strong> de l’autre, ceux qui<br />
« agissent », mais une interpénétration de tous les modes <strong>et</strong> outils de la pensée-action, de la<br />
pensée dans l’action.<br />
b) Pour le type 2, les méthodes de <strong>planification</strong> spatiale (SCOT) <strong>et</strong> de proj<strong>et</strong><br />
d’aménagement du territoire prévalent, à l’instar des schémas directeurs des années 90.<br />
L’explicitation <strong>et</strong> la mise en débat d’une vision lointaine <strong>et</strong> globale ne sont pas reconnues<br />
comme indispensables. Les innovations vont plutôt consister à davantage de rigueur<br />
systémique, à privilégier les réflexions sur le long terme par rapport aux enjeux immédiats, à<br />
rechercher une démarche bien construite, décloisonnée avec des ouvertures participatives,<br />
sans pour autant faire de la participation un point central.<br />
L’ensemble relève davantage de l’analyse prévisionnelle. <strong>La</strong> <strong>prospective</strong> s’effectue plutôt<br />
sous forme d’approfondissement ou d’éclairage thématique sans couvrir tous les champs. Il<br />
s’agit plutôt d’une <strong>prospective</strong> d’experts intégrée aux études d’ensemble, d’études sur le<br />
futur plus que d’un exercice de <strong>prospective</strong> territoriale. Les « techniciens » <strong>et</strong> aménageurs