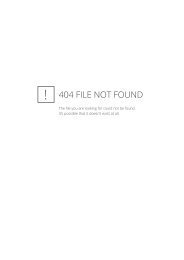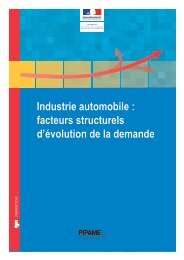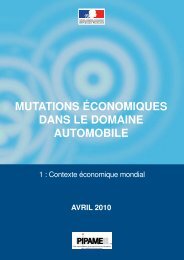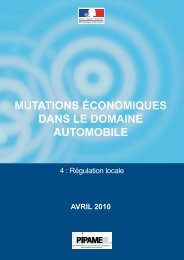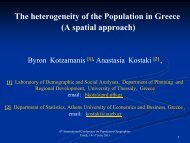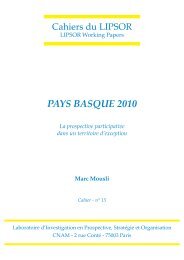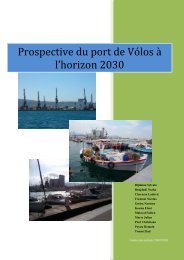prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
58 TRAVAUX ET RECHERCHES DE<br />
PROSPECTIVE – N°24<br />
L’indépendance du groupe vis-à-vis des institutions perm<strong>et</strong> une liberté totale d’expression <strong>et</strong><br />
de choix des scénarios. Elle perm<strong>et</strong> de contourner des conceptions idéologiques susceptibles<br />
de bloquer toute capacité de réflexion collective, notamment par une approche par les<br />
contextes, l’exogène du territoire (la conjoncture ou la géopolitique) <strong>et</strong> par les logiques<br />
endogènes (les trajectoires des possibles en fonction de l’histoire <strong>et</strong> des tropismes du<br />
territoire).<br />
Elle perm<strong>et</strong> aussi l’expression de la logique propre au groupe <strong>et</strong> à son appartenance<br />
culturelle. Même validée par un collectif plus large, la réflexion proposée dans ce cadre est<br />
par nature limitée à l’expression d’un point de vue, celui d’une composante plus ou moins<br />
homogène, plus ou moins multiculturelle, de la société civile, avec de possibles décalages ou<br />
oppositions avec les points de vue d’autres composantes. Même libérée des contraintes liées<br />
aux postures institutionnelles, elle n’échappe pas à certaines formes de subjectivité.<br />
Est évité également le piège du « concr<strong>et</strong> » <strong>et</strong> du court terme qui enferme <strong>et</strong> réduit la portée<br />
de l’analyse <strong>et</strong> donc de « l’ambition ». L’évolution du territoire à long terme est intégrée de<br />
façon naturelle autour de l’idée de savoir où l’on va, ce que l’on veut, ce que l’on souhaite,<br />
ce que l’on rêve pour soi <strong>et</strong> pour ses enfants. Il y a une dimension humaine, très différente<br />
de l’approche fonctionnaliste classique, qui perm<strong>et</strong> de donner une assise <strong>et</strong> un fondement à<br />
l’action.<br />
En contrepartie, le fait de s’en tenir à des orientations générales sans déboucher sur des<br />
proj<strong>et</strong>s concr<strong>et</strong>s ne perm<strong>et</strong> pas d’en mesurer les implications opérationnelles en termes de<br />
programmes d’actions <strong>et</strong> de choix de priorités, <strong>et</strong> par conséquent, de coût, de faisabilité ou<br />
d’acceptabilité par la société locale. Il ne perm<strong>et</strong> pas de faire émerger des divergences ou des<br />
contradictions possibles avec les logiques <strong>et</strong> les éventuels proj<strong>et</strong>s d’autres acteurs.<br />
L’absence de liens avec les pouvoirs publics <strong>et</strong> les lieux de la décision publique, si elle<br />
donne plus de liberté, constitue la limite de la démarche.<br />
Elle ne peut intégrer la dimension d’une stratégie appuyée sur l’action publique. C<strong>et</strong>te<br />
dimension est différée dans une après-démarche fondée sur une étape intermédiaire<br />
d’appropriation politique <strong>et</strong> technique de la démarche <strong>et</strong> de ses résultats <strong>et</strong> propositions. <strong>La</strong><br />
communication avec les pouvoirs politiques, institutionnels <strong>et</strong> techniques <strong>et</strong> un éventuel<br />
r<strong>et</strong>entissement de la réussite de la démarche deviennent déterminants pour pousser les<br />
autorités à la prendre au sérieux <strong>et</strong> induire sa prise en compte politico-administrative.<br />
<strong>La</strong> démarche n’a pas pu faire l’obj<strong>et</strong> d’une diffusion institutionnelle, mais a été présentée par<br />
les membres du groupe dans différentes instances politiques <strong>et</strong> administratives. <strong>La</strong> question<br />
qui reste ouverte est celle de la manière dont les pouvoirs publics, <strong>et</strong> plus particulièrement<br />
les pouvoirs publics locaux, se saisiront de c<strong>et</strong>te initiative. Elle peut être élargie à celle du<br />
rapport d’une <strong>prospective</strong> d’initiative citoyenne à la construction du proj<strong>et</strong> de territoire.<br />
N’étant pas menée de façon collective par l’ensemble des acteurs du proj<strong>et</strong> dans le cadre<br />
institutionnel de sa construction, elle ne peut être le support de la constitution d’une vision<br />
de l’avenir partagée. Elle ne peut pas non plus être considérée dans l’optique de l’exercice<br />
de l’intelligence collective <strong>et</strong> de l’acquisition d’une culture commune préalable ou<br />
concomitante à c<strong>et</strong>te constitution. Elle peut par contre alimenter la réflexion des différents<br />
acteurs du proj<strong>et</strong> <strong>et</strong> constituer une incitation à penser autrement sa construction :