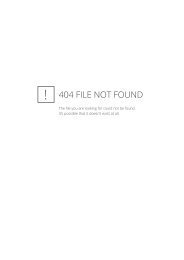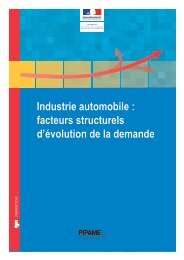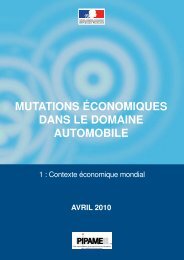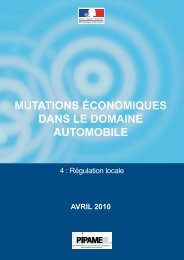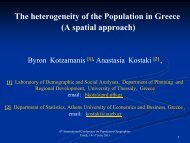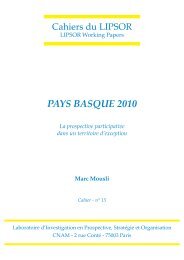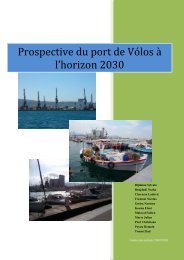prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PROSPECTIVE ET PLANIFICATION TERRITORIALES<br />
123<br />
e) Il n’y a pas séparation tranchée entre la phase diagnostic <strong>et</strong> la phase <strong>prospective</strong>.<br />
Un diagnostic territorial se construit <strong>et</strong> s’enrichit progressivement. A la limite, il pourrait<br />
s’agir d’un travail en continu, sous forme d’une accumulation de connaissances comme un<br />
capital que l’on perfectionne dans la durée. Le plus souvent, les exemples présentés le<br />
montrent, les groupes de travail chargés du diagnostic ne se cantonnent pas strictement à<br />
l’analyse de l’existant <strong>et</strong> du passé. Le diagnostic devrait s’accompagner de réflexions sur les<br />
tendances, sur les suj<strong>et</strong>s du futur, sur les ruptures, de travaux sur les signaux faibles ou les<br />
phénomènes émergeants, sur les mutations de l’environnement. Il doit faire prendre<br />
conscience des transformations déjà à l’œuvre mais non encore perçues par l’ensemble des<br />
acteurs.<br />
Les phases diagnostic <strong>et</strong> <strong>prospective</strong> sont autant que possible itératives. Le travail de<br />
<strong>prospective</strong>, qui vise à anticiper les changements en changeant le regard que l’on porte sur la<br />
réalité, a par la force des choses des eff<strong>et</strong>s sur sa connaissance. Le questionnement <strong>et</strong><br />
l’analyse de l’existant ne peuvent être tout à fait linéaires, mais sont le résultat d’un allerr<strong>et</strong>our<br />
entre la connaissance, les représentations <strong>et</strong> le r<strong>et</strong>our à la connaissance.<br />
L’ensemble des connaissances mobilisés par le diagnostic a pour objectif de se former une<br />
vision globale de la réalité à un moment donné susceptible de déboucher sur des<br />
anticipations vraisemblables. Or c<strong>et</strong>te mobilisation, dans le champ du local aux différentes<br />
échelles, a du mal à se faire. Les territoires comme acteurs n’ont pas l’habitude d’anticiper,<br />
plusieurs raisons sont fréquemment mises en avant :<br />
- <strong>La</strong> plupart des acteurs ont des horizons réduits à court <strong>et</strong> moyen terme, ils<br />
survalorisent le présent.<br />
- Ils survalorisent les contraintes d’inertie des systèmes internes <strong>et</strong> externes dont<br />
dépendent les territoires.<br />
- Ils survalorisent les approches <strong>et</strong> les représentations sectorielles.<br />
- Les disciplines des sciences sociales, géographiques, économiques <strong>et</strong> politiques sont<br />
encore largement cloisonnées.<br />
Le socle des connaissances <strong>et</strong> des données résulte d’un dosage délicat <strong>et</strong> instable entre le<br />
savoir apporté par les experts <strong>et</strong> les organismes chargés des études <strong>et</strong> des enquêtes <strong>et</strong> une<br />
connaissance « agissante » (liée au besoin d’agir) mobilisée localement. Un déséquilibre<br />
introduit par un organisme d’étude trop directif risque de favoriser la passivité des acteurs <strong>et</strong>,<br />
en fin de compte, une faible capacité d’appropriation <strong>et</strong> de construction collective d’une<br />
vision future. A l’inverse, une participation sans études étayées, avec un « support cognitif »<br />
faible, implique un risque de rester superficiel <strong>et</strong> cloisonné <strong>et</strong> de construire des scénarios sur<br />
une base de connaissance de la réalité faible <strong>et</strong> fragile, à la limite sur du « sable ».<br />
Pour réunir les conditions d’un équilibre, il n’y a pas de rec<strong>et</strong>tes mais deux principes<br />
peuvent être mis en avant :<br />
- <strong>La</strong> qualité du pilotage de la démarche (cf infra).<br />
- <strong>La</strong> médiatisation d’un prospectiviste, conseil auprès du « pilote » pour instiller la<br />
méthode nécessaire pour concilier les deux versants, intervention des experts <strong>et</strong><br />
participation active, dans la perspective de m<strong>et</strong>tre en tension questionnementdiagnostic-projection-définition<br />
d’une vision <strong>et</strong> d’une stratégie d’action.