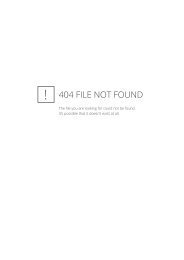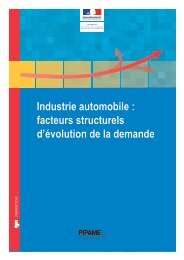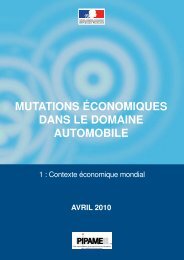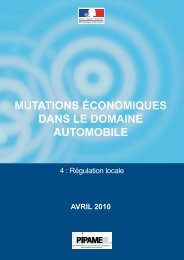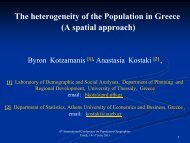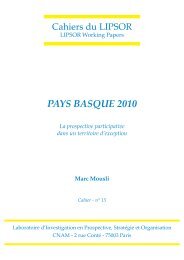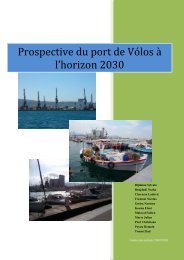prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PROSPECTIVE ET PLANIFICATION TERRITORIALES<br />
89<br />
possibles, sociaux, culturels, environnementaux, économiques, <strong>et</strong> inversement les eff<strong>et</strong>s des<br />
pratiques (sociétales, culturelles, économiques…) sur l’organisation spatiale. <strong>La</strong> difficulté<br />
majeure est l’articulation systémique entre les enjeux inclus dans ces grands domaines aux<br />
différentes échelles. Nous y reviendrons plus loin.<br />
Compte tenu des traditions de la <strong>planification</strong> urbaine, il y a une p<strong>et</strong>ite « révolution<br />
culturelle » à opérer pour resituer le proj<strong>et</strong> spatial dans ses interactions avec les proj<strong>et</strong>s<br />
sociaux, économiques, environnementaux, culturels…, interactions actuelles <strong>et</strong> interactions<br />
dans les évolutions futures, un apprentissage de l’élaboration globale <strong>et</strong> systémique du proj<strong>et</strong><br />
territorial.<br />
Dans le cadre d’une <strong>planification</strong> inter ou supracommunale, le métier d’aménageur est<br />
replacé à un rôle plus modeste. Le métier de « développeur-prospectivisiste-animateur » du<br />
champ sociétal devient, dans c<strong>et</strong>te logique, de plus en plus essentiel. Il s’agit d’un métier qui<br />
n’existe pas réellement <strong>et</strong> qui est largement à inventer. S’agit-il d’une version « moderne »<br />
du métier de planificateur ?<br />
c) Dans ces conditions une <strong>planification</strong> urbaine <strong>et</strong> spatiale a-t-elle encore un sens<br />
aujourd’hui en France ?<br />
De moins en moins, au sens où une <strong>planification</strong> spatiale reste vivace en Allemagne ou aux<br />
Pays-Bas, une <strong>planification</strong> plutôt orientée top down, juridiquement articulée entre les<br />
différents niveaux territoriaux, du national au local en passant par différentes strates supra <strong>et</strong><br />
intercommunales. Notamment l’absence de tout lien entre SRADT <strong>et</strong> SCOT nous éloigne de<br />
ce modèle pour privilégier davantage une formule bottom up fondée sur le proj<strong>et</strong> local. Un<br />
proj<strong>et</strong> fondé sur un certain nombre de principes (dont le développement durable), <strong>et</strong> qui<br />
serait « corrigé » par certaines modalités d’action publique dont l’intervention des services<br />
déconcentrés de l’Etat en charge de construire un « point de vue » constitué à partir d’une<br />
territorialisation des positions, des politiques <strong>et</strong> des proj<strong>et</strong>s de l’Etat <strong>et</strong> des régions, conçus<br />
aux échelles supérieures au territoire de référence.<br />
Comment dans ces conditions arriver à réhabiliter <strong>et</strong> à rem<strong>et</strong>tre au goût du jour la notion de<br />
<strong>planification</strong> stratégique notamment sous la forme des SCOT fondés sur un « proj<strong>et</strong><br />
d’aménagement <strong>et</strong> de développement durable » ?<br />
• <strong>La</strong> question fait l’obj<strong>et</strong> de controverses.<br />
Le SCOT semble écartelé entre deux tendances délicates à doser :<br />
- la conception d’une organisation spatiale à vingt ans sans se focaliser sur la notion<br />
d’occupation du sol chère aux schémas directeurs, impliquant des contraintes que<br />
certains dénoncent d’avance comme des rigidités inacceptables,<br />
- la fonction « minimaliste » de cohérence <strong>et</strong> de coordination, « le SCOT chef de file<br />
des divers documents sectoriels 74 », considérée par d’autres comme une finalité<br />
n<strong>et</strong>tement insuffisante 75 .<br />
74 « Le Schéma de cohérence territoriale, contenu <strong>et</strong> méthodes », Fédération nationale des agences<br />
d’urbanisme, édition DGUHC-Certu, juin 2003.<br />
75 Notamment les articles d’Yves Janvier <strong>et</strong> d’Alain Bourdin dans l’ouvrage collectif <strong>La</strong> Ville éclatée (N. May, P. Veltz, J.<br />
<strong>La</strong>ndrieu, T. Spector), éditions de l’Aube, 1998, Actes du séminaire organisé par la Mission <strong>prospective</strong> de la DAEI <strong>et</strong> par<br />
le Centre de Prospective <strong>et</strong> de Veille Scientifique de la D.R.A.S.T.