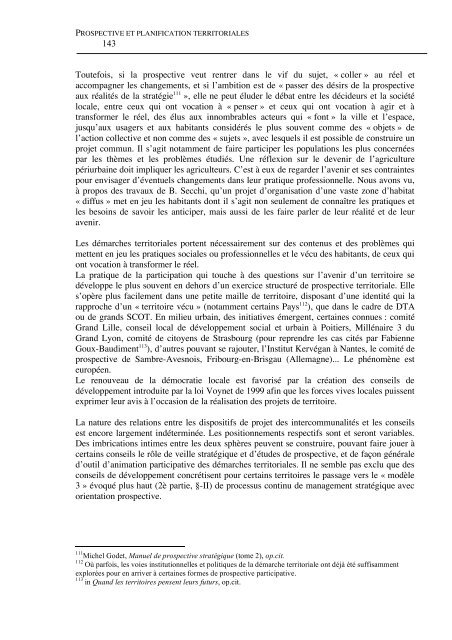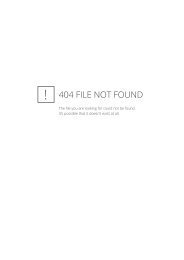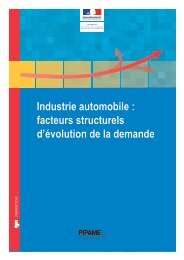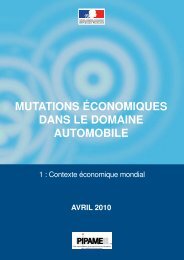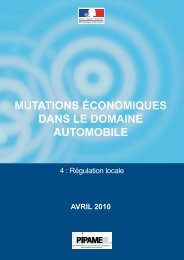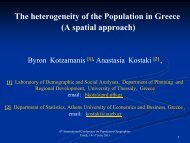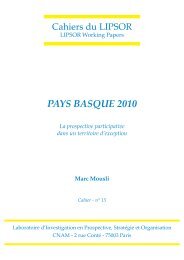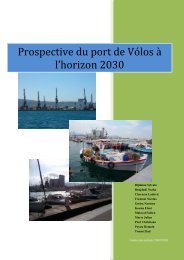prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PROSPECTIVE ET PLANIFICATION TERRITORIALES<br />
143<br />
Toutefois, si la <strong>prospective</strong> veut rentrer dans le vif du suj<strong>et</strong>, « coller » au réel <strong>et</strong><br />
accompagner les changements, <strong>et</strong> si l’ambition est de « passer des désirs de la <strong>prospective</strong><br />
aux réalités de la stratégie 111 », elle ne peut éluder le débat entre les décideurs <strong>et</strong> la société<br />
locale, entre ceux qui ont vocation à « penser » <strong>et</strong> ceux qui ont vocation à agir <strong>et</strong> à<br />
transformer le réel, des élus aux innombrables acteurs qui « font » la ville <strong>et</strong> l’espace,<br />
jusqu’aux usagers <strong>et</strong> aux habitants considérés le plus souvent comme des « obj<strong>et</strong>s » de<br />
l’action collective <strong>et</strong> non comme des « suj<strong>et</strong>s », avec lesquels il est possible de construire un<br />
proj<strong>et</strong> commun. Il s’agit notamment de faire participer les populations les plus concernées<br />
par les thèmes <strong>et</strong> les problèmes étudiés. Une réflexion sur le devenir de l’agriculture<br />
périurbaine doit impliquer les agriculteurs. C’est à eux de regarder l’avenir <strong>et</strong> ses contraintes<br />
pour envisager d’éventuels changements dans leur pratique professionnelle. Nous avons vu,<br />
à propos des travaux de B. Secchi, qu’un proj<strong>et</strong> d’organisation d’une vaste zone d’habitat<br />
« diffus » m<strong>et</strong> en jeu les habitants dont il s’agit non seulement de connaître les pratiques <strong>et</strong><br />
les besoins de savoir les anticiper, mais aussi de les faire parler de leur réalité <strong>et</strong> de leur<br />
avenir.<br />
Les démarches <strong>territoriales</strong> portent nécessairement sur des contenus <strong>et</strong> des problèmes qui<br />
m<strong>et</strong>tent en jeu les pratiques sociales ou professionnelles <strong>et</strong> le vécu des habitants, de ceux qui<br />
ont vocation à transformer le réel.<br />
<strong>La</strong> pratique de la participation qui touche à des questions sur l’avenir d’un territoire se<br />
développe le plus souvent en dehors d’un exercice structuré de <strong>prospective</strong> territoriale. Elle<br />
s’opère plus facilement dans une p<strong>et</strong>ite maille de territoire, disposant d’une identité qui la<br />
rapproche d’un « territoire vécu » (notamment certains Pays 112 ), que dans le cadre de DTA<br />
ou de grands SCOT. En milieu urbain, des initiatives émergent, certaines connues : comité<br />
Grand Lille, conseil local de développement social <strong>et</strong> urbain à Poitiers, Millénaire 3 du<br />
Grand Lyon, comité de citoyens de Strasbourg (pour reprendre les cas cités par Fabienne<br />
Goux-Baudiment 113 ), d’autres pouvant se rajouter, l’Institut Kervégan à Nantes, le comité de<br />
<strong>prospective</strong> de Sambre-Avesnois, Fribourg-en-Brisgau (Allemagne)... Le phénomène est<br />
européen.<br />
Le renouveau de la démocratie locale est favorisé par la création des conseils de<br />
développement introduite par la loi Voyn<strong>et</strong> de 1999 afin que les forces vives locales puissent<br />
exprimer leur avis à l’occasion de la réalisation des proj<strong>et</strong>s de territoire.<br />
<strong>La</strong> nature des relations entre les dispositifs de proj<strong>et</strong> des intercommunalités <strong>et</strong> les conseils<br />
est encore largement indéterminée. Les positionnements respectifs sont <strong>et</strong> seront variables.<br />
Des imbrications intimes entre les deux sphères peuvent se construire, pouvant faire jouer à<br />
certains conseils le rôle de veille stratégique <strong>et</strong> d’études de <strong>prospective</strong>, <strong>et</strong> de façon générale<br />
d’outil d’animation participative des démarches <strong>territoriales</strong>. Il ne semble pas exclu que des<br />
conseils de développement concrétisent pour certains territoires le passage vers le « modèle<br />
3 » évoqué plus haut (2è partie, §-II) de processus continu de management stratégique avec<br />
orientation <strong>prospective</strong>.<br />
111 Michel God<strong>et</strong>, Manuel de <strong>prospective</strong> stratégique (tome 2), op.cit.<br />
112 Où parfois, les voies institutionnelles <strong>et</strong> politiques de la démarche territoriale ont déjà été suffisamment<br />
explorées pour en arriver à certaines formes de <strong>prospective</strong> participative.<br />
113 in Quand les territoires pensent leurs futurs, op.cit.