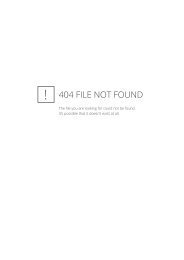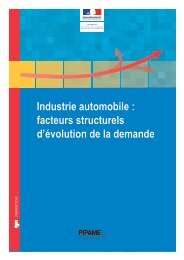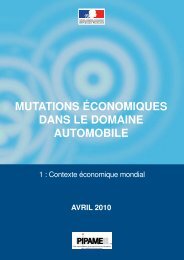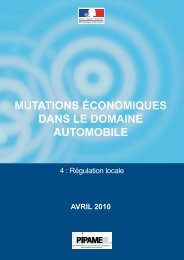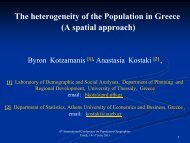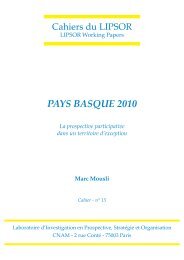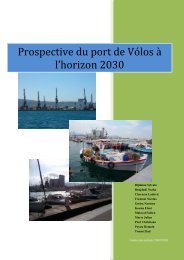prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PROSPECTIVE ET PLANIFICATION TERRITORIALES<br />
73<br />
C<strong>et</strong>te déclaration insiste sur la spécificité d’une situation politiquement caractérisée, en<br />
l’occurrence une « position à la nantaise » : un cap fixé <strong>et</strong> une stratégie reconnue <strong>et</strong><br />
durablement éprouvée mais non nécessairement explicite ni sous la forme d’un proj<strong>et</strong> de<br />
territoire (à l’état d’intention), ni par le biais d’une tradition de <strong>planification</strong> spatiale globale<br />
(il n’y a pas de schéma directeur à Nantes), perm<strong>et</strong>tant d’élaborer <strong>et</strong> d’ajuster les politiques,<br />
les proj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> les modes de régulation des interventions locales <strong>et</strong> des modalités de<br />
coopération avec les échelons « supérieurs » de la région, de l’Etat…<br />
A Lille, Marseille, Grenoble ou Rennes, les mêmes données sont radicalement différentes.<br />
B) Des représentations de l’avenir portées par le « proj<strong>et</strong> urbain »<br />
a) Le syndicat mixte de la Plaine Saint-Denis<br />
Le rapprochement avec une approche par concours d’idées est fructueux.<br />
En 1995, le syndicat mixte groupant les collectivités de la Plaine-Saint-Denis convie<br />
quelques urbanistes, architectes <strong>et</strong> paysagistes, à dessiner, à partir d’un tronc commun de<br />
diagnostic, des images futures d’un territoire réaménagé. Chaque image peut figurer un futur<br />
possible construit par un créateur qui s’appuie, d’une part, sur l’existant, le tissu urbain <strong>et</strong><br />
sur son interprétation de la « force » de l’existant comme support du futur <strong>et</strong>, d’autre part,<br />
sur l’intime certitude que la structure urbaine proposée perm<strong>et</strong>tra d’absorber les principales<br />
évolutions possibles des modes de vie en ville. Les images perm<strong>et</strong>tent de faire rêver <strong>et</strong> de<br />
faciliter les choix. L’originalité de la décision résultant de ce concours a été non pas de<br />
choisir une image contre une autre mais d’engager un processus où les compétiteurs se sont<br />
ensuite associés pour concevoir collectivement un même proj<strong>et</strong> urbain. Il en est résulté le<br />
GIE HIPODAMOS 93 qui a élaboré le proj<strong>et</strong> de référence à l’action de reconversion de la<br />
Plaine-Saint-Denis, élaboration progressive d’options longuement <strong>et</strong> largement débattues.<br />
Le proj<strong>et</strong> urbain de la Plaine-Saint-Denis propose une vision de la ville de l’avenir, un pôle<br />
urbain <strong>et</strong> économique de qualité (dans le contexte de la Seine-Saint-Denis), rayonnant pour<br />
le nord parisien <strong>et</strong> pour la « Plaine-de-France ». Le processus de proj<strong>et</strong> urbain contribue à<br />
rendre c<strong>et</strong>te vision stratégique.<br />
Il y a des rapprochements à faire avec une <strong>prospective</strong> « normative », mais, en termes de<br />
méthode, le processus de proj<strong>et</strong> urbain n’est pas un exercice de <strong>prospective</strong> territoriale. Son<br />
propos n’est pas d’explorer le futur puis de construire, le plus collectivement possible, un<br />
futur souhaitable support d’une stratégie d’action mais de proposer l’organisation spatiale<br />
d’une partie de la ville à long terme sous la forme d’une structure ou d’une forme maillée<br />
bien reliée au reste de la ville qui se constitue progressivement <strong>et</strong> qui évolue en fonctions<br />
des programmes, du marché, des évolutions sociétales, des choix politiques, de l’action<br />
publique,…<br />
Le proj<strong>et</strong> urbain insiste sur les rapports entre la vision de la ville future qui est d’abord celle<br />
du proj<strong>et</strong>eur-concepteur, <strong>et</strong> les contraintes physiques <strong>et</strong> sociales de la transformation de la<br />
ville actuelle. Le proj<strong>et</strong>eur <strong>et</strong> son maître d’ouvrage <strong>et</strong> les élus impliqués ne se préoccupent<br />
pas des représentations de futurs possibles mais se soucient d’encadrer le prévisible <strong>et</strong> de<br />
piéger l’imprévisible par une structure adaptable aux à-coups de l’évolution. <strong>La</strong> question-clé<br />
d’un proj<strong>et</strong> de référence pour l’aménagement est sa flexibilité, son degré d’adaptabilité, c’est<br />
le pilotage du proj<strong>et</strong> qui doit dégager, au vu des évolutions, les marges d’adaptabilité.