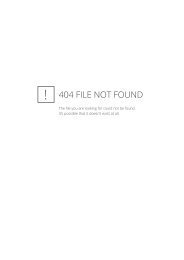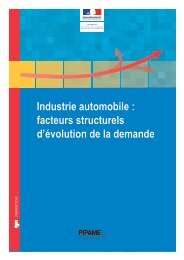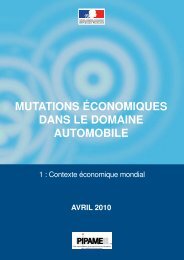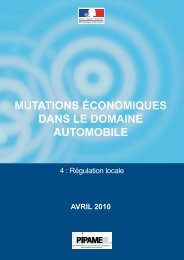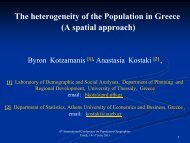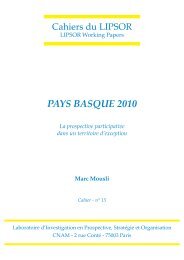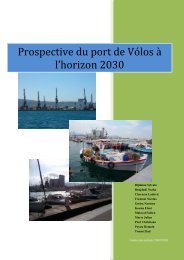prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PROSPECTIVE ET PLANIFICATION TERRITORIALES<br />
85<br />
• Les territoires affrontent les logiques de l’incertitude du contexte.<br />
• Les territoires sont à la recherche d’attractivité <strong>et</strong> de désirabilité territoriale :<br />
le sociétal <strong>et</strong> la qualité de vie deviennent des facteurs premiers <strong>et</strong><br />
l’économique de plus en plus un facteur induit par le sociétal.<br />
4- Planification spatiale, <strong>planification</strong> stratégique<br />
a) Une tradition de <strong>planification</strong> spatiale <strong>et</strong> prévisionnelle<br />
• Il y a une tradition ancienne de <strong>planification</strong> spatiale en France. C<strong>et</strong> univers de la<br />
<strong>planification</strong> a constitué la toile de fond des « Trente Glorieuses » <strong>et</strong> a accompagné, avec<br />
un Etat fort, le passage de la ruralité à la ville tertiaire. <strong>La</strong> <strong>planification</strong> avait pour<br />
principale finalité d’orienter le développement, de maîtriser ses eff<strong>et</strong>s <strong>et</strong> d’optimiser les<br />
politiques d’aménagement <strong>et</strong> d’équipement dans un contexte de relative croissance. Il<br />
s’agit d’une culture de la prévision, forte de l’idée que les conséquences d’un<br />
aménagement du territoire volontaire sont positives pour le futur du territoire <strong>et</strong> pour la<br />
société locale. « <strong>La</strong> <strong>planification</strong> est un futur désiré entrevu à travers les moyens perçus<br />
pour y parvenir 68 ».<br />
A la base, il y a la certitude pour les acteurs locaux que le cap est tracé <strong>et</strong> que la navigation<br />
va procéder par une série d’adaptations au coup par coup pour atteindre l’horizon final par<br />
phases successives de réalisation des opérations en fonction de l’évolution du contexte. Le<br />
raisonnement « toutes choses égales par ailleurs » constitue le postulat implicite du substrat<br />
prévisionnel de la <strong>planification</strong> stratégique. Le système contextuel est invariant, il est<br />
possible d’extrapoler les évolutions des paramètres de l’obj<strong>et</strong> à traiter sur l’horizon du futur,<br />
à partir du comportement des variables par rapport à la période antérieure.<br />
De nombreux SDAU des années soixante-dix ont proj<strong>et</strong>é à l’horizon 2000 les courbes de<br />
croissance démographiques <strong>et</strong> économiques des années cinquante <strong>et</strong> soixante, sans se poser<br />
la question d’un éventuel changement de chemin des modes de croissance. L’analyse<br />
prévisionnelle est pertinente à système invariant. Elle ne l’est plus lorsque les bases du<br />
système changent ou sont en mutation.<br />
VII.<br />
Cependant, c<strong>et</strong>te tradition planificatrice s’est essoufflée. <strong>La</strong> <strong>planification</strong> urbaine ou<br />
spatiale, du moins celle qui « disait naguère ce que l’avenir vous réservait 69 », est<br />
considérée inapte à saisir les problèmes de fond de la société actuelle <strong>et</strong> à prendre en<br />
compte la montée en puissance des questions de société dans le champ de la réflexion<br />
stratégique des acteurs.<br />
L’un des fondements implicites de la <strong>planification</strong> appliquée à l’aménagement, c’est qu’il<br />
est possible de changer la société civile, de l’adapter aux conditions de la croissance <strong>et</strong> de<br />
l’ouverture au monde par la transformation de l’espace considéré comme un outil ou un<br />
levier du développement. L’espace devait accompagner les changements, voire les<br />
préfigurer ou les anticiper. C<strong>et</strong>te hypothèse n’était pas fausse dans le contexte de l’époque,<br />
<strong>et</strong> elle a permis à la France de rattraper en un quart de siècle les immenses r<strong>et</strong>ards accumulés<br />
68 Jean-Pierre Boutin<strong>et</strong>, Anthropologie du proj<strong>et</strong>, PUF, p. 264<br />
69 Franck Scherrer, in Repenser le territoire, un dictionnaire critique, Serge Wachter, directeur, édition de<br />
l’Aube-D.A.T.A.R, 2000, 287 pages, p. 63.