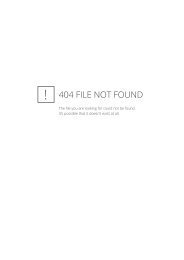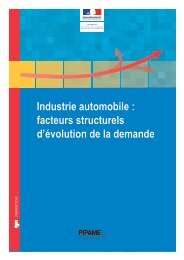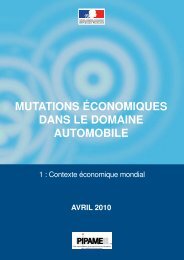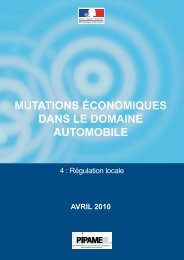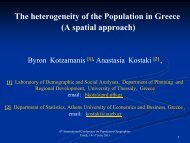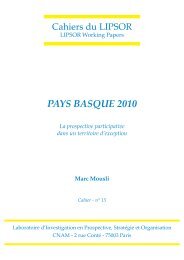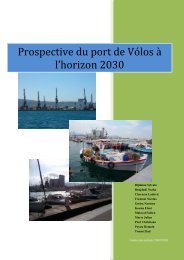prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PROSPECTIVE ET PLANIFICATION TERRITORIALES<br />
97<br />
• Les politiques d’aménagement du territoire, plutôt du ressort régional, <strong>et</strong> les<br />
politiques urbaines, de la compétence des villes ou des intercommunalités, forment<br />
des ensembles disjoints. Les premières, plus globales, sont plus ouvertes aux<br />
approches <strong>prospective</strong>s que les secondes perçues souvent comme plus spatiales <strong>et</strong><br />
plus fonctionnelles.<br />
• <strong>La</strong> nature des enjeux a davantage incité les régions à se placer, politiquement <strong>et</strong><br />
économiquement, sur la scène européenne <strong>et</strong> nationale, impliquant une motivation<br />
plus immédiate pour la <strong>prospective</strong>.<br />
• Les régions sont anciennes avec un système politico-administratif bien en place<br />
alors que les intercommunalités naissantes ou récemment restructurées ont besoin<br />
de temps pour s’installer <strong>et</strong> trouver une légitimité, différant du même coup<br />
l’engagement de certaines réflexions de « fond ».<br />
• Les frottements de pouvoirs entre les échelons communaux qui restent encore une<br />
forte référence pour l’urbanisme, <strong>et</strong> intercommunaux, ont pu paralyser certains<br />
débats <strong>et</strong> certaines démarches.<br />
• Dans ce contexte de « maturation » des intercommunalités, sur fond de poursuite de<br />
la décentralisation, les démarches de proj<strong>et</strong> <strong>et</strong> la <strong>prospective</strong> peuvent être perçues<br />
non comme un facteur de régulation mais comme un exercice de nature à troubler le<br />
jeu institutionnel. Par rapport à de telles situations, le SCOT vient trop tôt.<br />
1- <strong>La</strong> nature des enjeux <strong>et</strong> des politiques poursuivies<br />
Les territoires sont inégaux par rapport à leur capacité d’élaborer une « stratégie ». <strong>La</strong> nature<br />
des enjeux sera déterminante. Elle induit des larges disparités entre les territoires sur un axe<br />
qui les situe, d’une part entre les métropoles <strong>et</strong> agglomérations importantes, territoires levier<br />
du développement économique avec une large autonomie <strong>et</strong> capacité de rayonnement, <strong>et</strong>,<br />
d’autre part, les territoires sous influence, assuj<strong>et</strong>tis. Le degré d’autonomie des stratégies est<br />
relatif. Les interdépendances, les formes de dialogue, de coopération <strong>et</strong> d’alliance, seront<br />
une question majeure.<br />
Certaines logiques se dessinent <strong>et</strong> seront appelées à se recomposer progressivement : les<br />
métropoles <strong>et</strong> grandes agglomérations vont chercher à affermir leur pouvoir, à développer<br />
des coopérations européennes ou mondiales avec leurs homologues <strong>et</strong> à peser directement<br />
dans le débat de l’aménagement du territoire européen, les agglomérations dépendantes<br />
chercheront des soutiens auprès des régions <strong>et</strong> symétriquement les pays ruraux auprès des<br />
départements.<br />
<strong>La</strong> concurrence entre les territoires peut prendre des formes de plus en plus aiguës. De<br />
nouvelles formes d’asymétrie voient le jour, des territoires qui occupent des positions<br />
stratégiques sans rapport avec leur taille : des p<strong>et</strong>its pôles réussiront à tirer leur « épingle du<br />
jeu » alors que de grandes agglomérations risquent de perdre en capacité d’influence, parce<br />
qu’elles n’auront pas été capables de se doter d’un proj<strong>et</strong> stratégique global (<strong>et</strong> pas<br />
seulement urbanistique), <strong>et</strong> parce que leurs acteurs n’auront pas « vu » que leur rang n’est<br />
pas assuré pour toujours dans les hiérarchies <strong>territoriales</strong> implicites. Un « rang » se mérite,<br />
ce qui redonne signification à la notion de volonté, d’ambition <strong>et</strong> de pertinence du proj<strong>et</strong>.