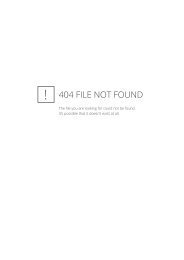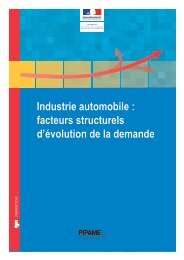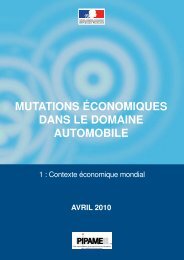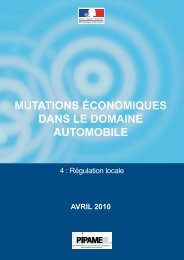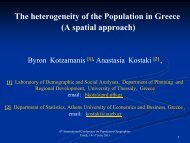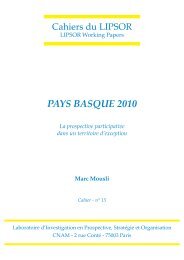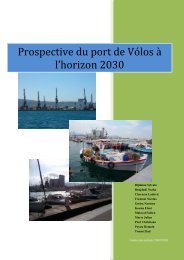prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
192 TRAVAUX ET RECHERCHES DE<br />
PROSPECTIVE – N°24<br />
opportunité nouvelles, de créer des marges de manœuvre, de perm<strong>et</strong>tre aux hommes<br />
comme aux collectivités de se donner une respiration nouvelle face aux contraintes de<br />
la situation actuelle. Le futur est donc source de liberté, mais cela implique une<br />
volonté pour faire passer les intentions ou les visions dans la réalité. Le futur dès lors<br />
qu’il est « maîtrisé », est une source de pouvoir considérable comme le rappelle<br />
Hugues de Jouvenel. En tout état de cause, dans une société tournée vers le futur, vers<br />
l’action en vue d’améliorer le présent (collectif ou individuel), ne pas se préoccuper<br />
du futur présente le risque de se voir marginalisé ou dépassé par tous ceux qui auront<br />
intégré la question du futur dans leur stratégie d’action au quotidien. Ainsi la question<br />
du futur devient un enjeu majeur qu’il est préférable de « penser ». Plus le<br />
futur paraît incertain, plus c<strong>et</strong>te situation doit inciter à se poser des questions <strong>et</strong> non à<br />
se résigner à la conduite à vue des affaires sans vision plus lointaine. Les places ou les<br />
positions de chacun dans le futur ne dépendent pas uniquement des jeux relationnels<br />
actuels, mais des jeux de rôle <strong>et</strong> d’acteurs proj<strong>et</strong>és sur une trame temporelle future. Il<br />
est question de « société de l’anticipation » <strong>et</strong> de « goût de l’avenir». L’activité de<br />
<strong>prospective</strong> dont l’obj<strong>et</strong> est de réfléchir <strong>et</strong> de penser le ou les futurs est ainsi amenée à<br />
prendre une place croissante dans les processus sociétaux actuels.<br />
• MANAGEMENT TERRITORIAL : souvent qualifié de « stratégique ». Concept<br />
d’action emprunté au monde des entreprises. Disons qu’il désigne l’action qui vise à<br />
adapter le proj<strong>et</strong> <strong>et</strong> la stratégie en fonction des évolutions <strong>et</strong> des circonstances.<br />
• PLANIFICATION TERRITORIALE : Action qui vise à définir l’organisation<br />
générale d’un territoire à une échéance donnée. <strong>La</strong> <strong>planification</strong> se définit par le<br />
processus d’élaboration <strong>et</strong> par le résultat (à la fois un proj<strong>et</strong> d’aménagement du<br />
territoire <strong>et</strong> un plan) qui doit servir de référence à l’action de développement <strong>et</strong><br />
d’aménagement <strong>et</strong> en orienter la stratégie.<br />
Il est souvent question de <strong>planification</strong> stratégique : « Elle décrit la démarche au<br />
travers de laquelle une autorité publique, Etat, collectivité territoriale, établissement<br />
public, mission, sur un territoire déterminé <strong>et</strong> sur la base d’un diagnostic <strong>et</strong> de travaux<br />
de <strong>prospective</strong> menés avec les acteurs du territoire, définit une stratégie <strong>et</strong> des<br />
objectifs de développement durable. C<strong>et</strong>te stratégie peut se traduire soit par des<br />
orientations « normatives » en matière d’urbanisme soit par l’initialisation, la<br />
programmation <strong>et</strong> la mise en oeuvre d’actions opérationnelles. Elle suppose un suivi<br />
<strong>et</strong> une mise en œuvre à une échelle de temps suffisamment longue au regard des<br />
enjeux à traiter 137 ». C<strong>et</strong>te définition distingue deux formes de <strong>planification</strong> :<br />
restrictive, un document d’urbanisme (l’aspect organisation d’un territoire) <strong>et</strong><br />
extensive comme référence à l’action publique dans un champ plus ou moins large <strong>et</strong><br />
sans doute difficile à définir précisément (les politiques qui ont un impact spatial ?).<br />
Ce deuxième sens élargit la <strong>planification</strong> à l’aspect « programmation » (voir ce<br />
terme).<br />
<strong>La</strong> <strong>planification</strong> territoriale désigne en même temps un mode d’anticipation hérité des<br />
pratiques antérieures (la « <strong>planification</strong> à l’ancienne ») : plutôt fondé sur l’analyse<br />
prévisionnelle <strong>et</strong> les prolongements des tendances <strong>et</strong> des politiques <strong>et</strong> révélateur d’un<br />
avenir prédéterminé <strong>et</strong> par conséquent unique 138 . Une nouvelle pratique peut-elle être<br />
inventé sur la base d’un concept (à approfondir) de <strong>planification</strong> d’un avenir multiple<br />
<strong>et</strong> incertain ?<br />
• PREACTIF : Attitude par rapport à l’avenir qui consiste à se préparer pour faire face<br />
à des changements prévisibles.