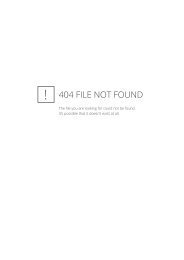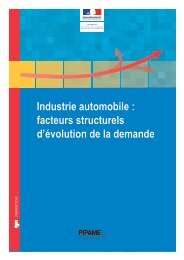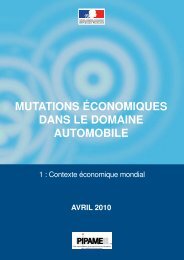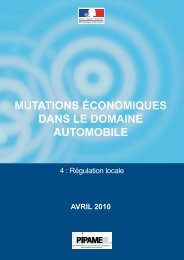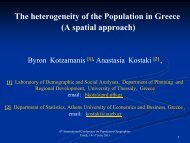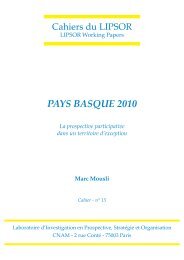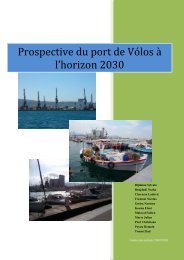prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
70 TRAVAUX ET RECHERCHES DE<br />
PROSPECTIVE – N°24<br />
- la construction de scénarios « normatifs », de représentations de ce qui est<br />
souhaitable à l’horizon donné <strong>et</strong> des « normes » (finalités + stratégies) à atteindre<br />
pour y parvenir.<br />
En l’absence d’un tel processus, suffit-t-il de dire : « Ici on fera une coupure verte, là on<br />
créera une infrastructure? » C<strong>et</strong>te absence d’alternative a été relevée par le Conseil de<br />
développement qui a reproché à la DTA de ne pas avoir étudié des scénarios contrastés.<br />
Des raisonnements aboutissant à des conclusions similaires pourraient être faits pour<br />
d’autres documents analysés, les proj<strong>et</strong>s de DTA de l’aire métropolitaine de Lyon <strong>et</strong> de<br />
Marseille, des schémas directeurs de l’agglomération lilloise, de la région grenobloise ou de<br />
Bugey-Cotière-plaine de l’Ain.<br />
Tous ces exemples sont emblématiques d’une démarche de <strong>planification</strong> « classique »<br />
fondée sur une base d’analyse prévisionnelle, au demeurant très bien faite dans tous les cas<br />
cités, où le futur est imaginé comme le système d’aujourd’hui prolongé, sans discussion sur<br />
le bien-fondé de ce modèle <strong>et</strong> des représentations du futur qui en résultent.<br />
Le constat est général : il y a un discours de <strong>prospective</strong> revendiquée mais non de<br />
démarche de <strong>prospective</strong> structurée <strong>et</strong> collective. Les alternatives ne sont pas<br />
envisagées. Le monde de l’analyse prévisionnelle marque toujours les documents de<br />
<strong>planification</strong> élaborés courant <strong>et</strong> fin des années 90. Il est étranger aux méthodes de la<br />
<strong>prospective</strong> territoriale, rodées au cours de la même période à la faveur des exercices<br />
régionaux.<br />
En dehors du cas de « Lyon 2010 », qui reste une exception sans lendemain, il ne nous a<br />
pas été donné d’observer un glissement de la prévision vers une démarche plus<br />
systémique <strong>et</strong> plus ouverte à l’exploration d’alternatives de futurs possibles : le cas du<br />
SD de Besançon est trop partiel ; un exercice de <strong>prospective</strong> a été surajouté sans interférence<br />
notable avec les études du SD du Saumurois. Deux schémas directeurs des années 90, à<br />
notre connaissance, ont inclus des exercices de <strong>prospective</strong> <strong>et</strong> ont été plus innovants : <strong>La</strong><br />
Rochelle <strong>et</strong> Châlons–en-Champagne.<br />
b) Le cas du SD lillois<br />
L’exemple du schéma directeur de l’agglomération lilloise est toutefois intéressant. Plus que<br />
les autres cas cités, il développe un discours marqué par une culture de la <strong>prospective</strong> <strong>et</strong> par<br />
une volonté d’anticipation du changement. En reprenant les analyses de Jean-François<br />
Stevens, « De la représentation à la stratégie, de la stratégie au proj<strong>et</strong> <strong>et</strong> du proj<strong>et</strong> à<br />
l’action»), le schéma directeur de Lille s’inscrit dans les acquis prospectifs du changement<br />
de perspective, le « basculement d’une logique de conversion régionale en une dynamique<br />
de métropolisation 48 », qui a stimulé les jeux d’acteurs, ouvert le champ des possibles <strong>et</strong><br />
dynamisé l’action publique.<br />
Pour autant, l’élaboration du schéma ne s’est pas engagée dans la voie d’un exercice de<br />
<strong>prospective</strong> pour explorer de façon plus approfondie les voies des grands enjeux posés dès la<br />
partie introductive. Il s’agit notamment de la dimension métropolitaine européenne <strong>et</strong> de<br />
certaines positions liées au contexte du développement de l’agglomération (construction<br />
européenne, nouvelle donne des transports, mondialisation <strong>et</strong> localisation des activités<br />
économiques, importance de la qualité de la ressource humaine, du cadre de vie <strong>et</strong> des<br />
48 Jean-François Stevens, « Prospective territoriale en Nord-Pas-de-Calais, la construction d’un présent<br />
engagé », contribution aux travaux du groupe de <strong>prospective</strong> D.A.T.A.R. « Prospective territoriale <strong>et</strong> action<br />
publique ».