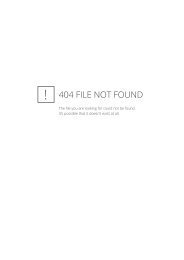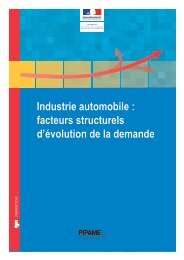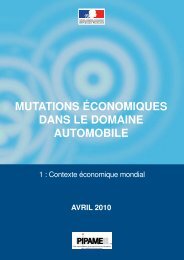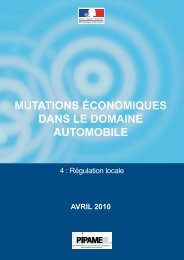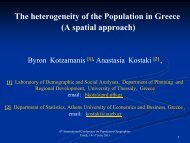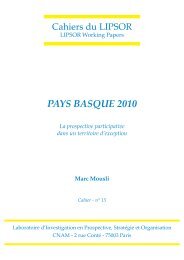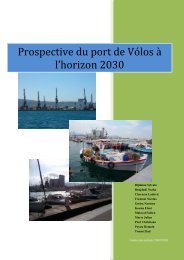prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
88 TRAVAUX ET RECHERCHES DE<br />
PROSPECTIVE – N°24<br />
Ainsi, la <strong>prospective</strong> est plus qu’un outil <strong>et</strong> s’élève au rang de système d’action situé à la<br />
charnière (elle-même mouvante) des interactions entre :<br />
- des problèmes de fond <strong>et</strong> des enjeux de société <strong>et</strong> de territoire,<br />
- des problèmes qui configurent l’«agir public» (le champ du politique <strong>et</strong> les « scènes<br />
politico-administratives » locales, les principes, procédures, aides financières,<br />
chartes <strong>et</strong> contrats…),<br />
- des problèmes posés par l’ouverture « participative » aux citoyens (ou à la « société<br />
civile »).<br />
Dans c<strong>et</strong>te situation, elle devrait perm<strong>et</strong>tre, par un accompagnement pas à pas, de guider<br />
l’adaptation de l’action publique aux fluctuations des réalités.<br />
Quels seront les suj<strong>et</strong>s de cristallisation de ce type d’interaction ? Pourraient-ils porter sur<br />
des thématiques valorisées par le SCOT : une organisation spatiale fondée sur une maîtrise<br />
de l’étalement urbain, sur la recherche de l’économie des ressources naturelles <strong>et</strong> de la<br />
consommation d’espace, sur les risques sociaux <strong>et</strong> environnementaux <strong>et</strong> les surcoûts induits<br />
par l’accroissement des déplacements motorisés ou encore sur les enjeux du renouvellement<br />
urbain ? Dans quelle mesure le développement durable, notion encore peu opératoire, serat-il<br />
un point d’appui pour concevoir ces politiques ?<br />
Comment ces thématiques, par exemple, peuvent-elles localement se transformer en<br />
véritable enjeu politique <strong>et</strong> en suj<strong>et</strong> de débat ouvert sur la société ? L’existence d’une offre<br />
de moyens, d’instruments <strong>et</strong> d’aides pour m<strong>et</strong>tre en œuvre des opérations dans ce champ, va<br />
orienter <strong>et</strong> contribuer à déterminer c<strong>et</strong>te « transformation ». L’offre influence la demande <strong>et</strong><br />
va peser, par ricoch<strong>et</strong>, sur la prise de conscience, l’analyse des problèmes <strong>et</strong> sur l’énoncé<br />
des propositions <strong>et</strong> des stratégies d’action. A chaque fois, il est nécessaire que se produise<br />
une alchimie locale à multiples déterminants <strong>et</strong> à résultats aléatoires.<br />
Comment se frayer un cheminement dans ce dédale d’interactions ? Leur résultante<br />
s’applique nécessairement à un échelon territorial local. Allons-nous dans le sens de ce que<br />
Jean-Gustave Padioleau appelle (de ses vœux) « un aménagement du territoire<br />
radicalement pragmatique 73 » de nature à conduire des « refondations liminaires de l’action<br />
publique conventionnelle », sans que l’auteur ait pensé au proj<strong>et</strong> de territoire <strong>et</strong> à<br />
l’utilisation de la <strong>prospective</strong> territoriale ?<br />
Il est certain que l’anticipation du futur ne peut se focaliser seulement sur des questions<br />
« substantielles » de contenu, elle a besoin de construire les interactions par rapport à une<br />
« scène locale » <strong>et</strong> un contexte politique, institutionnel <strong>et</strong> idéologique .<br />
• Un proj<strong>et</strong> sociétal avant d’être spatial<br />
Nous sommes loin de l’univers de la <strong>planification</strong> à la française des années 60-80. Le proj<strong>et</strong><br />
fondement de l’aménagement <strong>et</strong> de la <strong>planification</strong> qui en résulte est d’abord sociétal. <strong>La</strong><br />
<strong>prospective</strong> prime ainsi la <strong>planification</strong> <strong>et</strong> non l’inverse. Car elle explore ce que sent, ce<br />
que pense, ce que veut la société locale avant de penser en termes d’aménagement.<br />
L’aménagement est dans c<strong>et</strong>te figure, remis à une place subordonnée à l’expression d’un<br />
vouloir vivre collectif, lequel ne se donne pas sans peine, car il est lui-même un construit<br />
collectif dont la notion de « gouvernance » peut rendre compte.<br />
Il y a une mise à distance, un (re)questionnement des options spatiales <strong>et</strong> des proj<strong>et</strong>s<br />
d’aménagement <strong>et</strong> d’équipement à opérer pour pouvoir apprécier leurs eff<strong>et</strong>s sur les devenirs<br />
73 Jean-Gustave Padioleau, « Prospective de l’aménagement du territoire : refondations liminaires de l’action<br />
publique conventionnelle », in Repenser le territoire, un dictionnaire critique, Serge Wachter, directeur,<br />
édition de l’Aube-D.A.T.A.R., 2000, 287 pages.