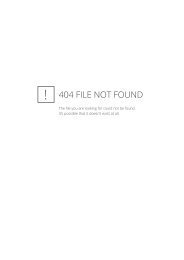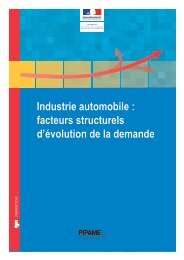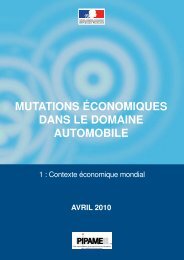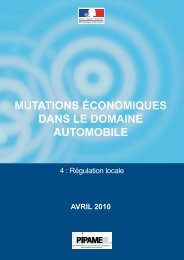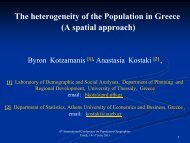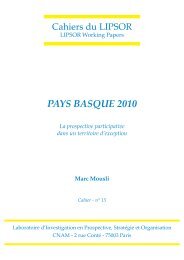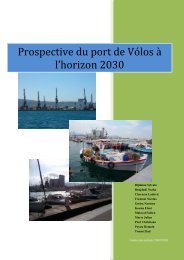prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PROSPECTIVE ET PLANIFICATION TERRITORIALES<br />
55<br />
- proposer des orientations stratégiques pour l’action (dans certains cas <strong>et</strong> le plus<br />
souvent possible des orientations quantifiées).<br />
Les groupes sont éphémères <strong>et</strong> à géométrie variable. Ils rendent leurs conclusions au terme<br />
de deux à cinq réunions.<br />
L’approche par enjeux spécialisés est justifiée par un souci de réalisme, de coller au plus<br />
près des réalités <strong>et</strong> de faciliter un questionnement prospectif, ainsi que par le sentiment selon<br />
lequel c<strong>et</strong>te logique de travail oblige les services à se départir de visions préconçues de<br />
l’évolution de leur domaine <strong>et</strong> de l’aménagement.<br />
Il s’agit d’une logique d’enrichissement des connaissances par des « visions » du futur sur<br />
des suj<strong>et</strong>s spécifiques apportées par des experts, dont les conséquences sur le territoire sont<br />
discutées, toujours en p<strong>et</strong>its comités spécialisés, <strong>et</strong> reprises par l’AGUR. <strong>La</strong> limite de c<strong>et</strong>te<br />
méthode réside dans la difficulté d’une synthèse <strong>et</strong> d’une mise en relation de ces nombreuses<br />
connaissances thématiques pour élaborer un diagnostic prospectif « global », c’est-à-dire qui<br />
ouvre sur des hypothèses de futurs possibles <strong>et</strong> de scénarios d’évolution pour l’ensemble du<br />
territoire. Le risque est grand d’accumuler des connaissances sans pouvoir les transformer en<br />
informations significatives pour le futur. L’abondance de connaissances ne peut pallier un<br />
défaut de vision structurante de scénarios d’avenir.<br />
<strong>La</strong> limite d’une <strong>prospective</strong> d’expert portant sur des suj<strong>et</strong>s spécialisés « territorialisés » est<br />
de ne pas être intégrée dans une démarche de <strong>prospective</strong> territoriale.<br />
Les objectifs de ce type d’approche restent ambigus. Une forte demande pour plus de<br />
connaissance destinée à éclairer des travaux de diagnostic affleure de la part des équipes de<br />
proj<strong>et</strong> locales <strong>et</strong> de certaines agences d’urbanisme. L’esprit de c<strong>et</strong>te demande est le plus<br />
souvent de caractère fonctionnel <strong>et</strong> peu prospectif, c’est-à-dire sans véritable perspective<br />
d’exploitation de ces connaissances dans le cadre d’une exploration un peu systémique du<br />
futur.<br />
• A l’extrême inverse, le cas du bassin de l’Adour-Garonne illustre le modèle d’une<br />
<strong>prospective</strong> territoriale à partir d’une thématique principale. Un grand territoire : le<br />
bassin versant, quasi le sud-ouest de la France, une entrée « unique » : l’eau à l’horizon<br />
2015.<br />
Pour le maître d’ouvrage, l’Agence de l’eau Adour-Garonne, placé face à une situation de<br />
dégradation de la qualité <strong>et</strong> des volumes de ressources en eau, l’objectif était d’élaborer une<br />
stratégie d’entreprise calée sur une représentation des évolutions à long terme possibles.<br />
Comment situer l’eau, dans ses multiples fac<strong>et</strong>tes (rivières, eaux souterraines, précipitations,<br />
ressources en eau potable, pollution, irrigation,…) par rapport aux comportements des<br />
différents écosystèmes, aux politiques <strong>et</strong> pratiques urbaines <strong>et</strong> sociétales, aux pratiques<br />
techniques… ?<br />
Une grille d’analyse systémique <strong>et</strong> une série de quatre scénarios de tendance m<strong>et</strong>tent en<br />
relation deux types de variables, des facteurs spécifiques à la question de l’eau (13 variables,<br />
par exemple, précipitation, irrigation, financement de la politique publique de l’eau..) <strong>et</strong> des<br />
variables génériques qui rendent compte des questions de fond d’une société à un moment<br />
donné (19 variables : périurbanisation, organisation industrielle de l’agriculture, évolution<br />
des modes de vie…), pour donner une représentation du « système eau ».