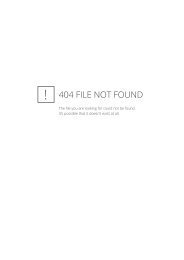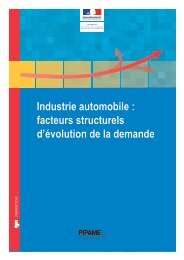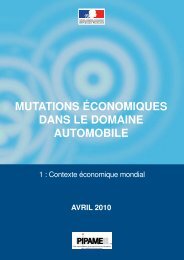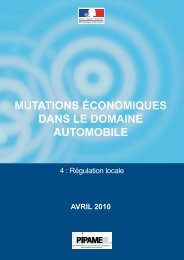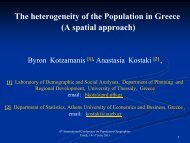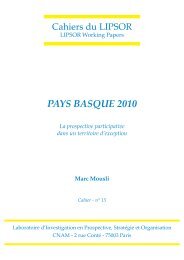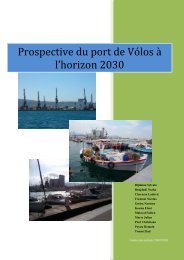prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
118 TRAVAUX ET RECHERCHES DE<br />
PROSPECTIVE – N°24<br />
plupart des départements de la façade Atlantique qui ont une évolution plus conforme au<br />
dynamisme caractéristique des espaces littoraux, peut induire une série de questions :<br />
L’éloignement par rapport aux grands pôles métropolitains est-il un facteur d’explication ?<br />
<strong>La</strong> métropole rennaise est-elle capable de diffuser sa croissance sur l’ensemble de la région<br />
Br<strong>et</strong>agne ? L’économie d’arsenal, une des caractéristiques de ce territoire, est-elle une<br />
force motrice de son développement à long terme ? <strong>La</strong> crise grave de l’économie de la<br />
pêche ne se traduit-elle pas par un sentiment diffus de perte de sens <strong>et</strong> de confiance pour les<br />
habitants, susceptible de se mesurer ensuite dans les chiffres des taux de fécondité?<br />
IX.<br />
Dans tous les cas, l’élucidation des motivations profondes d’un commanditaire public<br />
est une tâche majeure de l’activité de <strong>prospective</strong>. Elle détermine la construction des<br />
prémices du discours. Les acteurs d’un territoire attendent, implicitement ou explicitement,<br />
comme résultat d’un diagnostic : une synthèse des tendances lourdes <strong>et</strong> des facteurs-clés de<br />
la dynamique locale, les inflexions de tendance <strong>et</strong> les risques de rupture ou de déphasage<br />
des activités par rapport au contexte.<br />
Il y a naturellement interactivités entre la construction de connaissances <strong>et</strong> la qualité <strong>et</strong><br />
l’affinement du questionnement. Certaines questions surgissent à l’issue d’un éclairage<br />
donné par une étude ou par des experts. A quel moment de la démarche (<strong>et</strong> au travers de<br />
quels acteurs) est-il possible d’introduire tel ou tel enjeu ? Par exemple, le phénomène de<br />
montée en puissance des « r<strong>et</strong>raités actifs », enjeu non seulement sociétal mais économique<br />
avec des conséquences croissantes pour certains territoires sur les marchés fonciers <strong>et</strong><br />
immobiliers, sur l’évolution du commerce <strong>et</strong> des services, sur la gouvernance politique <strong>et</strong><br />
associative ? Pas nécessairement d’entrée de jeu. <strong>La</strong> conscience des enjeux qui perm<strong>et</strong><br />
d’affiner les questionnements se produit dans le mouvement de la dynamique du processus.<br />
Une démarche de <strong>prospective</strong> qui fait évoluer le regard des acteurs sur le territoire <strong>et</strong> sur<br />
son devenir, transforme les termes du questionnement.<br />
Une problématique introduite au mauvais moment peut conduire à une impasse. « Quelle<br />
programmation pour réutiliser une friche stratégiquement située ? », est une question qui<br />
peut susciter des conflits <strong>et</strong> stériliser une démarche. <strong>La</strong> faire précéder par des questions plus<br />
générales de type « Quelle ville pour quelle société locale à un horizon de vingt ans ? »,<br />
peut devenir un détour salutaire pour apporter une modification des regards sur les possibles<br />
programmes de l’utilisation de la friche.<br />
• Il y a une différence entre les interrogations de fond dans le domaine politique <strong>et</strong><br />
institutionnel <strong>et</strong> celles susceptibles d’apparaître par le biais de la société civile. Les<br />
premières sont, toute proportion gardée, relativement « simples », elles peuvent être<br />
posées par un bon organisme d’étude qui entr<strong>et</strong>ient des relations « convenables » avec le<br />
politique. Les secondes, les demandes sociétales, souvent « silencieuses » jusqu’au<br />
moment où elles éclatent, sont plus difficiles à appréhender. <strong>La</strong> société politique<br />
instituée a besoin de gagner en réactivité par rapport à la société civile.<br />
<strong>La</strong> « réalité » est difficile à saisir, certains enjeux sont souvent cachés ou négligés alors que<br />
des questions subalternes ou non stratégiques occupent le devant de la scène. L’expression<br />
des enjeux peut être dictée par les médias : un événement survient <strong>et</strong> le problème devient<br />
prioritaire. Un autre survient <strong>et</strong> l’ordre des priorités est changé. <strong>La</strong> mise en distance de<br />
l’expression des enjeux perçus est essentielle. Des experts peuvent venir éclairer la « scène<br />
locale ». C<strong>et</strong>te pratique de conférences d’experts pour éclairer une thématique <strong>et</strong> pour<br />
acculturer les « acteurs » est devenue courante. Lyon 2010 l’a introduite dans un cadre de