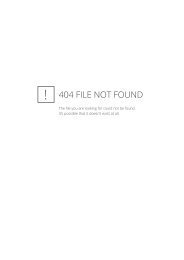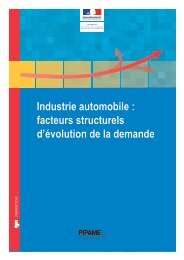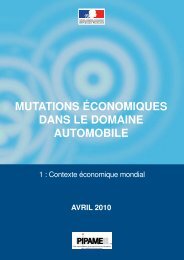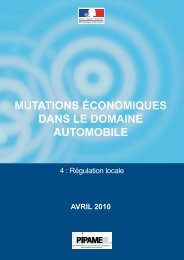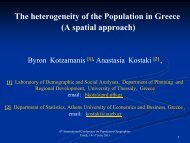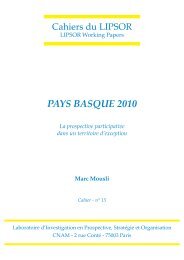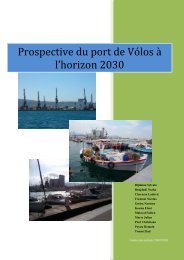prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
prospective et planification territoriales - La prospective
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PROSPECTIVE ET PLANIFICATION TERRITORIALES<br />
113<br />
I. LE REGISTRE DE LA DEMARCHE DE PROJET<br />
Un proj<strong>et</strong> de territoire est une démarche globale qui vise à définir :<br />
- un ensemble d’objectifs cohérents <strong>et</strong> coordonnés à atteindre progressivement dans<br />
une durée donnée,<br />
- un cadre opérationnel pour l’ensemble des actions collectives possibles,<br />
- un cadre de pensée susceptible de faire sens pour la population, pour les acteurs <strong>et</strong><br />
les habitants d’un territoire.<br />
C’est donc à la fois un outil de travail « pragmatique » <strong>et</strong> un outil de communication <strong>et</strong> de<br />
débat avec les citoyens.<br />
C<strong>et</strong>te approche mixte, composite, correspond à une innovation majeure dans le champ de<br />
l’aménagement. Jusqu’alors le débat avec le public était absent ou très lacunaire, en général<br />
placé en aval de la définition du proj<strong>et</strong>. Le dialogue, c'est-à-dire le partage des intentions<br />
avec les citoyens, n’avait pas lieu ou se tenait dans de mauvaises conditions, souvent de<br />
façon conflictuelle avec des risques de blocage, de ralentissement des processus<br />
opérationnels <strong>et</strong> souvent de surcoût, sur un fond général de développement des recours<br />
contentieux.<br />
<strong>La</strong> notion de Proj<strong>et</strong> de territoire peut être considérée comme une tentative pour remédier à la<br />
mauvaise efficacité des dispositifs liés aux politiques d’aménagement. Ce r<strong>et</strong>our de la<br />
citoyenn<strong>et</strong>é dans le champ de l’aménagement a été marqué en partie par les deux lois<br />
d’aménagement du territoire <strong>et</strong> d’urbanisme (lois Voyn<strong>et</strong> <strong>et</strong> SRU).<br />
Paradoxalement, l’importance accordée au débat avec la société civile se traduit par un<br />
renouvellement des bases mêmes de l’action <strong>et</strong> des politiques d’aménagement. L’exigence<br />
de communication avec le public provoque des eff<strong>et</strong>s sur la construction même du proj<strong>et</strong>,<br />
elle en modifie le sens, la portée, la logique. Elle implique de se poser d’entrée de jeu la<br />
question : quel territoire-société voulons-nous ? Il ne s’agit plus seulement d’un débat<br />
technique confiné aux spécialistes, aux aménageurs <strong>et</strong> aux politiques, mais d’abord un débat<br />
de philosophie sociale <strong>et</strong> un débat politique.<br />
Il en résulte un important renouvellement des méthodes <strong>et</strong> des mécanismes de conception<br />
des proj<strong>et</strong>s dont la notion de proj<strong>et</strong> de territoire est l’expression globale. Les « fils » se<br />
nouent autrement que dans la logique antérieure. <strong>La</strong> logique antérieure était marquée par un<br />
mécanisme de pensée linéaire : une intention de l’acteur politique, une projection d’ordre<br />
prévisionnel, un choix d’orientation stratégique, l’affinement opérationnel, la<br />
programmation, la prise de décision <strong>et</strong> la mise en œuvre. Dans un processus de proj<strong>et</strong><br />
territorial « moderne », les étapes sont plus itératives <strong>et</strong> la question de base est plus<br />
globale <strong>et</strong> plus politique : quel devenir pour ce territoire <strong>et</strong> quel territoire pour une future<br />
société locale ? En bonne logique, le processus doit « commencer » par le débat qui doit lui<br />
indiquer un sens <strong>et</strong> non plus en aval, une fois les options stratégiques prises.<br />
L’acteur public doit être en capacité d’amorcer un tel débat, d’aller vers le public avec sa<br />
propre représentation du souhaitable. Il est obligé de « dire » ce qu’il veut <strong>et</strong> comment il le<br />
veut. Ce que le public attend de l’acteur public, c’est qu’il lui donne une « vision » des<br />
choses, sa vision des choses, afin d’en débattre <strong>et</strong> d’aboutir à des consensus au-delà des