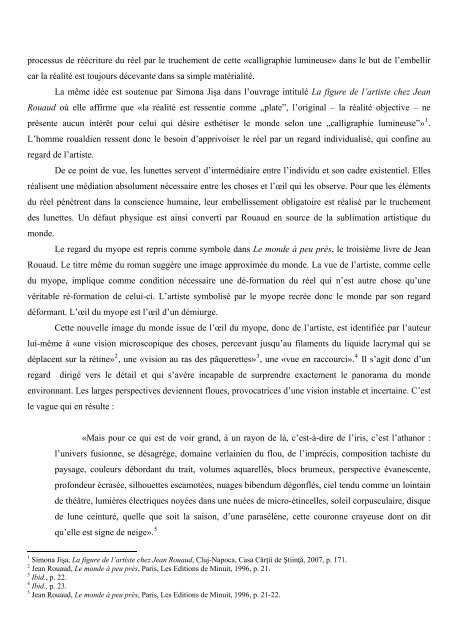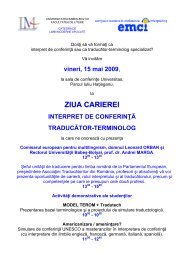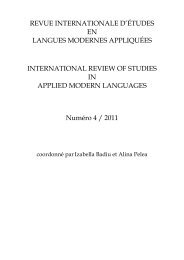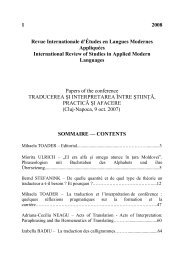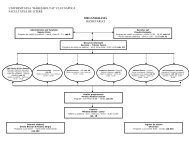Dimensiuni ale limbajului n context carceral
Dimensiuni ale limbajului n context carceral
Dimensiuni ale limbajului n context carceral
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
processus de réécriture du réel par le truchement de cette «calligraphie lumineuse» dans le but de l’embellir<br />
car la réalité est toujours décevante dans sa simple matérialité.<br />
La même idée est soutenue par Simona Jişa dans l’ouvrage intitulé La figure de l’artiste chez Jean<br />
Rouaud où elle affirme que «la réalité est ressentie comme „plate”, l’original – la réalité objective – ne<br />
présente aucun intérêt pour celui qui désire esthétiser le monde selon une „calligraphie lumineuse”» 1 .<br />
L’homme roualdien ressent donc le besoin d’apprivoiser le réel par un regard individualisé, qui confine au<br />
regard de l’artiste.<br />
De ce point de vue, les lunettes servent d’intermédiaire entre l’individu et son cadre existentiel. Elles<br />
réalisent une médiation absolument nécessaire entre les choses et l’œil qui les observe. Pour que les éléments<br />
du réel pénètrent dans la conscience humaine, leur embellissement obligatoire est réalisé par le truchement<br />
des lunettes. Un défaut physique est ainsi converti par Rouaud en source de la sublimation artistique du<br />
monde.<br />
Le regard du myope est repris comme symbole dans Le monde à peu près, le troisième livre de Jean<br />
Rouaud. Le titre même du roman suggère une image approximée du monde. La vue de l’artiste, comme celle<br />
du myope, implique comme condition nécessaire une dé-formation du réel qui n’est autre chose qu’une<br />
véritable ré-formation de celui-ci. L’artiste symbolisé par le myope recrée donc le monde par son regard<br />
déformant. L’œil du myope est l’œil d’un démiurge.<br />
Cette nouvelle image du monde issue de l’œil du myope, donc de l’artiste, est identifiée par l’auteur<br />
lui-même à «une vision microscopique des choses, percevant jusqu’au filaments du liquide lacrymal qui se<br />
déplacent sur la rétine» 2 , une «vision au ras des pâquerettes» 3 , une «vue en raccourci». 4 Il s’agit donc d’un<br />
regard dirigé vers le détail et qui s’avère incapable de surprendre exactement le panorama du monde<br />
environnant. Les larges perspectives deviennent floues, provocatrices d’une vision instable et incertaine. C’est<br />
le vague qui en résulte :<br />
«Mais pour ce qui est de voir grand, à un rayon de là, c’est-à-dire de l’iris, c’est l’athanor :<br />
l’univers fusionne, se désagrège, domaine verlainien du flou, de l’imprécis, composition tachiste du<br />
paysage, couleurs débordant du trait, volumes aquarellés, blocs brumeux, perspective évanescente,<br />
profondeur écrasée, silhouettes escamotées, nuages bibendum dégonflés, ciel tendu comme un lointain<br />
de théâtre, lumières électriques noyées dans une nuées de micro-étincelles, soleil corpusculaire, disque<br />
de lune ceinturé, quelle que soit la saison, d’une parasélène, cette couronne crayeuse dont on dit<br />
qu’elle est signe de neige». 5<br />
1<br />
Simona Jişa, La figure de l’artiste chez Jean Rouaud, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, p. 171.<br />
2<br />
Jean Rouaud, Le monde à peu près, Paris, Les Editions de Minuit, 1996, p. 21.<br />
3<br />
Ibid., p. 22.<br />
4<br />
Ibid., p. 23.<br />
5<br />
Jean Rouaud, Le monde à peu près, Paris, Les Editions de Minuit, 1996, p. 21-22.