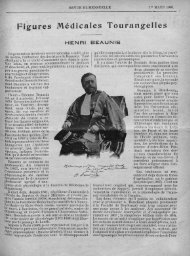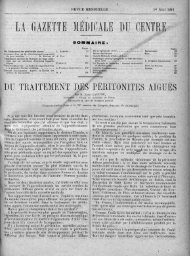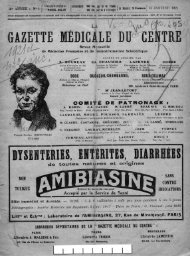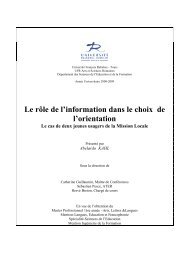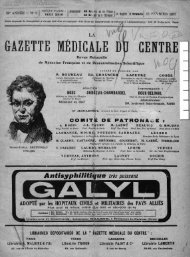Langue, langage et parole en éducation - Université François ...
Langue, langage et parole en éducation - Université François ...
Langue, langage et parole en éducation - Université François ...
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
53La particularité de l’homme est qu’il veuille à tout prix nommer les choses <strong>et</strong> le g<strong>en</strong>s pourpouvoir les ranger dans une catégorie, puis une sous-catégorie, <strong>et</strong>c. Peut-on toujours nousclasser, hors certaines caractéristiques intrinsèquem<strong>en</strong>t humaines telles que mammifère,omnivore ou autre ? Le danger serait d’oublier l’individu derrière le vocable qu’on lui auraitattribué, <strong>et</strong> que l’adjectif ne devi<strong>en</strong>ne substantif, que le suj<strong>et</strong> ne se change <strong>en</strong> obj<strong>et</strong>. Nous nesommes pas face à un aveugle, mais à une personne aveugle, c’est là toute la différ<strong>en</strong>ce. Sinous rem<strong>et</strong>tions l’adjectif à sa vraie place, le terme de non-voyant se justifierait-t-il ?Handicap suj<strong>et</strong> ou obj<strong>et</strong> ?Tout d’abord de quel suj<strong>et</strong> parlons-nous ? Du grammatical, qui induit que le suj<strong>et</strong> estl’auteur d’une proposition, voire ce dont on parle, ou du suj<strong>et</strong> soumis à une tierce autorité ?Nous pouvons prét<strong>en</strong>dre à être des suj<strong>et</strong>s acteurs <strong>et</strong> maîtres des propositions. En sa qualitéde pathologie, le handicap est le suj<strong>et</strong> dont on parle. Pour la soumission, lequel dominel’autre ? Il impose sa prés<strong>en</strong>ce <strong>et</strong> ses contraintes, la volonté peut l’apprivoiser, jamais leréduire <strong>en</strong> esclavage ; alors que pour nous, humains, la servitude au handicap est un risque.C’est le paradoxe du handicap dont nous parlons, il illustre la complexité de sa définition.Le propre de l’obj<strong>et</strong> est d’avoir été généré par la main de l’homme, la main ou l’esprit. Si lehandicap est une pathologie, c’est dans sa manifestation qu’il devi<strong>en</strong>t l’obj<strong>et</strong> de nostourm<strong>en</strong>ts. L’obj<strong>et</strong> est subordonné à l’humain, mais surtout l’obj<strong>et</strong> ne se conçoit que précédéd’un article, dans la langue française tout du moins. C’est donc un ou le handicap. Alors qu<strong>en</strong>ous, nous sommes représ<strong>en</strong>tés par des pronoms, ou des noms, mais propres, avec unemajuscule. Ce n’est pas comparable.D’aucuns avai<strong>en</strong>t p<strong>en</strong>sé <strong>en</strong> leur temps, que certains suj<strong>et</strong>s, obj<strong>et</strong>s imparfaits, ne répondantpas aux indications de la normalité définie sur des critères fallacieux, n’avai<strong>en</strong>t plus droit decité <strong>et</strong> se devai<strong>en</strong>t de disparaître du paysage. Il est toujours à craindre que si nous nousobstinerons à vouloir qualifier l’être avec un substantif <strong>et</strong> pas un adjectif, à transformer lesmots <strong>et</strong> leurs places au lieu d’<strong>en</strong> inv<strong>en</strong>ter ou d’<strong>en</strong> composer de nouveaux, mieux adaptés,nous courons le risque d’<strong>en</strong>courager la stigmatisation plutôt que de l’éradiquer.Toute la difficulté de notre <strong>langage</strong>, qui somme toute s’avère relativem<strong>en</strong>t pauvre, résidedans le fait d’arriver à désigner quelqu’un sans le m<strong>et</strong>tre au rang de l’obj<strong>et</strong>. C’estprobablem<strong>en</strong>t ce qui nous a conduits, pour éviter l’amalgame, à inv<strong>en</strong>ter le concept de« personne <strong>en</strong> situation de handicap ». Mais alors, un homme <strong>en</strong> situation de handicap est-ilun homme handicapé ?